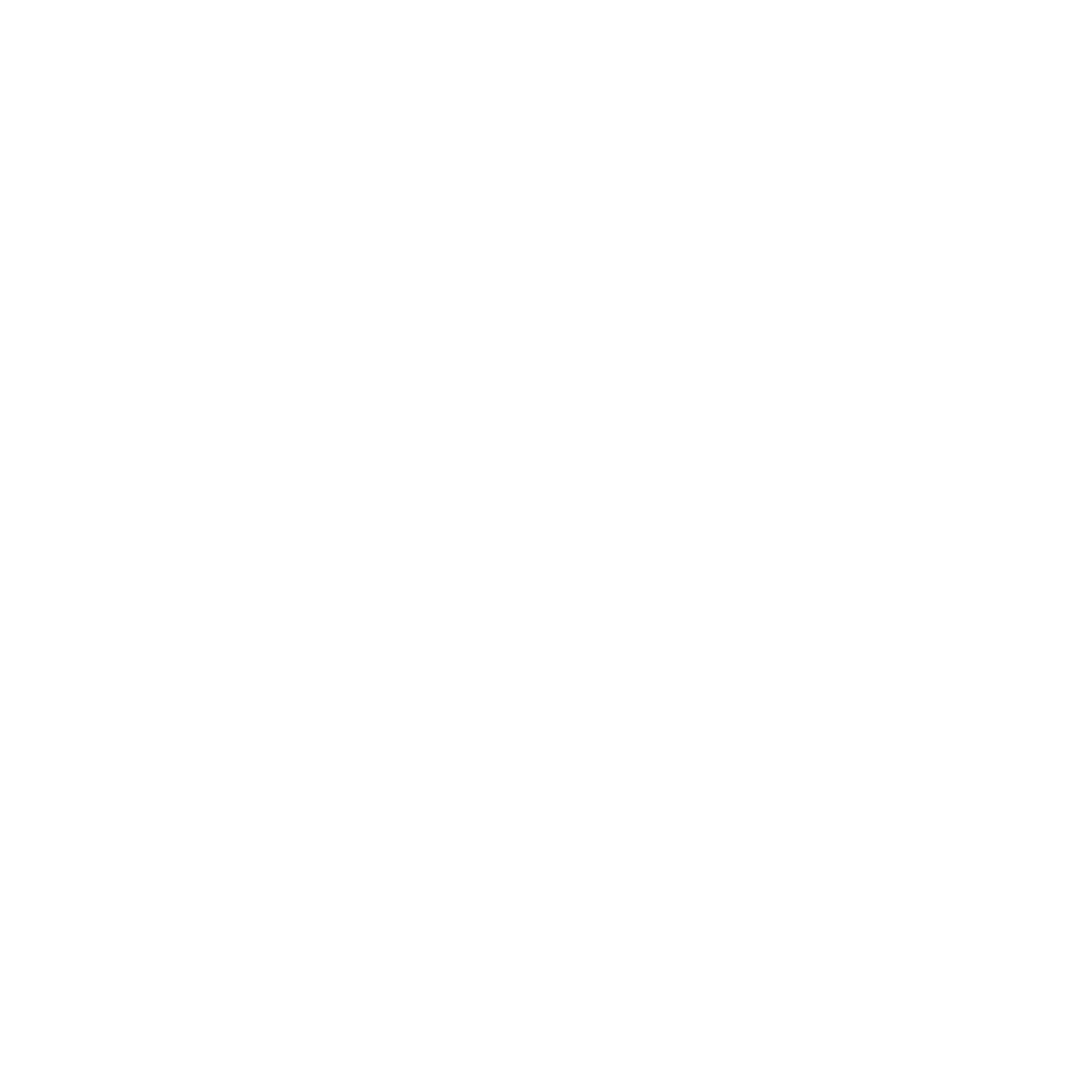Le statut juridique du mineur est traditionnellement le fruit d’un équilibre entre son assimilation aux adultes qui l’élèvent et la prise en compte de son individualité de personne juridique capable en devenir. Selon les aspirations sociales et politiques de l’ordre juridique qui le définit, la balance penchera en faveur de l’un ou de l’autre, étant à ce jour acquis que le compromis doit nécessairement s’opérer dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le lien familial entre l'enfant et ses parents, lorsque ces derniers sont eux-même demandeurs d'asile, complexifie le traitement procédural de la demande d'asile du mineur accompagné, devant l'OFPRA comme devant la CNDA. La contribution revient ici sur la jurisprudence récente du Conseil d'Etat qui apporte d'importantes précisions en la matière.
Notes de bas de pages
Les mineurs non accompagnés constituent une catégorie particulière de demandeurs d’asile. Ils bénéficient généralement de dérogations et d’adaptations du droit commun applicable en matière d’asile afin de les protéger au mieux en l’absence de leurs représentants légaux. Le nouveau Pacte sur l’asile et la migration de l’Union européenne revient sur les garanties apportées précédemment par le Régime d’asile européen commun. Notamment, il a privilégié, à plusieurs stades des procédures qu’il encadre, une application du droit commun à ces mineurs au détriment du respect de leurs droits. En ce qui concerne la principale adaptation qui leur est accordée, c’est-à-dire la désignation systématique et sans délai d’un représentant légal, le nouveau régime semble incomplet. Malgré quelques avancées, la mise en œuvre de cette désignation, en particulier lors de la nouvelle procédure de filtrage, risque de poser un certain nombre de difficultés pratiques. Le Pacte ne semble pas avoir fait de l’intérêt supérieur de ces enfants une considération primordiale.
La notion de « mineur non accompagné » a véritablement pris corps avec les évolutions successives du droit des réfugiés. De fait, l’une des premières occurrences de l’expression peut être trouvée dans la constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés (ancêtre du Haut-Commissariat pour les réfugiés) de 1948 qui reconnaît la possibilité, pour ces enfants, de bénéficier du statut de réfugié[1].
Notes de bas de pages
Les multiples conflits et la dégradation de la situation sécuritaire dans de nombreux pays ont une influence directe sur les déplacements de population à l’échelle mondiale. Une des conséquences à ces déplacements est la naissance d’enfants dont les parents n’ont pas forcément la même nationalité et une naissance dans un pays différent des pays d’origine des parents. En droit d’asile, l’Administration et le juge s’intéressent à la nationalité des demandeurs d’asile pour examiner où ces derniers ne veulent ou ne peuvent retourner en raison de craintes de persécution. Les mêmes instances se trouvent régulièrement à devoir se prononcer sur la nationalité de mineurs, en particulier dans le cas où un parent invoque des craintes de persécution personnelles à son enfant. Les différents cas d’accès à la nationalité d’un demandeur d’asile mineur entraînent une multiplicité des solutions juridiques à appliquer.
En droit de l’asile, il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après « OFPRA ») et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit de l’asile (ci-après « CNDA ») de se prononcer sur la nationalité des requérants[1].
Notes de bas de pages

Mon intérêt pour le droit d’asile a commencé par un engagement associatif qui m'a permis de faire du suivi de terrain de demandeurs d’asile LGBTQIA+. En parallèle, un engagement salarié en tant que juriste en centre de rétention m’a également apporté une expérience de terrain intense. À la suite d’une courte formation, je suis à présent formateur pour adultes en droit d’asile depuis quatre années. En parallèle à cette activité, je siège à la Cour Nationale du Droit d’Asile en tant qu’assesseur désigné par le Haut-Commissariat aux Nations-Unies pour les réfugiés.
La création du Bulletin de pratique et de droit d’asile repose sur le constat d’une constante évolution des règles applicables qui s’accompagne de leur complexification.
À l’heure où le droit d’asile en France a été réformé par la loi « Asile et immigration » du 26 janvier dernier et devrait être modifié par l’adoption prochaine de la réforme du Régime d’asile européen commun au sein de l’Union européenne, il apparaît nécessaire de faciliter la compréhension de la matière et de mettre en lumière les enjeux qui s’y attachent.
Notes de bas de pages

Delphine BURRIEZ est maître de conférences à l'Université Paris-Panthéon-Assas et est directrice du Bulletin de pratique et de droit de l’asile.
Elle dirige le DU Droit de l’asile : Accueil et protection des étrangers persécutés et publie régulièrement des travaux en lien avec le droit d’asile, dans ses aspects internes et internationaux.
La loi Asile du 29 juillet 2015, qui a fait de la menace grave pour la sûreté de l’État ou pour la société française un motif de refus ou de retrait du statut de réfugié, a marqué un tournant majeur dans la prise en compte et le traitement des questions d’ordre public par les autorités chargées de l’examen des demandes d’asile et de l’octroi de la protection internationale que sont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
Cette réforme – dont l’élaboration s’est inscrite dans le contexte de la vague d’attentats terroristes de l'année 2015 – a constitué une véritable révolution culturelle, en particulier pour l’OFPRA, qui s’est en conséquence profondément réformé, sur le plan organisationnel et fonctionnel, pour être à la hauteur des enjeux sécuritaires. Et cela dans un cadre juridique relativement nouveau, et donc nécessairement mouvant.
Notes de bas de pages
L’annonce en décembre 2023, par le Parlement européen et le Conseil, de leur accord politique sur les derniers textes clés de la réforme du régime d’asile européen en négociation depuis 2016, ouvre la voie à sa finalisation.
Selon la communication officielle, deux ambitions seront bientôt concrétisées : améliorer l’efficacité de ce système d’asile et renforcer la solidarité entre États membres de l’Union par un allègement de la charge qui grève les États d’entrée. Une confrontation entre les dispositifs annoncés et ces objectifs conduit à contredire cet optimisme.
Notes de bas de pages
De la distinction résultant du droit de l'Union européenne entre la qualité et le statut de réfugié, résulte un ensemble de règles textuelles et jurisprudentielles relatives aux conditions de retrait du seul statut et à ses implications sur les contours de la protection due au réfugié.
1. À la source de la distinction entre la qualité et le statut de réfugié : l’articulation entre le droit de l’Union européenne et la Convention de Genève
Notes de bas de pages

Claire BRICE-DELAJOUX est maître de conférences en droit public (habilitée à diriger des recherches) à l’Université d’Évry (Paris-Saclay).
Elle enseigne principalement le droit administratif, le droit des libertés fondamentales ainsi que le droit de l’asile, dans ses dimensions internationale, européenne et interne.
Elle dirige depuis 2017 le master 2 Droits de l’homme et Droit humanitaire de l’Université Paris Saclay. Elle publie régulièrement des articles en lien direct avec le droit d’asile. Elle a également été juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile, nommée sur proposition du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, entre 2000 et 2008.