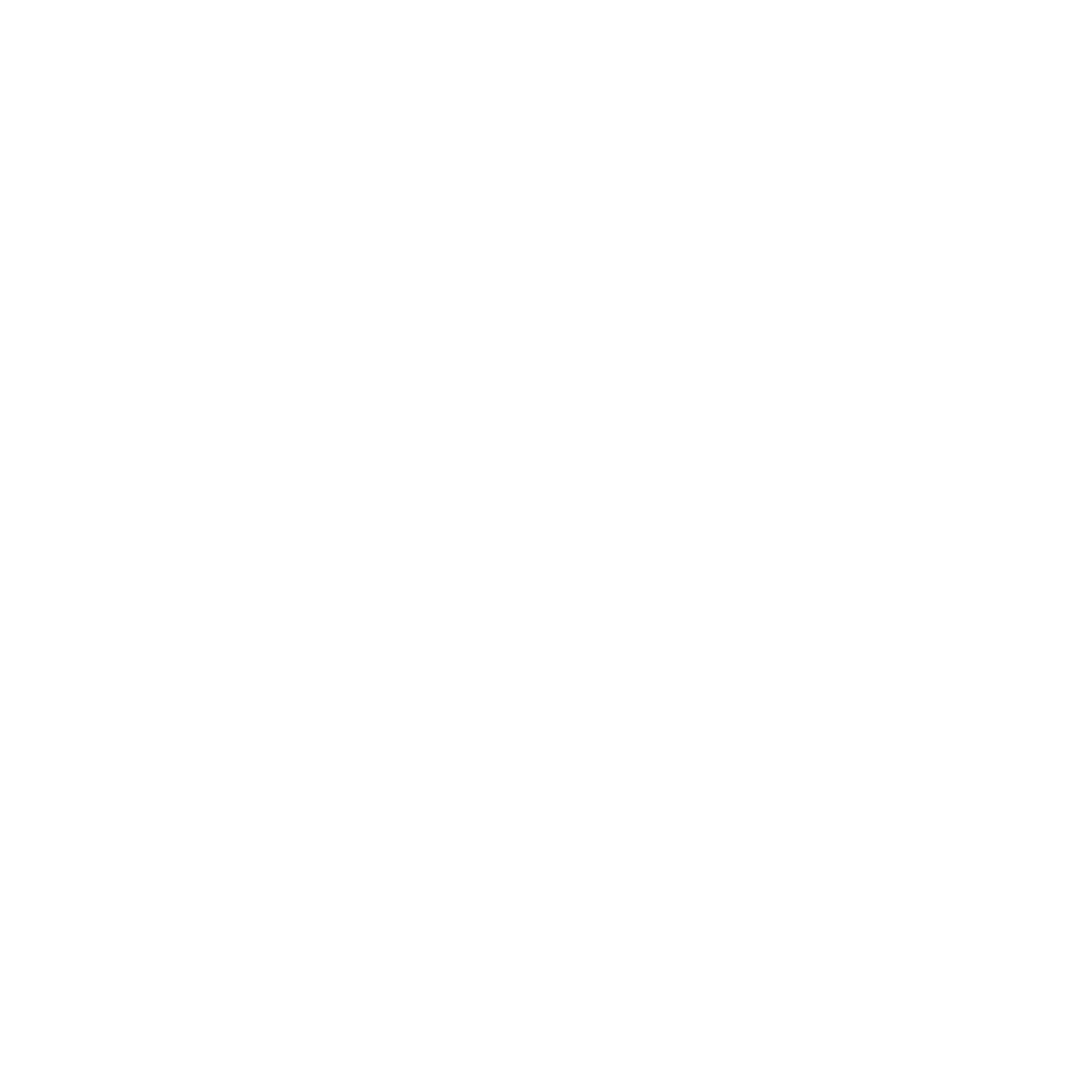En droit de l’asile, il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après « OFPRA ») et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit de l’asile (ci-après « CNDA ») de se prononcer sur la nationalité des requérants[1]. Préalable indispensable à toute demande d’asile, cet examen peut soulever plusieurs questions auxquelles le juge de l’asile devra répondre, à peine d’erreur de droit[2].
La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés invite à protéger les personnes se trouvant hors du pays dont elles ont la nationalité et qui ne peuvent ou ne veulent « se réclamer de la protection de ce pays »[3]. En France, l’article 29 du Code civil prévoit que « [l]a juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ». Cependant, le législateur ainsi que le Conseil d’État ont confié au juge de l’asile la compétence d’établir la nationalité ou les nationalités d’un étranger à la lecture des lois des pays concernés[4].
Aux termes du 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalitéˮ vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité, et ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité ». L’article 4, 3. de la directive dite « qualification » 2011/95/UE du 13 décembre 2011 précise qu’ « il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ; […] e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « Ceseda »), pour statuer sur une demande d’asile, « [l]'office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité ». Pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, un demandeur d’asile devra ainsi prouver qu’il a des craintes de persécution en cas de retour dans tous les pays dont il a la nationalité.
Un réfugié peut être entré sur le territoire français accompagné de sa famille ou cette dernière peut l’avoir rejoint postérieurement à l’obtention du statut de réfugié. À cet égard, l’Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le Statut des réfugiés et des apatrides recommande aux États de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié[5]. La jurisprudence du Conseil d’État est venue clarifier l’étendue de cette protection au fil des années[6] au travers notamment d’une décision en Assemblée[7], fait rare en matière du contentieux de la demande d’asile[8]. Sur ce fondement, un mineur peut bénéficier de la protection internationale par extension de celle reconnue à son parent au titre soit du principe de l’unité de famille prévu spécifiquement pour le statut de réfugié[9] soit de l’extension de la protection aux mineurs prévue tant pour le statut de réfugié que pour le bénéfice de la protection subsidiaire[10]. Mais un enfant peut également être en danger pour des raisons qui lui sont propres.
Il n’est alors plus question ici d’unité de famille ou d’extension de la protection reconnue au parent. Un mineur peut se voir octroyer les mêmes protections qu’un demandeur d’asile majeur du fait de craintes personnelles : le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Par exemple, une mineure pourra obtenir le statut de réfugié de par son appartenance au groupe social des jeunes filles non mutilées risquant d’être excisées, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités[11]. L’examen de ces craintes individuelles amène à s’intéresser plus précisément à la situation de l’enfant mineur, comme à sa ou ses nationalités, plutôt qu’uniquement à celle de ses parents. En effet, là où la détermination de la nationalité d’un requérant majeur semble balisée de longue date par les textes et la jurisprudence, la lecture croisée des lois étrangères relatives à l’attribution et l’acquisition de la nationalité des parents peut rendre complexe la détermination de la nationalité ou de la plurinationalité d’un requérant mineur. Cette détermination nécessite d’identifier les différents cas d’accès à la nationalité d’un mineur (I). Il convient également d’apprécier les conséquences de l’acquisition de la majorité ou de la naturalisation française sur la protection internationale reconnue à un mineur (II).
I. Le droit d'asile à l'épreuve de la détermination de la nationalité du mineur
En fuyant des persécutions, les demandeurs d’asile ont rarement le temps ou l’opportunité de recueillir les documents susceptibles de prouver leur nationalité. De plus, par méconnaissance des lois étrangères en matière de nationalité, certains demandeurs d’asile ne savent pas présenter avec précision les circonstances ayant présidé à l’acquisition de leur nationalité.
L’Histoire nous enseigne qu’une même personne peut perdre sa nationalité voire en acquérir une autre à l’occasion de la disparition et de l’apparition d’États. La dislocation de l’URSS le 26 décembre 1991 a eu, entre autres conséquences, l’émergence et la réémergence de nouvelles nationalités. La citoyenneté soviétique ayant disparu, chaque citoyen a dû rejoindre la nationalité d’un (ou de plusieurs !) des États venant d’apparaître. Dès 1992, le cumul des citoyennetés n’est plus strictement interdit sur les territoires de l’ex-URSS, bien qu'il ne soit autorisé que dans les cas où la Fédération de Russie a conclu un accord bilatéral sur la double citoyenneté. La demande d’asile des requérants de l’ex-URSS a ainsi fait l’objet d’une jurisprudence ancienne, riche et didactique. Par exemple, le Conseil d’État a jugé dans un arrêt Spivak : « Considérant que M., qui possédait la nationalité soviétique avant la dissolution de l’Union des républiques socialistes soviétiques, et qui résidait habituellement en Ouzbékistan, a refusé d'une part de se voir attribuer la nationalité de cette République, en invoquant les risques de persécution qu'il y encourait en sa qualité de russophone, d'autre part d'acquérir par enregistrement la nationalité de la République fédérative de Russie, comme il en avait la possibilité en application de la loi du 28 novembre 1991, modifiée le 28 janvier 1992 ; […] il s'était, sans raison valable, privé de la protection des autorités de la République fédérative de Russie dont il est en droit d'acquérir la nationalité (...) »[12]. La règle est claire : un requérant ne peut refuser de se prévaloir d’une nationalité alors qu’elle lui était accessible de plein droit[13]. Ce même principe a été également établi pour les personnes sollicitant le statut d’apatride[14] ou lorsqu’un requérant peut bénéficier d’une nouvelle nationalité qu’il ne pouvait obtenir lors du départ du pays d’origine[15].
Qu’en est-il des mineurs ? Selon chaque pays, la possibilité, pour chaque parent, d’avoir ou non plus d’une nationalité vient complexifier la détermination de la nationalité d’un mineur. Les textes internationaux[16] et européens[17] s’alignent sur la nécessité de protéger les enfants mineurs au-delà de la situation administrative de leurs parents. Cette exigence appelle une attention toute particulière lorsque les parents d’un enfant invoquent les craintes individuelles qui pèsent sur ce dernier. Comme pour toute demande d’asile, la ou les nationalités de l’enfant doivent être examinées. Distinguons les hypothèses envisageables : les deux parents ont la même nationalité (A), l’enfant bénéficie d’une nationalité que ses parents n’ont pas (B), les parents ont des nationalités différentes (C).
A. Les deux parents ont la ou les mêmes nationalités et aucun des deux ne bénéficie d’une autre nationalité
Bien que certains États imposent quelques restrictions au « droit du sang » ou jus sanguinis, ce principe est très largement reconnu à travers le monde. Lorsqu’il peut être établi que les deux parents d’un enfant ont la ou les mêmes nationalités et qu’aucun des parents ne bénéficie d’une autre nationalité, le raisonnement juridique semble univoque. Leurs enfants bénéficient de cette ou ces mêmes nationalités et il reviendra à l’OFPRA ainsi qu’au juge de l’asile d’examiner les craintes en cas de retour dans le ou les pays correspondants à ces nationalités.
B. L’enfant bénéficie de la nationalité de ses parents ainsi qu’une nationalité que ses parents n’ont pas
Alors qu’un mineur bénéficie de la nationalité de ses parents, il peut aussi bénéficier de la nationalité du pays où il est né. C’est le cas pour les pays où est reconnu le « droit du sol » ou jus soli. Alors que ce droit est omniprésent dans les pays du continent américain, il demeure assez rare sur le continent africain[18]. À titre d’exemple, le code de la nationalité du Tchad prévoit à son article 12 : « Sont Tchadiens : les enfants nés au Tchad de parents étrangers ».
Dans une décision d’octobre 2018, classée C+[19], la CNDA devait statuer sur les craintes personnelles (pour risque d’excision) d’une mineure malienne, de parents maliens, mais possédant également la nationalité du Mozambique, pays à l’égard duquel elle ne faisait valoir aucune crainte. La Cour a considéré que la mineur se trouvait « dans l’impossibilité de se prévaloir de la protection normalement attachée au lien de nationalité qui l’unit à ce pays ». Elle note à cet égard que sa mère, dont elle dépend entièrement, moralement et matériellement, n’a pas vocation à retourner au Mozambique si bien qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir auprès de ces autorités une protection effective pour sa fille. Dès lors que la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 prévoit en son article 9 que « [l]es États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré […]. », il parait logique que soit examinée la manière dont la situation des parents influe sur leur enfant et notamment la possibilité pour les parents d’être légalement admis dans le pays de nationalité de leur enfant. Sans possibilité pour les parents de séjourner dans ce pays, la nationalité du mineur ne trouve en quelque sorte privée d’effet et ne permet pas de conclure en l’absence de craintes au titre de la protection internationale.
Cette solution a toutefois été durcie par le Conseil d’État qui a considéré que, dans une telle hypothèse, la Cour ne peut se contenter de l’absence de nationalité du parent, mais doit rechercher si ce dernier n’était pas tout de même en mesure de séjourner dans le pays[20]. Tirant les conséquences de cette décision, la Cour a eu l’occasion de préciser que « ce n’est qu’en cas d’impossibilité avérée pour les parents de séjourner dans l’autre pays de nationalité de leur enfant mineur, que celui-ci peut être valablement regardé comme étant privé de la protection d’un pays dans lequel il n’est exposé à aucune persécution »[21]. La Cour apprécie donc les démarches entreprises par les parents pour revendiquer leur droit à séjourner dans le pays en tant que parent d’un de ses ressortissants mineur[22]. La solution apparaît ici plus sévère que dans l’hypothèse où l’octroi de la protection internationale est apprécié à titre dérivé, c’est-à-dire en application de l’unité de famille ou de l’extension légale de la protection accordée au parent[23]. Dans une décision du 9 novembre 2021[24], la Cour de Justice de l’Union européenne a en effet considéré que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas « à ce qu’un État membre (…) accorde, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié à l’enfant mineur d’un ressortissant de pays tiers auquel ce statut a été reconnu en application du régime instauré par cette directive, y compris dans le cas où cet enfant est né sur le territoire de cet État membre et possède, par son autre parent, la nationalité d’un autre pays tiers dans lequel il ne risquerait pas de persécution (…) »[25]. Et la Cour de préciser qu’il « [n]’est pas pertinent à cet égard le point de savoir s’il est possible et raisonnablement acceptable, pour ledit enfant et ses parents, de s’installer dans cet autre pays tiers »[26]. On voit ici apparaître une application de la considération primordiale que constitue l’intérêt supérieur de l’enfant[27].
C. Les parents ne bénéficient pas de la même nationalité
Dans le cadre d’un couple dont les membres ne partagent pas la même nationalité, la nationalité de leurs enfants va s’examiner principalement par la combinaison des lois régissant la nationalité de l’enfant dans chacun des pays dont les parents ont la nationalité. La « plurinationalité » est reconnue dans la majorité des États du monde alors que certains pays comme la République populaire de Chine ou le Cameroun interdisent la plurinationalité de jure. Cependant les difficultés administratives entourant la déchéance d’une nationalité font que certaines personnes peuvent se retrouver plurinationales de facto malgré la législation de leur pays de nationalité initial.
Dans le cas où la législation des États dont les parents ont la nationalité n’interdit pas la plurinationalité, la logique juridique veut qu’il appartienne au juge de l’asile d’examiner les craintes en cas de retour dans tous ces pays. Un examen plus approfondi est nécessaire dans le cas où la législation d’un des pays dont les parents ont la nationalité interdit la plurinationalité. Le Conseil d’État est venu se prononcer récemment sur cette question[28]. Un couple composé d’un père ressortissant de la République de Guinée et d’une mère ressortissante de la République démocratique du Congo avait déposé une demande d’asile au nom de leur fille, se prévalant des craintes individuelles que risquait de subir cette dernière. Or, si le Code civil guinéen n’interdit pas la plurinationalité[29], la loi congolaise sur la nationalité dispose que « [l]a nationalité congolaise est une et exclusive »[30].
Rappelant que l’examen de la nationalité doit se faire de jure et non de facto[31], le Conseil d’État a retenu la seule nationalité guinéenne de l’enfant, faisant fis d’éventuels doutes quant à l’existence d’une nationalité congolaise de facto (laquelle est susceptible de se poser si, par exemple, un passeport congolais était tout de même délivré au mineur)[32].
II. La fin de la protection internationale du mineur du fait d’une nationalité lui permettant de réclamer la protection du pays
Le droit applicable aux réfugiés prévoit également l’exclusion[33] ainsi que la cessation[34] du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire. Tandis que l’exclusion du mineur bénéficiaire de la protection internationale est rarement mise en œuvre au regard des hypothèses justifiant cette mesure[35], se pose plus souvent la question de la cessation de la protection internationale dont le bénéfice a été reconnu au mineur. En son article 1C§5, la Convention de Genève prévoit qu’elle cessera de s’appliquer si « les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ». Tel est le cas en cas d’acquisition de la majorité (A). La Convention reconnaît également un cas de cessation lorsque la personne reconnue réfugié « a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité »[36]. Dans le cas de mineur, l’acquisition d’une nouvelle nationalité renvoie généralement à l’hypothèse d’une naturalisation obtenue dans le pays d’accueil (B).
A. L'acquisition de la majorité
Lorsque l’un des éléments ayant présidé à la protection d’un enfant est justement la minorité du requérant et que sa protection a été obtenue par extension de la protection accordée à ses parents, l’accès à la majorité peut justifier une nouvelle analyse du besoin de protection. Lorsque l’un des éléments ayant présidé la protection d’un enfant est la minorité, l’acquisition de la majorité constitue un élément susceptible de remettre en cause son besoin de protection. Tel est le cas lorsque le mineur a obtenu la protection internationale par application du principe de l’unité de famille ou de l’extension de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, le Conseil d’État a jugé que si les principes généraux du droit applicable aux réfugiés (principe de l’unité de famille en l’espèce) « s’appliquent également aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France, ils n’imposent pas que la qualité de réfugié soit reconnue ou maintenue à ces derniers lorsqu’ils sont devenus majeurs à la date à laquelle l’OFPRA se prononce, hormis dans le cas où ils sont à la charge de leurs parents et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à leur vulnérabilité, les mettant dans la dépendance de leurs parents, de nature à justifier l'application à leur profit de ces principes »[37]. La même solution a été retenue pour les mineurs dont les parents sont titulaires de la protection subsidiaire. Ainsi, il a été jugé que « si l’enfant mineur d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, devenu majeur, peut toujours faire valoir des motifs propres pour que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, les dispositions de l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impliquent pas, par elles-mêmes, que le bénéfice de la protection subsidiaire soit maintenu à cet enfant lorsqu’il devient majeur »[38]. L’extension de la protection internationale au mineur apparaît ici comme liée à la seule situation de dépendance de ce dernier à l’égard de son ou ses parents, si bien qu’elle a vocation à cesser lorsque, devenu majeur, il ne peut plus se prévaloir d’une telle situation. Cette « autonomie » vis-à-vis des parents ne fait alors plus obstacle à ce qu’il se réclame de la protection de son pays d’origine dont il est le national.
En pratique, une fois la majorité acquise, l’OFPRA peut ainsi mettre en œuvre la procédure de cessation et examiner le besoin de protection du jeune majeur. Celui-ci peut faire valoir des craintes propres afin d’obtenir une protection à titre « primaire » et non plus dérivé. À l’issue de cet examen, l’Office prend soit une décision maintenant le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire (pour des craintes propres) soit une décision mettant fin à la protection reconnue à titre dérivé. Dans cette dernière hypothèse, le jeune majeur pourra toutefois souvent obtenir un titre de séjour pérenne, dont la durée de validité sera souvent calquée sur la durée du titre de réfugié, eu égard à l’ancienneté et la stabilité de sa résidence en France.
B. La naturalisation
Un mineur réfugié peut être se voir naturalisé de différentes manières : d’une part, par l’acquisition de la nationalité française par l’un de ses parents[39]; d’autre part, en cas de naissance en France, à raison de sa résidence en France[40]. Dans toutes ces situations, l’acquisition de la nationalité française est de nature à s’opposer à la définition du réfugié qui ne peut obtenir ou maintenir cette qualité qu’en dehors du pays dont il a la nationalité. Le Conseil d’État en a récemment tiré les conséquences, considérant que « l’acquisition d’une nouvelle nationalité par une personne ayant la qualité de réfugié constitue un motif légitime de cessation du statut dont il bénéficie »[41], l’étranger pouvant se réclamer de la protection d’un autre pays que son pays d’origine. La haute juridiction distingue deux hypothèses. Dans le cas d’une naturalisation française, cette dernière met fin par elle-même à la protection internationale, sans qu’il soit besoin pour l’OFPRA de prendre une décision. Si l’étranger a acquis, par naturalisation, la nationalité d’un autre État, il revient à l’OFPRA de mettre en œuvre la procédure de cessation prévue à cet effet.
On le voit la qualité de mineur met à l’épreuve la détermination de la nationalité du demandeur d’asile et complexifie l’appréciation de son besoin de protection. Il en va de même, dans la période récente, des aspects procéduraux de la demande d’asile du mineur, lesquels ont fait l’objet d’une jurisprudence récente du Conseil d’État[42].
Notes de bas de page
- [1] Article L. 521-13 du Ceseda : « L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ».
- [2] CE, 19 juillet 2017, n°402476, inédit au recueil : « En se fondant sur ce seul motif pour rejeter la demande de la requérante tendant au bénéfice du statut de réfugié, sans se prononcer sur sa nationalité, ni, en cas de difficulté sérieuse, sans renvoyer la question à l'autorité judiciaire, la cour a commis une erreur de droit ».
- [3] Article 1.A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
- [4] Article L521-13 du Ceseda et voir ainsi CE, 26 mai 2014, n°344265, publié au recueil : « Considérant, d’une part, qu’il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui statue comme juge de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit d’un demandeur d’asile à la qualité de réfugié […] il lui revient le cas échéant, pour déterminer la nationalité d’un demandeur d’asile, d’interpréter les dispositions d’une loi étrangère qui déterminent les règles d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité (…) ».
- [5] Article IV B de l’Acte final de la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le Statut des Réfugiés et des Apatrides : « La Conférence (…) recommande aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour :1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays ;2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la tutelle et l’adoption ».
- [6] CE, 6 décembre 2023, n° 469817, mentionné dans les tables du recueil : « En vertu des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, une personne ayant la même nationalité qu’un réfugié et qui, à la date à laquelle ce dernier a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, doit, sous réserve de l’application des clauses d’exclusion prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se voir reconnaître la qualité de réfugié par l’OFPRA, à condition que ce mariage ou cette liaison n’ait pas cessé à la date à laquelle l’office se prononce. Si ces principes généraux s’appliquent également aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France, ils n’imposent pas que la qualité de réfugié soit reconnue ou maintenue à ces derniers lorsqu’ils sont devenus majeurs à la date à laquelle l’OFPRA se prononce, hormis dans le cas où ils sont à la charge de leurs parents et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à leur vulnérabilité, les mettant dans la dépendance de leurs parents, de nature à justifier l'application à leur profit de ces principes ».
- [7] CE, Ass., 2 décembre 1994, n° 112842, publié au recueil.
- [8] Nous recensons : CE, Ass., 18 avril 1980, n°13914, publié au recueil ; CE, Ass., 16 janvier 1981, n°20527, publié au recueil ; CE, Ass. 2 décembre 1994, n° 112842, publié au recueil ; CE, Ass., 21 décembre 2012, n°332607, publié au recueil ; CE, Ass., 21 décembre 2012, n°332491, publié au recueil ; CE, Ass., 21 décembre 2012, n°332492, publié au recueil ; CE, Ass., 13 novembre 2013, ns°349735, 349736, publié au recueil.
- [9] Article IV B de l’Acte final de la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le Statut des Réfugiés et des Apatrides, op.cit..
- [10] Article 23 de la Directive 2011/95/UE (dite « Qualification ») du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
- [11] Article 1. A. 2. de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; article L. 561-8 du Ceseda ; CE, 21 décembre 2012, n°332491, publié au recueil.
- [12] CE, 2 avril 1997, Spivak, n°160832, mentionné aux tables du recueil.
- [13] CE, 26 mai 2014, n°344265, publié au recueil.
- [14] CE, 27 décembre 2022, n°457625, mentionné dans les tables du recueil : « si M. A... fait valoir qu'il aurait renoncé à cette nationalité, cette renonciation unilatérale ne lui ouvrirait pas, par elle-même, le droit à se voir reconnaître la qualité d'apatride ».
- [15] CE, 13 février 2013, n°355953, inédit au recueil.
- [16] Par exemple, la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
- [17] Par exemple, l’article 7 de la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961.
- [18] B. Manby, Les lois sur la nationalité en Afrique Une étude comparée, New York, Open Society Institute, 2009 : « Les pays qui ont les plus fortes protections contre l’apatridie pour les enfants sont ceux qui suivent le principe du jus soli, octroyant la nationalité à tout enfant né sur leur sol soit automatiquement, soit par option. Peu de pays africains (aujourd’hui seulement la Guinée équatoriale, le Lesotho, le Mozambique, la Tanzanie et le Tchad) fondent leur loi sur le jus soli en premier lieu (à l’exception des enfants de diplomates ou de représentants d’États) ».
- [19] CNDA, 19 octobre 2018, n°18002145 C+.
- [20] CE, 13 mars 2020, n°426701, inédit au recueil : « Pour reconnaître la qualité de réfugiées aux enfants mineures de Mme, la Cour nationale du droit d’asile s’est fondée sur le fait que, bien que possédant la nationalité canadienne, pays à l’égard duquel elles ne faisaient état d’aucune crainte, elles ne pouvaient pas se prévaloir de la protection de ce pays. Pour ce faire, elle s’est bornée à relever que leur mère, qui n’a pas la nationalité canadienne, n’avait pas “vocation à retourner » dans ce pays. En statuant ainsi, sans rechercher s’il était établi que cette dernière n’était pas en mesure d’y séjourner, la Cour a commis une erreur de droit ».
- [21] CNDA, 15 mai 2023, n°23005029.
- [22] Voir par exemple, CNDA, 8 avril 2022, n°20015144, 20015145 et 20015146 (statuant sur renvoi du Conseil d’Etat) : « Si Mme B. soutient que la protection dont bénéficieraient ainsi ses filles au Canada est néanmoins privée d’effectivité du fait de son impossibilité de séjourner avec elles dans ce pays, elle se borne à produire une décision de refus du 29 mars 2017 que les autorités canadiennes ont opposé à sa demande de délivrance d’un visa de résident temporaire, sans justifier d’aucune autre démarche qu’elle aurait accomplie depuis pour revendiquer son droit à séjourner au Canada en tant que mère d’enfants canadiens. Dans ces conditions, Mme B., qui a exprimé lors de l’audience son souhait de rester en France ainsi que les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas s’installer au Canada, ne justifie pas être dans l’impossibilité de séjourner régulièrement dans ce dernier pays. Il s’ensuit que Mmes B., en tant que ressortissantes canadiennes, ne peuvent prétendre, en leur nom propre, au bénéfice d’une protection internationale, laquelle revêt un caractère subsidiaire à la protection octroyée par l’Etat dont elles ont la nationalité ».
- [23] Article L. 531-23 du Ceseda : « Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire » et en ce sens, voir CE, 21 janvier 2021, n°439248, mentionné dans les tables du recueil ; CE, 19 novembre 2021, n°449686, inédit au recueil ; CE, 23 septembre 2022, n°455233, inédit au recueil.
- [24] CJUE, 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland, affaire C-91/20.
- [25] Ibidem, §62.
- [26] Eod. loc.
- [27] Article 3§1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
- [28] CE, 16 février 2024, n°468454, inédit au recueil.
- [29] Article 106 du Code civil de la République de Guinée : « Toute personne majeure de nationalité guinéenne résidant habituellement à l'étranger qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité guinéenne que si elle le déclare expressément dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants du présent code ».
- [30] Article 1 de la Loi n°87.010 du 1er août 1987 portant Code de la famille de la République Démocratique du Congo.
- [31] CE, 26 mai 2014, n°344265, publié au recueil.
- [32] CE, 16 février 2024, n°468454, op.cit. « Il résulte ensuite des énonciations de sa décision qu’après avoir relevé que l’enfant mineure, dont le père est guinéen, se présentait comme guinéenne et qu’elle pouvait éprouver des craintes fondées en cas de retour en République de Guinée du fait de son appartenance au groupe social des enfants et femmes non mutilés en Guinée, la Cour nationale du droit d’asile a retenu que sa mère étant congolaise, ses parents n’établissaient pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se prévaloir de la nationalité congolaise, et que ses craintes n’étaient pas établies en cas de retour en République démocratique du Congo. 6. Par suite, en jugeant que les parents de la requérante n’établissaient pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se prévaloir de la nationalité congolaise, alors qu’il ressortait de la combinaison des textes applicables qu’elle avait cités ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il était impossible, dès lors que la nationalité guinéenne de l’enfant était établie, qu’elle puisse également avoir la nationalité congolaise, la Cour nationale du droit d’asile a entaché sa décision d’une erreur de droit ».
- [33] Article 1F de la Convention de Genève, Articles L. 511-6 (statut de réfugié) et L. 512-1 (protection subsidiaire) du Ceseda.
- [34] Article 1C de la Convention de Genève, Articles L. 511-8 (statut de réfugié) et L. 512-3 (protection subsidiaire) du Ceseda.
- [35] V. par exemple, CE, 7 avril 2010, ns°319840, 327959, publié au recueil.
- [36] Article 1.C.3 de la Convention de Genève.
- [37] CE, 6 décembre 2023, n°469817, mentionné dans les tables du recueil.
- [38] CE, 17 juin 2024, n°488447, mentionné dans les tables du recueil.
- [39] Article 22-1 du Code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ».
- [40] Articles 21-11 (« L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3 ») et 21-7 du Code civil (« Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans »).
- [41] CE, 1er juillet 2020, n°423272, publié au recueil Lebon.
- [42] CE, 27 novembre 2023, n°472147, mentionné dans les tables du recueil. V. L. MAZE, « Le mineur accompagné : pars viscerum matris ou demandeur d’asile à part entière ? À propos de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 27 novembre 2023 dans l’affaire “enfant N. S. ” », BPDA, ce numéro.