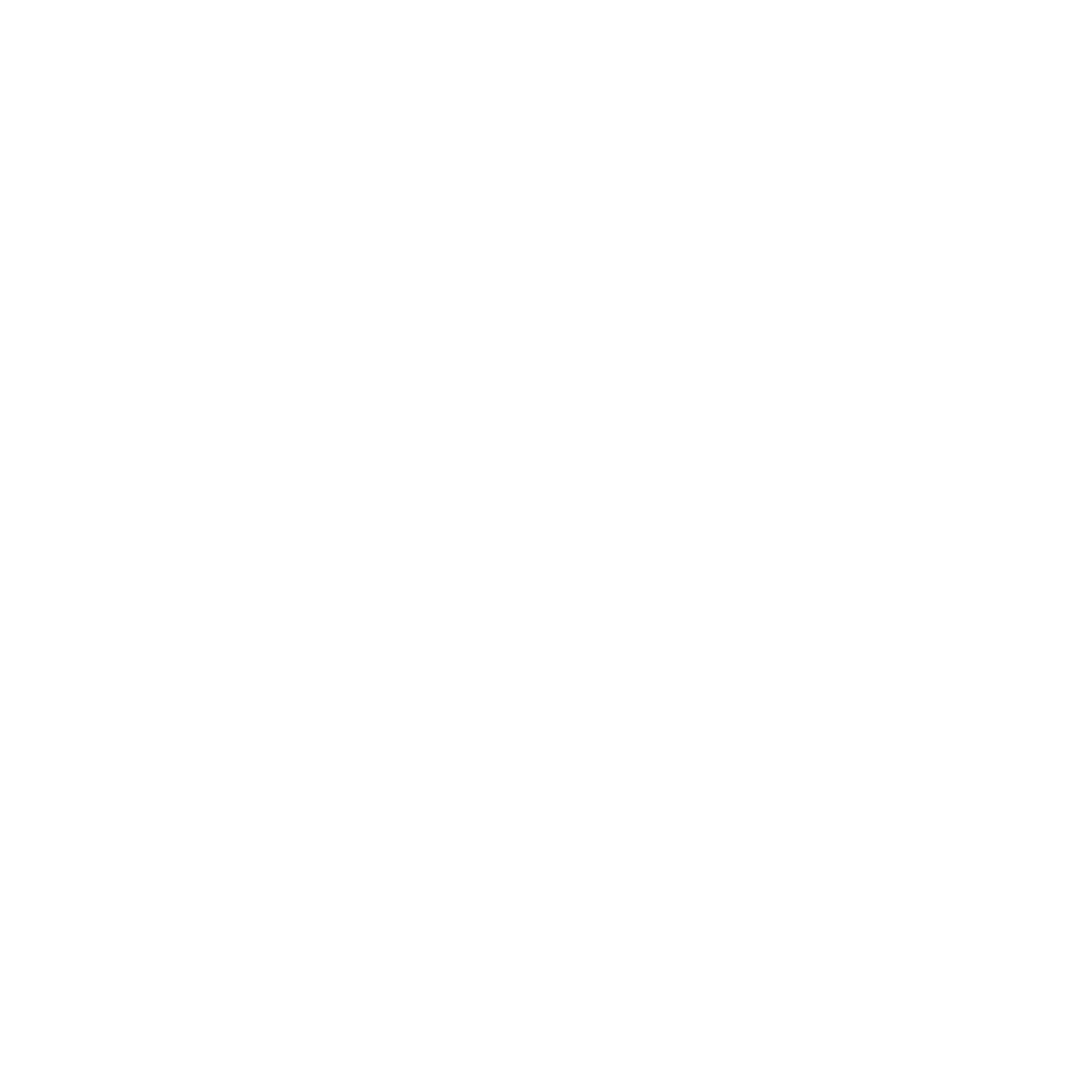L’accord entre Rome et Tirana a été signé le 6 novembre 2023 par la Présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni et par le Premier ministre albanais Edi Rama[1]. Le texte régit l’usage italien de deux centres situés en Albanie – l’un à Shengjin, l’autre à Gjader –, chacun d’une capacité respective de 1500 places[2]. S’ils peuvent « accueillir » et retenir en leur sein jusqu’à 36 000 personnes par an selon les estimations italiennes, ils sont quasiment vides depuis des mois.
Ces centres fermés sont dédiés au « filtrage » des demandeurs d’asile secourus par les garde-côtes italiens dans les eaux internationales et à leur « accueil » le temps de l’examen de leur demande en procédure frontalière par les autorités italiennes, pour peu qu’ils proviennent d’un pays réputé « sûr »[3].
La gestion italienne de ces centres albanais est inédite au sein de l’Union européenne (ci-après « UE »). En effet, ils ne sont pas seulement délocalisés à l’extérieur de l’Italie mais bien extra-territorialisés, c’est-à-dire que le droit italien est censé s’y appliquer au terme du Protocole. Ainsi, l’Albanie renonce à sa souveraineté sur cette partie de son territoire en échange de rémunération. L’accord a par conséquent été érigé en modèle par la Commission européenne qui souhaite s’en inspirer pour extra-territorialiser les contrôles des ressortissants étrangers aux frontières. Outre la difficulté à trouver des pays tiers prêts à concéder une part de leur souveraineté territoriale, le fait qu’aucun Etat membre n’ait jamais usé de tels centres délocalisés s’explique par leur encadrement juridique progressif à l’échelle européenne.
En effet, le Protocole Italo-Albanais (ci-après « Protocole »)[4] s’apparente à la première concrétisation du Pacte européen sur l’asile et la migration (ci-après « Pacte ») dont il anticipe l’entrée en vigueur – prévue pour juin 2026. Ce Pacte est composé de dix directives et règlements – ces derniers ne nécessitant pas de transposition nationale et étant d’effet direct – abrogeant en partie les textes sur lesquels reposait jusqu’à présent le Régime d’Asile Européen Commun. L’articulation des règlements « Filtrage »[5], « Procédure »[6] et « Retour »[7] dévoile la mise en place d’un système sans faille entre toutes les étapes du processus migratoire, de l’arrivée du demandeur d’asile au traitement de sa demande – potentiellement à la frontière – jusqu’à, le cas échéant, sa potentielle expulsion. Par sans faille, il faut entendre une continuité de la rétention aux frontières extérieures des personnes concernées. La rétention tend en effet à devenir la norme : les nouvelles procédures de filtrage, d’asile et de retour réalisées de manière accélérée permettent la rétention aux frontières des intéressés, pour n’admettre sur le territoire européen qu’une minorité d’étrangers dûment sélectionnés.
La généralisation de l’enfermement s’illustre en Albanie par la rétention des demandeurs d’asile dès leur arrivée à la frontière extérieure de l’Union le temps qu’ils soient soumis à des contrôles pendant lesquels ils ne sont pas admis sur le territoire européen (I). Ensuite, ils peuvent être retenus au cours de l’instruction de leur demande de protection (II). En outre, s’ils sont déboutés, ils sont placés simultanément en procédure de retour à la frontière qui permet également le prolongement de leur retenue administrative. Or, une telle rétention doit nécessairement faire l’objet d’un contrôle judiciaire effectif du juge italien de l’asile et de la rétention administrative, garant des droits fondamentaux des personnes concernées. Son office est pourtant restreint en pratique par l’intervention du législateur italien, suite aux décisions judiciaires qui ont limité l’application de ce Protocole (III).
I. L’extension du recours à la rétention des ressortissants étrangers aux frontières européennes
La rétention administrative des ressortissants étrangers, telle que prévue dans les centres albanais, est érigée en norme par les dispositions du Pacte (A) et repose sur la fiction de leur « non entrée » sur le territoire européen (B).
A. La rétention prolongée des demandeurs d’asile aux frontières européennes
Le Protocole est peu détaillé quant aux formalités d’usage des deux centres albanais et la loi italienne en portant ratification[8] renvoie largement aux dispositions pertinentes du droit italien et de l’Union européenne, en anticipant les dispositions du Pacte qui entreront en vigueur en juin 2026. Ainsi, il s’agit à Shengjin d’un centre dans lequel est effectuée une activité de filtrage sur le modèle des hotspots présents sur le territoire italien, au sein duquel se trouve un centre d’accueil pour demandeurs d'asile relevant des procédures frontalières, tandis qu’à Gjäder, le centre est pensé sur le modèle des Centres de Permanence pour le Rapatriement (ci-après « CPR », équivalent aux centres de rétention administrative français).
Il est prévu par la loi de ratification italienne que les procédures de filtrage, d’examen de demande d’asile accéléré et d’expulsion des ressortissants étrangers peuvent avoir lieu dans les centres albanais, qui sont jusqu’à présent régis par les directives « Procédures »[9] et « Retour »[10]. Or, ces procédures seront au futur encadrées par le Pacte européen, moins protecteur des droits fondamentaux des personnes en migration et dont la loi italienne de transposition du Protocole anticipe les dispositions.
Ainsi, le règlement « Filtrage » du Pacte exige que les personnes étrangères soient soumises à des contrôles de santé, d’identité et de sécurité effectués par les autorités qui les ont appréhendées lors du franchissement des frontières[11]. Afin de rester à leur « disposition »[12], elles peuvent être retenues pendant sept jours dans les « zones frontalières », auxquelles est assimilée l’enclave albanaise[13]. Suite au remplissage d’un formulaire par les autorités étatiques ayant procédé à ces contrôles, les personnes « filtrées » doivent être dirigées vers la procédure qui leur est appropriée. En cas de demande de protection internationale, l’étranger ainsi « filtré » peut être placé en procédure d’asile normale ou accélérée – supposant son admission sur le territoire de l’État membre compétent – ou bien, plus probablement, en procédure d’asile accélérée à la frontière[14].
Or, la mise en œuvre d’une telle procédure conduit au maintien du demandeur dans le centre albanais de Shengjin le temps de l’examen de sa demande – dans une limite de douze semaines – et, s’il est débouté à terme, à son placement en procédure de retour dans le centre de Gjäder – également pour une durée maximale de douze semaines. En effet, le Pacte prévoit qu’en cas de rejet de la demande de protection – qu’elle soit considérée comme irrecevable ou infondée – une décision d'éloignement du territoire est simultanément adoptée et reconnue par l’ensemble des États membres. Ainsi, après avoir été placés en procédure d’asile à la frontière, les demandeurs d’asile se voient appliquer la procédure de retour dès lors que leur demande d’asile – présentée à la frontière – est rejetée. Cette articulation des procédures a pour conséquence le maintien à la frontière des demandeurs d’asile pour une durée maximale de vingt-cinq semaines - une semaine puis deux fois douze semaines possiblement cumulées - afin d’organiser leur renvoi vers un pays tiers, puisqu’ils doivent en pratique demeurer à disposition des autorités.
En effet, en cas d’éloignement volontaire du centre albanais, le risque de « fuite » sera réputé caractérisé (article 2 paragraphe 12 du règlement « Procédure ») et justifiera leur maintien en rétention administrative. Il pourrait même l’être en cas d’absence d'adresse fixe dans l’État membre, ce qui concerne a priori tous les demandeurs d’asile déboutés retenus aux frontières. De surcroît, le Pacte prévoit que la rétention devienne obligatoire chaque fois qu’un demandeur débouté « ne coopérerait pas de bonne foi avec les autorités chargées de la mise en œuvre de son retour », qu’il « risquerait de fuir » dans un autre État membre, ou bien que sa « présence représenterait un risque pour la sécurité » de l’État membre[15].
En somme, les hypothèses de privation de liberté sont largement étendues. La rétention des personnes étrangères aux frontières, qui a été largement utilisée par les États de première entrée dans les pratiques informelles régissant les « hotspots » depuis 2015[16], est désormais systématisée en pratique et devient encadrée par le Pacte, même à l’égard des demandeurs d’asile.
Or, à l’égard de la rétention que permet notamment la mobilisation de ces procédures frontalières, le Conseil européen proposait que des centres fermés puissent être destinés à un seul de ces usages (« single purpose centre »), nécessitant le transfert des personnes d’un centre à l’autre selon que la personne fasse l’objet d’un « filtrage », soit « demandeuse d’asile » à la frontière ou en cours de « rapatriement » ; ou bien qu’un même centre fermé puisse combiner les trois fonctions simultanément (« multipurposes centres »)[17]. Par conséquent, il est possible de moduler l’utilisation des centres fermés en fonction des besoins des États, et c’est ce dont s’est emparé l’Italie avec les centres albanais.
Ainsi, les demandeurs d’asile arrivés par voie maritime en Albanie, « filtrés » puis déboutés de leur demande de protection, pourraient être maintenus dans ces mêmes centres albanais. Or, les demandeurs d’asile perdent une chance de se voir octroyer le statut de réfugié lorsqu’ils sont placés en procédure accélérée à la frontière, augmentant la probabilité de leur expulsion[18].
De plus, le gouvernement a décidé que les centres pouvaient également être affectés à la rétention des ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure de « retour » et détenus dans des CPR sur le territoire italien par l’adoption du décret-loi 37/2025[19] modifiant la loi italienne de ratification du Protocole et qualifiant le centre de Gjäder mais aussi celui de Shengjin de CPR. Dès lors, tant les demandeurs d’asile déboutés en Albanie que ceux qui l’ont été en Italie peuvent en théorie être transférés et maintenus dans les centres albanais en vue de leur expulsion prévue par les autorités italiennes.
Les droits fondamentaux des demandeurs d’asile, qu’ils soient ou non déboutés, sont manifestement restreints par ces procédures expéditives fondant leur rétention administrative, et a fortiori lorsqu’ils sont théoriquement considérés en dehors du territoire européen.
B. Les fictions juridiques mobilisées par le gouvernement italien pour justifier l’usage des centres albanais
Pour que la personne retenue dans ces zones frontalières puisse se prévaloir des droits consacrés par une convention à laquelle un État membre est partie, il lui faut démontrer un lien juridique avec celui-ci. En théorie, le Protocole italo-albanais repose sur une fiction d’extra-territorialité en prévoyant que la juridiction territoriale italienne est étendue à ces centres (articles 9 et 10). Si l'applicabilité du régime d’asile italien est limitée par l’article 10 de la Constitution « au territoire de la République », cette disposition doit néanmoins être interprétée comme signifiant le lieu où s'exerce la juridiction italienne, incluant par conséquent les centres albanais[20].
En outre, quelle que soit la personne retenue au sein d’un de ces centres délocalisés, elle est a priori titulaire des droits consacrés à l’échelle de l’UE - voire les droits de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après « CEDH ») en vertu de l’interprétation de son article premier sur l’étendue de la juridiction opérée par la Cour européenne des droits de l’Homme[21] - si tant est que celle de l’Italie y soit réellement applicable.
L’article 4 de la loi portant ratification du Protocole prévoit à cet égard que les personnes retenues en Albanie peuvent invoquer l’ensemble de l’acquis communautaire régissant l’entrée, le séjour et l’accès à la protection internationale des ressortissants étrangers dans l’UE « dans la mesure où il est compatible » avec le Protocole. Or, l’on discerne mal dans quelles hypothèses il ne le serait pas puisqu’il se réfère à de nombreuses reprises aux textes européens. En ce sens, l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE précise qu’elle s'applique aux actes des États membres lorsqu'ils agissent dans le cadre du droit de l'Union et ce, même en collaboration avec un pays tiers sur le territoire de celui-ci. Considérant que ces centres fermés sont visés par le Pacte pour la mise en œuvre des procédures frontalières qu’il prévoit, leur usage est indissociable de la mise en œuvre des politiques communes européennes en matière de migration. Par suite, les personnes retenues dans les centres albanais, si elles sont considérées sujets du droit italien en vertu de la fiction d’extra-territorialisation, peuvent a priori se prévaloir de la protection contre le refoulement ou toute autre violation de leurs droits qui sont consacrés par la Charte de l’UE, à laquelle est partie l’Italie.
Pourtant, une deuxième difficulté théorique doit être surmontée s’agissant de l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et de la CEDH aux personnes retenues dans les centres albanais. En effet, le régime dérogatoire[22] des zones frontalières dans lesquelles sont situés les centres fermés repose sur la disjonction entre la présence physique des ressortissants étrangers qui y sont maintenus et leur admission légale sur le territoire par les autorités étatiques. Bien que la fiction de leur « non entrée » ne soit pas précisée par le Pacte[23], cette fictio iuris est la pierre angulaire de l’articulation des procédures frontalières. En effet, l’excision théorique du territoire souverain permet de restreindre la compétence de l’État aux seules personnes qui sont effectivement admises sur son territoire[24]. Ainsi, l’extranéité du ressortissant dépourvu du droit d’entrer ou de séjourner dans l’espace Schengen adhère à sa personne et, même s’il est transféré temporairement à l'intérieur du territoire de l’État membre, il demeure « non entré » tant qu’il n’y est pas formellement admis par les autorités. Il est d’ailleurs prévu que les demandeurs d’asile retenus en Albanie ne reçoivent qu’un certificat d’identification, et non le titre de séjour spécifique prévu par la législation italienne pour les demandeurs d’asile admis sur son territoire et qui permet leur libre circulation. Par conséquent, même si la juridiction italienne s’étendait à cette enclave extraterritoriale, les personnes qui y sont retenues demeurent non admises légalement sur le territoire européen, et sont soumises à un régime juridique dérogatoire au droit commun. En raison de la mobilisation de ces fictions juridiques peu définies tant par le Pacte que par le Protocole, force est de constater que les personnes retenues au sein de ces frontières européennes extensibles pourraient rencontrer des difficultés pour faire utilement valoir leurs droits fondamentaux.
Or, les États membres ont l’obligation de veiller à ce que les demandeurs d'asile puissent demeurer sur leur territoire le temps nécessaire au traitement de leur demande. La question sous-jacente consiste à savoir si la fiction d’extraterritorialité des centres albanais suffit à les considérer comme une partie d’un territoire étranger sur laquelle la souveraineté italienne s’exerce réellement. En ce sens, le 19 avril 2025, la Cour d’appel de Rome a considéré que toute personne retenue dans ces centres devrait être admise sur le territoire italien – entendu comme la péninsule continentale à l’exclusion de l’enclave albanaise - dès lors qu’elle demande l’asile en vertu de l’article 9 de la directive « Procédures ». De plus, lors des rares opérations d’expulsions des étrangers transférés dans les centres albanais vers leurs pays d’origine, ils ont systématiquement été préalablement reconduits en Italie puisque la directive « Retour » exige que les mesures d’éloignement en « exécution de l’obligation de retour » soient effectuées par le « transfert physique hors de l’État membre », c’est-à-dire depuis celui-ci (Article 3 paragraphe 5). Ainsi, l’extension fictive du territoire italien aux centres albanais semble insuffisante à garantir cette condition territoriale contenue dans la directive en vigueur, et fait obstacle à l’usage des centres en CPR.
Pour toutes ces raisons, le maintien en rétention d’un demandeur de protection internationale – en l’occurrence dans les centres albanais – doit demeurer exceptionnel. En théorie, selon le Pacte, il ne peut être justifié que par son placement en procédure d’asile accélérée à la frontière, dont c’est la condition sine qua non. Or, l’examen accéléré et frontalier d’une demande de protection internationale pourrait se systématiser par l’instauration de nouvelles hypothèses – prévues par l’article 43 du Règlement « Procédures » du Pacte - le permettant, normalisant l’usage de cette procédure jusqu’à présent exceptionnelle.
II. L’élargissement du recours aux procédures frontalières permettant la rétention des demandeurs d’asile dans les centres albanais
Le Pacte étend les possibilités de rétention aux frontières des demandeurs d’asile, ce dont l’Italie s’empare avec la mise en place de ces centres délocalisés. En effet, la procédure d’asile accélérée à la frontière, qui implique la rétention des demandeurs de protection, devient obligatoire dans dix hypothèses. Ainsi, le placement en procédure accélérée à la frontière du demandeur pourra être justifié par son origine d’un pays considéré « sûr » (A) ou selon diverses hypothèses introduites par le Règlement Procédure, conduisant à l’irrecevabilité de sa demande (B).
A. L’origine du pays sûr comme condition obligatoire au placement en procédure accélérée à la frontière italienne
S’agissant de l’applicabilité d’une procédure d’asile accélérée à la frontière en Italie, le décret-loi Cutro de 2023[25] prévoit que la demande de protection doit avoir été introduite dans les « zones frontalières » par une personne appréhendée pour s’être soustraite aux contrôles aux frontières ou par un demandeur provenant d’un pays d’origine considéré « sûr »[26].
Les centres albanais étant situés dans une zone considérée « frontalière », la difficulté concerne plutôt l’appréciation de la condition personnelle du demandeur d’asile. La seule hypothèse à être pour l’instant prévue par le droit italien – c’est-à-dire par le décret-loi Cutro auquel le Protocole se réfère – concerne les demandes de protection émanant de ressortissants de pays considérés « sûrs », c’est-à-dire de pays dont le taux de protection à l’échelle de l’UE est inférieur à 20 % – ou à 50 % en situation de « crise migratoire ». En effet, les ressortissants de ces pays « sûrs » sont présumés ne pas y être persécutés et à ce titre, pouvoir y vivre en sécurité sans nécessiter la reconnaissance d’une protection qui pourrait leur être accordée à l’étranger.
Le 18 octobre 2024, la section spécialisée du tribunal de Rome, compétente pour les centres albanais, a annulé la rétention des 12 premières personnes à y avoir été transférées[27]. Après avoir relevé l’incompatibilité évidente entre le sauvetage en mer réalisé par les garde-côtes italiens et la notion de « soustraction aux contrôles aux frontières » qui ne saurait être retenue à l’encontre des rescapés, les juges ont ensuite estimé que l’appréciation italienne des pays d’origine « sûrs » n’était pas conforme à la directive « Procédures ».
En effet, telle qu’interprétée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») du 4 octobre 2024[28], la présomption d’être en sécurité dans son pays d’origine peut être renversée dès lors que le demandeur « invoque » des circonstances particulières. Or, le décret n°25/2008 prévoit que la présomption n’est renversée que lorsque le demandeur « démontre des raisons impérieuses de nature à présumer sa mise en danger en cas de retour », et non pas qu’il invoque des « raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle » tel que prévu par la directive « Procédures » de 2013.
Par ailleurs, la liste italienne comportait des pays qui n’étaient considérés que partiellement sûrs, c’est-à-dire qu’ils ne l’étaient que pour certaines catégories de personnes, tandis qu’ils doivent l’être pour toute personne en vertu de ladite directive. Par suite, les juridictions italiennes ont transmis des questions préjudicielles à l’égard de cette divergence d’interprétation et, dans l’attente de la décision de la CJUE, ont annulé les premières rétentions de ressortissants étrangers – respectivement égyptiens et bangladais – dans les centres albanais[29]. Cette difficulté a été contournée par l’adoption d’une nouvelle liste de 19 pays d’origine entièrement « sûrs »[30] le 24 octobre 2024. Mais les attaques politiques à l’encontre du Protocole persistent tout comme les contestations juridiques. Ainsi, le 31 janvier 2025, la chambre pénale de la Cour d’appel de Rome a de nouveau invalidé la rétention de 43 demandeurs d’asile qui avaient été secourus puis transférés vers les centres albanais, renvoyant l’affaire devant la CJUE dans l’attente d’une clarification de la notion de pays d’origine « sûr »[31]. Pour les mêmes raisons, tandis que les autorités italiennes avaient tenté pour la troisième reprise de transférer 49 demandeurs d’asile originaires d’Égypte, du Bangladesh, de Côte d’Ivoire et du Ghana le 28 janvier 2025, la Cour d’appel de Rome avait exigé leur retour en Italie par une ordonnance du 31 janvier 2025[32].
Néanmoins, avec l’entrée en vigueur du Pacte, le concept de pays d'origine sûr sera régi par l'article 61 du nouveau règlement « Procédure » qui prévoit expressément la possibilité de désigner un pays d'origine comme « sûr » en prévoyant des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables. Cette interprétation – large – de la notion de pays sûr pourrait d’ailleurs trouver à s’appliquer avant l’entrée en vigueur du Pacte en juin 2026, alors même que la directive de 2013 a expressément abrogé cette possibilité initialement prévue par la directive de 2005 et que la CJUE a estimé dans sa décision du 4 octobre 2024 précitée que la désignation d’un « pays d’origine sûr » devait s’appliquer sur l’ensemble du territoire étatique et pour toute personne.
La CJUE a réaffirmé sa position par son arrêt du 1er août 2025 relative aux affaires jointes C-758/24 et C-759/24 alors qu’elle était saisie par le tribunal ordinaire de Rome de deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 36 à 38 de la directive « Procédures » de 2013. En l’espèce, après avoir été secourus en Méditerranée par les autorités italiennes, deux ressortissants bangladais ont été transférés dans le centre de Shengjin en Albanie où ils ont chacun déposé une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes le 16 octobre 2024. Le lendemain, la Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale de Rome – compétente pour les procédures accélérées dans les centres albanais – a rejeté ces demandes comme manifestement non fondées, au motif que les requérants étaient originaires d’un pays d’origine considéré sûr par l’Italie. Toutefois, les décisions de leur placement en rétention en Albanie ont été censurées par la section spécialisée du tribunal de Rome, qui a remis en question la présomption de « sûreté » du Bangladesh comme pays d’origine – partiellement – sûr et par suite le fondement de leur placement en procédure accélérée à la frontière. Dans son arrêt, la CJUE a apporté d’utiles précisions sur la désignation d’un pays « sûr » au sens de la directive de 2013[33]. D’une part, cette désignation peut être effectuée par un acte législatif, à condition que celui-ci puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif et que les sources d’information ayant fondé cette désignation soient accessibles au demandeur et au juge national. D’autre part, un État membre ne peut inclure un pays dans la liste des pays d’origine sûrs si celui-ci n’offre pas une protection suffisante à toute sa population et sur l’ensemble de son territoire conformément au droit en vigueur.
L’interprétation italienne, manifestement contraire au droit applicable tel qu’interprété par la CJUE, trouvera un fondement légal avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement « Procédure ». En effet, celui-ci prévoit spécifiquement que les États membres puissent intégrer dans leur liste de pays d’origine sûrs des pays qui sont présumés l’être à l’exception d’une catégorie de personnes ou d’une portion de leur territoire. En ce sens, la Commission européenne a d’ores et déjà proposé le 16 avril 2025 une liste de pays d’origine sûrs dans laquelle sont inscrits des pays qui ne le sont pas « entièrement », comme le Bangladesh, la Colombie, l’Égypte, l’Inde, le Kosovo, le Maroc et la Tunisie. Enfin, malgré ces deux arrêts de la CJUE interprétés par la presse transalpine comme un coup d’arrêt – bien que temporaire puisque limité à l’entrée en vigueur du Pacte dans moins d’un an – au projet de Meloni, les expulsions de l'Italie vers l'Albanie se poursuivent puisque les autorités ont préalablement élargi l’usage des centres albanais à des CPR.
Ainsi, si les vœux du gouvernement de Meloni ont jusqu’à présent été entravés par des décisions judiciaires qui se réfèrent au cadre juridique applicable, il est probable qu’ils soient exaucés avec l’entrée en vigueur du Pacte. En effet, ses dispositions permettent largement la rétention des demandeurs de protection en ouvrant la notion de pays d’origine sûrs.
B. Les nouvelles hypothèses de placement en procédure accélérée à la frontière permettant la rétention des demandeurs d’asile
La procédure d’asile accélérée à la frontière est également obligatoire dans d’autres hypothèses. Conformément à la directive de 2013, tel est le cas lorsqu’un demandeur a délibérément induit les autorités en erreur – en détruisant des documents d’identité ou de voyage – ou lorsque le demandeur est considéré comme une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public.
Le décret-loi portant sur le contrôle des flux migratoires pour l’année 2025 – dit Flussi – du 9 décembre 2024[34] a introduit une extension des motifs de placement en procédure accélérée d’asile à la frontière. Un refus du demandeur de protection de se soumettre à des relevés photographiques et signalétiques est susceptible de fonder son placement en procédure d’asile accélérée à la frontière et, par conséquent, sa rétention, comme le prévoyait déjà la directive de 2013. Une ultime catégorie de demandeurs de protection pourrait être systématiquement retenue aux frontières. En effet, l’article 59.2 du chapitre V du futur règlement « Procédure » étend la notion de « pays tiers sûrs » en prévoyant, comme pour celle de « pays d’origine sûrs », que les États puissent prévoir des exceptions – pour des parties de son territoire ou des catégories de personnes – lorsqu’ils désignent un tel pays.
Jusqu’à présent, le qualificatif de pays tiers sûr n’avait d’influence sur la demande d’asile des ressortissants étrangers que s’il existait un « lien de connexion sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays ». Dans ce cas, la demande d’asile est déclarée irrecevable et rejetée sans examen au fond. Or, la nature d’un tel lien avec le pays tiers n’est pas définie et laisse aux États membres une marge d'appréciation pour déterminer les critères le caractérisant, comme la présence de membres de la famille ou le fait que le demandeur y ait déjà résidé. La Cour de justice avait tout de même considéré dans l'affaire C-564/18 du 19 mars 2020 que seule la résidence, et non un séjour de courte durée, permettait d’établir ce lien entre le requérant et le pays tiers[35]. Cependant, la Commission a proposé le 20 mai dernier[36] que puisse être déclarée irrecevable toute demande d’asile émanant d’une personne ayant transité par un « pays tiers sûr ». Le simple « transit » suffirait désormais à caractériser ce « lien » avec le pays tiers, et à l’y expulser.
Plus encore, la Commission souhaite que les États membres puissent à l’avenir déclarer irrecevable toute demande d’asile dès lors qu’il existe un arrangement avec un pays tiers considéré sûr susceptible de procéder à son examen au fond, en lieu et place de l’État membre dans lequel elle a été introduite. Ainsi, les demandeurs pourraient également être renvoyés vers un « pays tiers sûr » avec lequel ils n’ont jamais eu aucun lien, si tant est qu’un accord bilatéral ait été conclu à cet effet et que ce pays tiers soit susceptible de leur accorder une « protection effective ». Or, le seuil exigé n’équivaut plus à la protection « internationale » au sens de la Convention de Genève, mais à une protection bien moindre qui n’est pas conventionnellement encadrée et dont l’effectivité est entendue par l’article 57 du règlement « Procédure » comme un faisceau d’indices[37]. La possibilité de ce transfert serait de nature à fonder l’irrecevabilité de la demande d’asile à condition que le demandeur soit effectivement (ré)admis dans le pays tiers. Si cette seconde mesure devait être adoptée, l’externalisation des procédures d’asile changerait de paradigme puisque les États membres pourraient se soustraire à leur responsabilité – d’examen des demandes de protection – par la seule conclusion d’un arrangement dédié avec un pays tiers. Or, celui-ci statuerait sur la demande d’asile en application de son droit national, c’est-à-dire en dehors du cadre juridique européen et des garanties associées.
Les notions de pays d’origine sûr et de pays tiers sûr sont donc complémentaires et leur articulation est susceptible d’instaurer un dispositif de rétention et d’expulsion de tout demandeur de protection se présentant aux frontières européennes. Le Pacte élimine ainsi la distinction qui prévalait jusqu’alors dans le droit international et européen entre les personnes en quête de protection internationale et les autres ressortissants étrangers. En effet, en tant que catégorie particulièrement vulnérable, les réfugiés devraient bénéficier d’une protection particulière telle que consacrée par la Convention des Nations Unies de 1951 et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[38], que l’on pourrait considérer étendue à la procédure de reconnaissance du statut.
À présent, les personnes sollicitant l’asile risquent de perdre ce statut protecteur et de devenir expulsables vers leur pays d’origine s’il est considéré « sûr », ou vers tout autre pays tiers susceptible de leur octroyer une « protection », aussi amoindrie soit-elle. La mobilisation de ces notions conduit in fine à l’inclusion des demandeurs d’asile dans la catégorie indifférenciée des personnes présumées « indésirables »[39] et dont l’extranéité suffit à justifier leur non admission sur le territoire de l’Union. Dès lors, si les États européens sont libres d’adopter leur propre liste de pays tiers avec lesquels ils passeraient ces accords de (ré)admission, qui pourrait encore se prévaloir de la protection du régime d’asile européen ?
Or, l’on peut se demander si le Protocole ne pourrait pas être entendu comme un de ces accords bilatéraux envisagés par la Commission, et ainsi permettre à l’Italie de transférer la responsabilité du traitement de la demande d’asile aux autorités albanaises. Bien que cela ne soit pour le moment pas prévu par le texte du Protocole, celui-ci pourrait être modifié en ce sens avec l’entrée en vigueur du Pacte en juin 2026, tel qu’envisagé par le gouvernement Meloni. En effet, le transfert de la juridiction sur les centres aux pays tiers sur le territoire desquels ils sont construits est prévu par le Règlement Retour du Pacte, qui le conditionne seulement à l’insertion de solides garanties des droits fondamentaux au sein des accords régissant ces centres délocalisés. Par conséquent, il est possible que les centres de Shengjin et de Gjäder soient confiés à l’Albanie dans le futur[40].
D’ici juin 2026, et conformément aux directives européennes en vigueur, le rejet d'une demande de protection et le placement en procédure de retour – impliquant la rétention de l’intéressé - à la frontière doivent toujours être précédés d’une évaluation individuelle de la situation du demandeur par un juge, auquel l’accès est entravé depuis les centres albanais.
III. La violation potentielle des droits fondamentaux des étrangers retenus dans ces centres extraterritoriaux
Une des questions qui se pose avec le plus d’acuité s’agissant de ces modèles délocalisés concerne l’effectivité du contrôle juridictionnel. En effet, l’éloignement physique des demandeurs d’asile du territoire italien se double de leur maintien à l’écart de son système juridique. Ainsi, les personnes retenues dans les centres albanais rencontrent de nombreuses difficultés à faire valoir leurs droits auprès du juge compétent, dont l’office est restreint (A), ce qui est de nature à prolonger leur enfermement délocalisé (B).
A. L’office du juge spécialisé remis en cause par les réformes législatives italiennes
Si les motifs de placement en rétention sont élargis, cette entrave à la liberté de circulation doit toujours faire l’objet d’un contrôle judiciaire effectif[41], et ce, qu’elle soit associée à l’examen d’une demande d’asile en procédure frontalière ou à l’exécution d’une décision d’éloignement. En effet, la rétention administrative d'une personne par un État membre est interprétée par la CJUE comme une mesure coercitive qui prive « une personne de sa liberté de mouvement et l'isole du reste de la population en l'obligeant à résider en permanence dans un périmètre circonscrit et restreint »[42]. Dans cet arrêt, la Grande chambre a considéré qu’une telle mesure porte nécessairement atteinte à la liberté individuelle, s’écartant de l’interprétation de la CEDH dans l’affaire Ilias et Ahmed c. Hongrie[43] selon laquelle l'« attente » dans une zone de transit ou frontalière n’est pas une rétention[44].
La rétention des demandeurs d’asile est encadrée par l’article 8 de la directive « Accueil » de 2013 qui dispose que « [l]es États membres peuvent placer le demandeur en rétention à moins que des mesures alternatives moins coercitives ne soient effectivement applicables ». Ainsi, les demandeurs d’asile ne peuvent être retenus que si la rétention est nécessaire et qu’aucune alternative moins coercitive ne peut être appliquée. Le placement en rétention doit, par ailleurs, faire l’objet d’une appréciation au cas par cas. Les États sont, enfin, tenus de garantir les droits fondamentaux de la personne concernée qui doit pouvoir s’en prévaloir devant le juge national comme l’a affirmé la Cour constitutionnelle italienne[45]. Or, l’office des juges italiens amenés à se prononcer sur la rétention des étrangers a été radicalement transformé par l’adoption de deux décrets législatifs entre octobre et décembre 2024. Désormais, les sections des chambres civiles spécialisées sur l’immigration sont dépossédées de leur compétence au profit des chambres pénales des Cours d’appel. Ces modifications sont intervenues après les annulations prononcées par le juge italien des mesures de rétention dans les centres albanais, le gouvernement italien ayant justifié le transfert du contentieux par la prétendue partialité des magistrats.
Le transfert de la compétence des sections spécialisées sur l’immigration aux Cours d’appel confie le contentieux de la rétention à un juge différent de celui chargé de l’examen de la demande de protection internationale. et le retire à des juges spécialisés et expérimentés au profit de chambres surmenées pour lesquelles le législateur n’a pris soin de préciser aucune assistance ou formation. Le retour au double degré de juridiction – supprimé par le décret-loi Minitti de 2017 depuis lequel les décisions des sections spécialisées étaient sans appel – risque en effet de représenter une charge déraisonnable pour les Cours d’appel déjà engorgées et qui devront désormais faire face à quelque 30 000 procédures supplémentaires par an dans le délai extrêmement court des procédures accélérées.
Le clivage politique entourant l’usage des centres albanais entre pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire italiens, s’il sape dangereusement les fondements de l’État de droit, porte surtout préjudice aux personnes en migration, dont les recours à l’encontre des mesures de rétention seront examinés par des juridictions non spécialisées et insuffisamment pourvues de moyens et d’effectifs. Les ressortissants étrangers sont donc criminalisés en raison de leur situation administrative et l’effectivité de leurs droits fondamentaux s’en trouve réduite au cours de leur rétention.
B. L’amoindrissement des garanties procédurales de la rétention au sein des centres albanais
Les garanties judiciaires accordées aux personnes étrangères sont amoindries tout particulièrement en ce qui concerne les personnes retenues en Albanie. En effet, le tribunal de Rome avait considéré, s’agissant d’un des premiers demandeurs d’asile à être retenus en Albanie, que la disparition des conditions permettant de l’y retenir devait impérativement conduire à sa libération, tout en observant que la « reconquête effective de la liberté pourrait s’avérer complexe et nécessiter la médiation de l’autorité administrative italienne ». En effet, cela implique l’organisation de son rapatriement vers la péninsule italienne par les autorités compétentes[46]. Or, les chances des ressortissants étrangers retenus dans les centres albanais d’être remis en liberté sont restreintes tant par leur éloignement physique du territoire italien que par leur éloignement pratique des garanties juridiques européennes, dont l’effectivité est largement minimisée par les difficultés d’accès au prétoire du juge compétent.
Tout d’abord, le formulaire de filtrage n’est pas une décision pouvant être contestée juridiquement. Or, l’issue du filtrage a des conséquences importantes puisque les personnes contrôlées peuvent être orientées vers les procédures de l’asile à la frontière dont on a exposé le caractère moins protecteur. De plus, malgré l’arrêt Samba Diouf[47] de la CJUE qui considère que les délais pour faire appel d’une décision négative doivent être « suffisants en pratique » afin de permettre au demandeur de préparer sa défense, les procédures à la frontière réduisent les délais pour introduire des recours contentieux. Ainsi, les décisions relatives au placement en rétention ou à sa prolongation doivent être contestées dans un délai de 5 jours à compter de leur notification. De même, les délais de recours contre le rejet de la demande d’asile ont été réduits de moitié, passant de 15 à 7 jours. Plus encore, l’effet suspensif des recours est exclu dans le cas où « un demandeur est soumis à la procédure à la frontière », comme le prévoit l’article 68 § 3 du Règlement Procédure. Par suite, l'autorisation de rester sur le territoire jusqu’à la décision finale devra être sollicitée auprès du juge dans un délai de 5 jours avant de pouvoir en être expulsé le cas échéant. Par ailleurs, les moyens d'appel et de cassation contre la validation du maintien en rétention, et donc sa prolongation, sont drastiquement limités. Ils ne sont admis que dans certaines hypothèses prévues à l'article 606 du code de procédure pénale, à l'exclusion remarquable des recours motivés par l'absence de preuves décisives ainsi que par le caractère non contradictoire ou manifestement illogique des éléments de preuve avancés.
De surcroît, le Protocole précise que c’est le directeur du centre qui « prend les mesures nécessaires pour assurer l’exercice des droits de la défense de l’étranger ». Si, par extraordinaire, les demandeurs parviennent à se voir attribuer un avocat d’office dans les délais impartis – au terme d’une procédure non précisée par le droit italien – l’audience a lieu à distance en Italie sans que les intéressés ne puissent rencontrer leurs avocats. En effet, la loi italienne de ratification du Protocole prévoit que « le droit de s’entretenir confidentiellement avec ce dernier est assuré par des moyens audiovisuels entre le lieu où se trouve l’étranger et le lieu où se trouve l’avocat » (article 4 paragraphe a). Le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui rémunèrent en grande partie les avocats italiens spécialisés, ne comprend pas le remboursement des frais de transport de ceux qui accepteraient de se rendre dans les centres albanais.
Par conséquent, il est à craindre que ces réformes judiciaires ne permettent qu’à l’administration italienne de saisir le juge afin de contester l’éventuelle remise en liberté des personnes retenues, tandis que ces dernières doivent surmonter de nombreuses difficultés pour contester les décisions de leur placement et maintien en rétention, à distance de l’institution judiciaire. Qui plus est, l’entremise des autorités italiennes reste nécessaire pour que la personne jouisse de son droit au recours effectif, et le cas échéant, qu’elle rejoigne « librement » le territoire européen. En somme, les personnes retenues dans les centres albanais sont – tant symboliquement que matériellement – maintenues éloignées de la justice italienne, ainsi que des médias et de la société civile.
Notes de bas de page
- [1] Voir, PROTOCOLLO-ITALIA-ALBANIA-in-materia-migratoria.pdf.
- [2] Afin d’accélérer la mise en œuvre de l’expulsion des ressortissants étrangers dépourvus de droit au séjour, le décret loi Cutro 20/2023 permettait de déroger au code des contrats publics lors de l'identification, de l'acquisition ou de l'extension des centres de retour, dérogation valable jusqu'au 31 décembre 2025.
- [3] L’article 3 du Protocole dispose que « seules les personnes embarquées sur des véhicules des autorités italiennes en dehors de la mer territoriale de la République ou d’autres États membres de l’Union européenne, même à la suite d’opérations de sauvetage, peuvent être emmenées ». Le décret ne contient aucune indication quant à leur sélection, alors même que seules les personnes secourues estimées non vulnérables entrent dans le champ personnel du Protocole.
- [4] Le Protocole a été ratifié par la loi n° 14/2024 et modifié par le décret législatif n° 37/2025 du 24 mars 2025.
- [5] Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.
- [6] Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale et abrogeant la directive 2013/32/UE.
- [7] Règlement 2024/1349 (UE) du 14 mai 2024 établissant un système commun pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE.
- [8] Décret-loi, 18 décembre 2023, n°14/2024. Pour une analyse critique de ces dispositions, voir L. Masera, « Le décret de ratification et d’application du protocole entre l’Italie et l’Albanie sur l’immigration : analyse du projet et questions de légitimité », Système pénal, 28 décembre 2023.
- [9] Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).
- [10] Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
- [11] Article 5 1) du Règlement (UE) 2024/1356 intitulé « Filtrage à la frontière extérieure » : « Le filtrage s’applique à tous les ressortissants de pays tiers, qu’ils aient ou non présenté une demande de protection internationale, qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 et qui : a) sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne; ou b) sont débarqués sur le territoire d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage ».
- [12] Article 9 du Règlement (UE) 2024/1356 précité intitulé « Obligations des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage » : « 1. Au cours du filtrage, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage restent à la disposition des autorités de filtrage ».
- [13] L’article 3 du Protocole dispose que « les centres sont assimilées aux zones frontalières identifiées par l’arrêté 25/2008 ».
- [14] Articles 17 et 18 du Règlement (UE) 2024/1356 précité intitulé « Formulaire de filtrage et Achèvement du filtrage ».
- [15] Article 6 du Règlement (UE) 2024/1356 précité intitulé « Autorisation d’entrer sur le territoire d’un État membre » : « Au cours du filtrage, les personnes ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre. Les États membres prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que les personnes restent à la disposition des autorités compétentes dans les lieux visés à l’article 8, pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure ou pour la santé publique résultant de cette fuite ».
- [16] G. Campesi, « Normalising “the Hotspot Approach ?” An analysis of the Commission’s Most Recent Proposals », in S. Carrera, D. Curint, A. Geddes (éds.), 20 Years Anniversary of the Tampere Programme. Europeanisation Dynamics of the EU Area of Freedom, Security and Justice, Florence, European University Institute, 2020, pp. 93-104.
- [17] Secrétariat général du Conseil, Présentation sur la stratégie du comité en matière d’immigration, de frontières et d’asile (SCIFA), n°12018/2024, Bruxelles, 27 septembre 2024.
- [18] ECRE, « Border Procedures : Not a Panacea », Policy Note, 22 juillet 2019, n°21, p. 3 : « EASO’s recent analysis on the use of border procedures reveals a substantially lower recognition rate at first instance in 2018 of 12% for applications processed in border procedures in EU Member States compared to the 34% recognition rate in regular procedures ».
- [19] Décret-loi, 8 avril 2025, n°37/2025 (DL 37/2025 .docx).
- [20] C. Siccardi, « La legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria: problematiche costituzionali », Osservatorio costituzionale, 2024, vol. 2.
- [21] Voir notamment, S. Besson, « The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to», Leiden Journal of International Law, 2012, vol. 25-4, pp. 857-884.
- [22] Gerald Neuman définit les « zones anormales » comme « a geographical area in which certain legal rules, otherwise regarded as embodying fundamental policies of the larger legal system, are locally suspended » (G.L. Neuman, « Anomalous Zones », Stanford Law Review, 1996, vol. 48, no. 5, pp. 1197–1234, spéc. pp. 1200-12001).
- [23] Il se contente de rappeler la non admission des étrangers soumis à ces procédures frontalières, telle que prévue par l'article 4 du Règlement « Filtrage », l'article 45 du Règlement « Procédures » et l'article 5 du Règlement « Retour ».
- [24] Fr. Rondine, « The Fiction of Non-entry in European Migration Law. Its Impact on the Rights of Migrants at European Borders », European Journal on Migration and Law, 2024, vol. 26-3, pp. 291-316.
- [25] Décret-loi "Cutro", 10 mars 2023, n°20/2023.
- [26] C. Siccardi, « Le procedure paesi sicuri e il protocollo italia-albania alla luce della più recente giurisprudenza: profili di diritto costituzionale », Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo n.1/2025.
- [27] Tribunal de Rome, 18 octobre 2024, n° 42251/2024.
- [28] CJUE, Grande chambre, arrêt du 4 octobre 2024, CV c. contre Ministerstvo vnitra České republiky, C-406/22.
- [29] Cour de cassation, 1ère section civile, décision du 19 décembre 2024, n°33398 et du 30 décembre 2024, n°22146.
- [30] Décret-loi, 23 octobre 2024, n° 158-2024.
- [31] Cour d’appel de Rome, section pénale, ordonnance du 31 janvier 2025, n° 478.
- [32] Voir sur ce point, F. Vassallo Paléologo, « Ancora deportazioni in Albania. La Corte di Appello di Roma nega la convalida dei trattenimenti », Associazione Diritti e Frontiere, 31 janvier 2025 (Ancora deportazioni in Albania. La Corte di Appello di Roma nega la convalida dei trattenimenti. – ADIF).
- [33] CJUE, Grande chambre, arrêt du 1er août 2025, LC et CP c. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II, C-758/24, C-759/24.
- [34] Décret-loi, 9 décembre 2024, n° 187/2024.
- [35] CJUE, arrêt du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18.
- [36] Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’application du concept de « pays tiers sûr » du 20 mai 2025.
- [37] L'article 57 du Règlement « Procédure » définit la « protection effective » d’un pays tiers comme incluant l'accès à la logement ou à l'hébergement, le droit d'exercer un emploi rémunéré afin de garantir un niveau de vie digne, l’accès à des moyens de subsistance suffisants, ainsi qu’à la santé et à l’éducation notamment.
- [38] Voir notamment CEDH, arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S contre Belgique et Grèce, , n° 30696/09.
- [39] Cl. Rodier, « Externalisation du contrôle des flux migratoires : comment et avec qui l’Europe repousse ses frontières ? », Migrations & Société, 2008, n°116-2, pp. 105-122.
- [40] Le Règlement « Retour » tel que modifié par la Commission européenne en mars 2025 prévoit que la juridiction sur les centres puisse être transférée aux pays tiers sûrs dans lesquels ils sont construits si tant est que les accords bilatéraux prévoient que la protection des droits fondamentaux y soit effective, par une formule évasive et peu contraignante.
- [41] Cour de Cassation, ordonnance interlocutoire du 8 février 2024, n° 20674/2023.
- [42] CJUE, Grande chambre, arrêt du 14 mai 2020, FMS, FNZ, SA, SA Junior, C-924/19 et C-925/19.
- [43] CEDH, arrêt du 21 novembre 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie, 47287/15.
- [44] Voir dans ce sens, E. Celoria, « Stranieri trattenuti alle frontiere esterne dell’Unione: il quadro di garanzie individuato dalla Corte di giustizia e le sfide del Nuovo patto sulle migrazioni e l’asilo », European Papers, 2020, vol. 5, n°3, pp.1385-1398.
- [45] Cour constitutionnelle, décision du 22 mars 2001, n°105 (par laquelle la Cour Constitutionnelle écarte une question de constitutionnalité sur la rétention d’une l’étranger titulaire d’une décision d’expulsion s’agissant de son droit fondamental à comparaître devant un juge jusqu’à son expulsion, qu’elle confirme).
- [46] Tribunal de Rome, XVIIIe section civile, ordonnance du 11 novembre 2024.
- [47] CJUE, arrêt du 28 juillet 2011, Brahim Samba Diouf c. Ministre du Travail et de l’Immigration luxembourgeois, C-69/10.