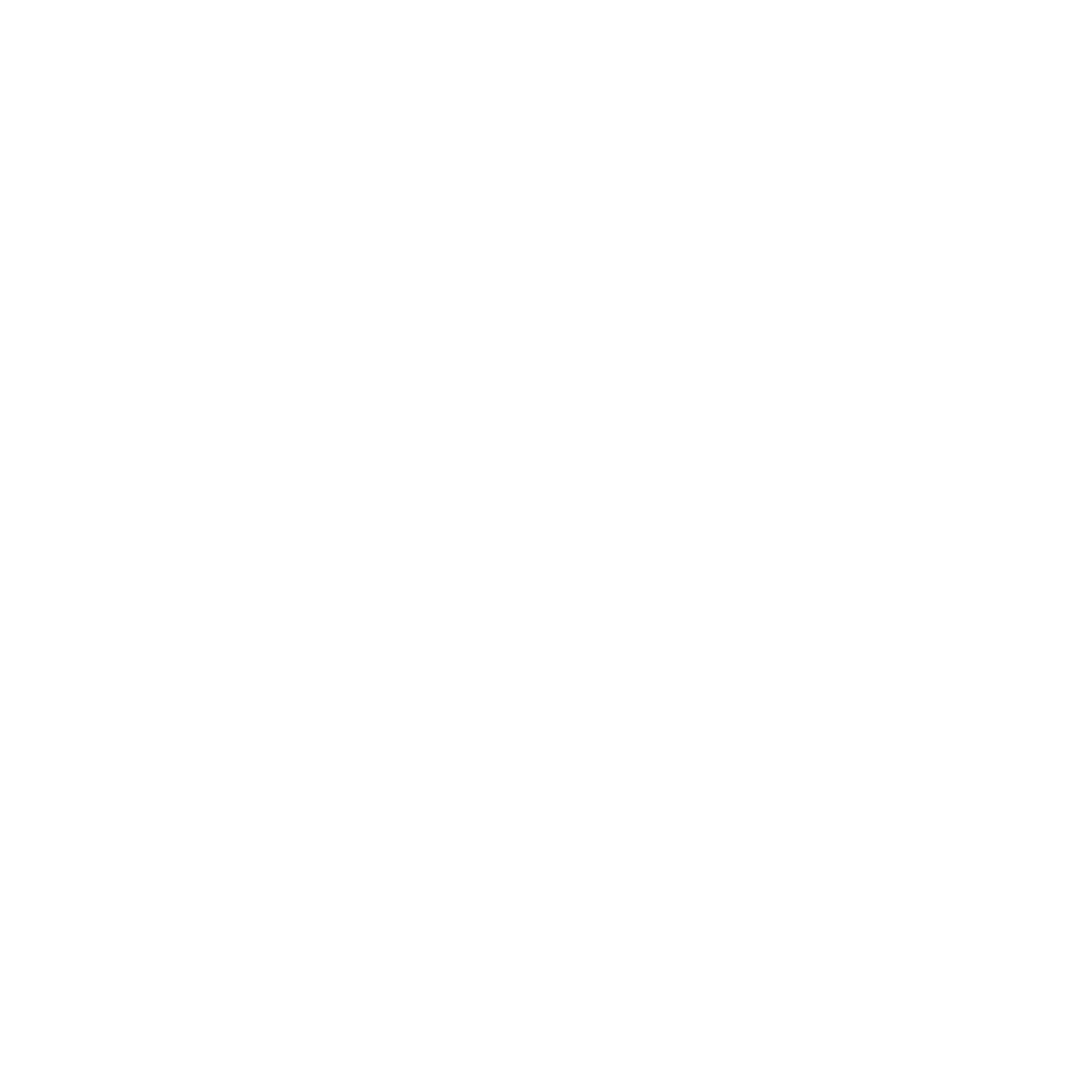Lorsqu’ils luttent contre des attaques hybrides de la Russie et de la Biélorussie, les États membres […] pourraient être amenés à adopter des mesures susceptibles de porter gravement atteinte à des droits fondamentaux, tels que le droit d’asile "[1].
Cette affirmation de la Commission européenne est sans nul doute le reflet d’une réalité dramatique aux frontières extérieures de l’Union européenne avec la Biélorussie, qui trouve malheureusement écho sur d’autres frontières. L’augmentation du nombre de personnes se présentant aux frontières de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne avec la Biélorussie, orchestrée par cette dernière à partir de l’été 2021, a motivé l’adoption de législations nationales rapidement dénoncées comme organisant la légalisation des refoulements sommaires[2]. L’absence d’accès à une protection internationale et les violences, parfois mortelles, rencontrées par les personnes qui font face à des pratiques de refoulements sommaires sont largement documentées[3] et dénoncées[4], et sont parfois constatées par les cours supranationales[5].
Or, loin de condamner ces législations et pratiques nationales, la Commission européenne semble ouvertement légitimer les mesures prises par les États membres. Tandis que le Parlement européen interrogeait la Commission sur l’opportunité d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’États membres frontaliers de la Biélorussie[6], et avant que la Cour de justice ne constate l’incompatibilité de la législation lituanienne avec le droit de l’Union[7], la Commission européenne proposait des mesures d’urgence au profit de ces États afin de faire face à ce qui a été désigné comme une « instrumentalisation » des migrations[8]. Par la suite, la proposition d’adopter un instrument dédié à la lutte contre l’« instrumentalisation » des migrations[9] a finalement abouti à l’insertion de ces outils, à la disposition des États membres, dans le droit dérivé de l’Union européenne. Ainsi, un nouveau Règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure (ci-après « Règlement crise »)[10] a été formellement adopté en mai 2024, dans le cadre du Pacte sur la migration et l’asile[11], et sera applicable à partir du 1er juillet 2026. Associé à une modification du Code frontières Schengen[12], ce nouveau Règlement prévoit, en cas d’« instrumentalisation » des migrations, la possibilité de limiter l’ouverture des points de passage frontaliers et de déroger aux procédures d’asile. Pour certains, cette règlementation européenne a le mérite de fournir des outils juridiques aux États membres afin d’éviter l’adoption de mesures nationales unilatérales[13]. Toutefois, elle souscrit à l’appréhension des contrôles migratoires en tant qu’enjeu de sécurité[14], comporte le risque d’instaurer un « état d’urgence permanent » aux frontières extérieures[15], et a pu être dénoncée comme fournissant un cadre juridique à des pratiques illégales[16].
Sans attendre l’application du « Règlement crise », la Commission européenne a publié, en décembre 2024, une communication relative à la lutte contre les menaces hybrides résultant de l’instrumentalisation de la migration ainsi qu’au renforcement de la sécurité aux frontières extérieures de l’UE[17]. Elle s’y réfère à la possibilité de déroger au droit dérivé de l’Union européenne en vertu des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure[18]. Cette possibilité, confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, fait cependant l’objet d’un contrôle par les institutions de l’Union européenne et doit s’appliquer dans des cas bien circonscrits[19]. Il revient aux États de prouver la nécessité de recourir à cette dérogation et toute dérogation doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
De plus, la Commission affirme la possibilité de limiter l’exercice des droits consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « CDFUE »), en cas d’« instrumentalisation » des migrations. Rappelons que toute limite à l’exercice de ces droits doit être prévue par la loi, et doit être strictement nécessaire à la réalisation d’objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui[20]. Toute limitation doit respecter le contenu essentiel de ces droits et libertés[21]. Ici, la Commission européenne affirme que l’Union européenne « a déjà été confrontée à une situation dans laquelle il a été nécessaire de limiter des droits fondamentaux consacrés par la charte pour contrer les menaces hybrides posées par la Russie »[22]. La Commission s’appuie sur la décision RT France c. Conseil de l’UE [23] du 30 mars 2022, qui concernait l’interdiction temporaire de diffusion de contenus audiovisuels en raison de la propagande et de la désinformation ciblant la société civile dans l’Union. Toutefois, la Commission se réfère, sans les explicitées, aux « différences évidentes » qui existent entre la liberté d’expression — valablement restreinte dans l’affaire RT France — et le droit d’asile[24].
En vertu de l’article 18 CDFUE, « le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève [relative au statut des réfugiés et de son protocole] et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Malgré l’acception traditionnelle du droit d’asile, comme un droit des États d’accorder une protection[25], le caractère individuel du droit d’asile de l’article 18 CDFUE ne fait pas de doute et est largement affirmé par la doctrine[26]. D’ailleurs, la fragilisation du droit individuel d’asile aux frontières est souvent évoquée, crainte ou dénoncée[27]. Toutefois, l’interprétation du droit d’asile se heurte d’emblée à la difficulté d’en déterminer le contenu matériel. L’article 18 CDFUE ne précise pas si ce droit d’asile est un droit de chercher et/ou de demander l’asile, d’obtenir et/ou de bénéficier de cette protection. Or, la Cour de justice mobilise l’article 18 CDFUE de façon régulière, depuis 2017[28], et les contours du droit d’asile n’ont pas bénéficié d’une attention systématique suffisante.
Quel est le contenu matériel du droit d’asile identifié par la Cour de justice de l’Union européenne ? La lutte contre l’« instrumentalisation » des migrations constitue-t-elle un objectif d’intérêt général susceptible de justifier la limitation de l’exercice du droit d’asile, et ce, dans quelle mesure ? Est-il possible d’assurer une interprétation conforme des instruments destinés à la lutte contre l’« instrumentalisation » des migrations avec le respect de l’article 18 CDFUE ? Telles sont les questions auxquelles cette contribution entend apporter une réponse. En s’appuyant sur l’état de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il sera ainsi mis en évidence que les frontières extérieures représentent précisément une interface, géographique autant que juridique, vers la garantie du droit d’asile. Face à ce qui a été identifié comme des situations d’« instrumentalisation » des migrations, le respect du droit d’asile exige de garantir l’accès à des procédures d’asile aux frontières (I) et invite à évaluer les restrictions opposées à l’obtention d’un statut de protection internationale (II).
I. L’exigence de l’accès à une procédure d’asile au regard de l’article 18 CDFUE en cas d’« instrumentalisation » des migrations
Il s’agit ici de mettre en évidence que le droit d’asile garanti par l’article 18 de la CDFUE comprend un droit de solliciter l’asile. Ce droit suppose, d’une part, d’assurer l’accès effectif à la procédure d’asile, y compris en cas d’instrumentalisation des migrations (A), et, d’autre part, d’apprécier la proportionnalité des mesures adoptées pour y faire face lorsqu’elles restreignent la présentation d’une demande aux frontières (B).
A. L’accès à une procédure ou le droit de solliciter l’asile garanti par l’article 18 CDFUE
Dans l’état actuel du droit, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà eu l’occasion de se prononcer sur une affaire concernant l’« instrumentalisation » des migrations par la Biélorussie. Dans cette affaire M.A., la législation lituanienne prévoyait, en cas de déclaration de l’état de guerre ou de l’état d’urgence, ou en cas de proclamation d’une situation d’urgence en raison d’un afflux massif d’étrangers, que les ressortissants de pays tiers se trouvant en situation de séjour irrégulier étaient effectivement privés d’accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale. Dans son arrêt du 30 juin 2022, la Cour de justice a ainsi considéré que la présentation et l’introduction d’une demande de protection internationale « visent à assurer, d’une part, l’accès effectif à la procédure permettant l’examen d’une demande de protection internationale et, d’autre part, l’effectivité de l’article 18 de la Charte »[29]. Par conséquent, l’impossibilité pour une personne se trouvant en situation de séjour irrégulier de présenter une demande de protection « empêche […] ledit ressortissant de jouir effectivement du droit consacré à l’article 18 de la Charte »[30].
Dans son arrêt M.A., la Cour de justice a repris le raisonnement qu’elle avait déjà adopté dans une affaire concernant l’arrivée de demandeurs de protection internationale à la frontière serbo-hongroise. Dans son arrêt Commission c. Hongrie du 17 décembre 2020, la Cour de justice avait conclu à l’incompatibilité de la législation hongroise selon laquelle ces personnes ne pouvaient présenter de demande de protection qu’en personne, et que dans certaines zones de transit. En effet, le nombre de personnes effectivement autorisées à accéder à ces zones quotidiennement était très faible. Soulignant le lien étroit entre les différentes étapes d’une demande de protection internationale, la Cour a relevé que : « Le droit de présenter une […] demande [de protection internationale] conditionne […] le respect effectif des droits à ce que cette demande soit enregistrée et puisse être introduite et examinée dans les délais fixés par la directive [procédure] et, en définitive, l’effectivité du droit d’asile, tel qu’il est garanti par l’article 18 de la Charte »[31]. D’ailleurs, cette jurisprudence de la Cour de justice, qui a mis en relief les trois étapes de l’accès à la procédure d’asile (présentation, enregistrement et introduction), dès l’arrivée des personnes aux frontières, a essentiellement été codifiée, avec l’adoption du Pacte européen sur la migration et l’asile, dans le Règlement procédure[32].
La Cour de justice a encore mobilisé l’article 18 de la Charte afin d’assoir un véritable « droit de solliciter l’asile » aux frontières extérieures, à l’occasion d’un autre arrêt en manquement contre la Hongrie du 22 juin 2023[33]. La législation hongroise en question subordonne la possibilité de présenter une demande de protection internationale au dépôt d’une déclaration d’intention préalable, auprès d’une ambassade située dans un État tiers. Par conséquent, en application de cette législation « les ressortissants de pays tiers ou les apatrides […] qui se présentent aux frontières de cet État membre, sans s’être soumis à la procédure préalable […], sont privés de la jouissance effective de leur droit, tel qu’il est garanti à l’article 18 de la Charte, de solliciter l’asile auprès dudit État membre »[34].
De plus, dans le contexte de l’« instrumentalisation » des migrations, la Cour de justice s’est également prononcée sur la possibilité de déroger au droit dérivé de l’asile, en vertu de l’article 72 TFUE. Dans son arrêt M.A., la Cour de justice a bien affirmé que : « le fait d’invoquer de manière générale des atteintes à l’ordre public ou à la sécurité intérieure causées par l’afflux massif de ressortissants de pays tiers ne permet pas de justifier, au titre de l’article 72 TFUE, une disposition […] qui conduit à priver — de facto — le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre du droit de soumettre une demande de protection internationale sur le territoire de cet État membre »[35]. Elle a alors rappelé les dérogations prévues par le droit dérivé de l’Union européenne, et en particulier la possibilité de mettre en place des procédures spéciales aux frontières[36]. Selon la Cour de justice, ces procédures « permettent [d’ores et déjà] aux États membres d’exercer, aux frontières extérieures de l’Union, leurs responsabilités en matière de maintien de l’ordre public et de sauvegarde de la sécurité intérieure, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une dérogation au titre de l’article 72 TFUE »[37].
En somme, refuser l’accès à une procédure d’asile, de jure ou de facto, constitue une violation de l’article 18 CDFUE relatif au droit d’asile, y compris dans le contexte d’une « instrumentalisation » des migrations par un pays tiers[38]. D’ailleurs, la règlementation européenne adoptée en vue de faciliter la lutte contre l’« instrumentalisation » des migrations ne prévoit pas une suspension générale du droit d’asile. Le Règlement crise, qui sera applicable à partir du 1er juillet 2026, affirme que « [d]ans une situation d’instrumentalisation […] un accès effectif et réel à la procédure de protection internationale doit être garanti conformément à l’article 18 de la Charte et à la Convention de Genève »[39]. Il faut donc abonder dans le sens de l’Avocat général Nicholas Emiliou selon lequel « empêcher, en pratique, un ressortissant de pays tiers de solliciter une protection internationale porte atteinte au “contenu essentiel” [du droit d’asile] »[40]. Même si la Cour de justice de l’Union européenne n’a pour l’instant pas fait référence au « contenu essentiel » du droit d’asile, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile souligne bien que l’accès à une procédure est un « aspect clé » du droit d’asile de l’article 18 CDFUE et un « élément essentiel » du système européen commun d’asile[41].
B. La possibilité de contraindre la présentation d’une demande de protection internationale à l’aune du droit de solliciter l’asile
Dans le cadre de l’évolution de la règlementation européenne, la possibilité de contraindre la présentation d’une demande de protection internationale, en cas d’« instrumentalisation » des migrations, pose question au regard de la garantie du droit d’asile.
En premier lieu, les activités de conseils fournies aux demandeurs d’asile placés dans des centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans des zones de transit, pourront être restreintes, au titre de la sécurité ou de l’ordre public[42]. Dans le même temps, l’accès des organisations et des personnes fournissant ces conseils ne devra pas être « considérablement restreint ou rendu impossible »[43]. Les restrictions imposées aux activités de conseil devront être « objectivement nécessaires » à la sauvegarde de la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative des points de passage frontalier concerné[44].
Or, la Cour de justice a pu conclure que « des mesures qui, sans justification raisonnable, aboutissent à dissuader un ressortissant d’un pays tiers à présenter sa demande de protection internationale aux autorités compétentes »[45] sont « susceptibles de porter atteinte à l’effectivité du droit d’asile, tel qu’il est garanti à l’article 18 de la Charte »[46]. Ainsi, l’engagement d’une procédure pénale pour aide à l’entrée irrégulière, sur le territoire italien, de mineurs à l’égard desquels la personne poursuivie exerçait une garde effective a été considéré comme contraire au droit de l’Union[47]. Il en a été de même de l’incrimination des activités de conseils fournis, notamment, dans les zones de transit hongroises[48]. Dans ce dernier cas, la Cour a considéré que le droit national « [allait] au-delà de ce qui peut être considéré comme nécessaire pour atteindre l’objectif visant à lutter contre les pratiques frauduleuses ou abusives »[49]. Dès lors, l’« instrumentalisation » des migrations appelle un équilibre entre la protection des personnes éligibles à l’asile, pour lesquelles l’accès aux activités de conseil peut être décisif, et les impératifs d’ordre public ou de sécurité intérieure.
De plus, il faut noter que la définition d’une situation d’« instrumentalisation » inclut l’intervention d’acteurs non étatiques dans la facilitation du déplacement de ressortissants de pays tiers vers les frontières extérieures[50]. À ce propos, il est bien précisé que l’implication de « la criminalité organisée, en particulier le trafic de migrants », ou encore de l’« aide humanitaire », ne devrait pas être considérée comme une instrumentalisation de migrants « lorsqu’il n’y a pas d’objectif de déstabilisation de l’Union ou d’un État membre »[51]. Toutefois, aucune indication supplémentaire ne permet d’encadrer l’évaluation d’un tel « objectif de déstabilisation ».
En second lieu, face à l’« instrumentalisation » des migrations, le Code frontières Schengen modifié prévoit que les États membres peuvent « fermer temporairement des points de passage frontaliers »[52] ou « limiter leurs heures d’ouverture »[53]. Or, le fait de limiter l’accès à certaines zones aux frontières recèle le risque de rendre l’accès à une procédure d’asile impossible, en violation de l’article 18 CDFUE[54]. Ici, la fermeture ou la limitation de l’ouverte de points de passage aux frontières doit être appliqué « de manière à garantir […] les obligations liées à l’accès à une protection internationale »[55], c’est-à-dire, « de manière proportionnée et en prenant pleinement en considération les droits […] des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale »[56].
Or, dans son arrêt en manquement contre la Hongrie du 22 juin 2023[57], la Cour de justice a affirmé l’exigence de ne pas « retarder, de manière injustifiée, le moment auquel une demande de protection internationale peut être présentée »[58] aux frontières, sous peine de constituer « une atteinte manifestement disproportionnée » au droit de présenter une telle demande[59]. Cette atteinte était constituée par « le fait de contraindre des ressortissants de pays tiers ou des apatrides, qui séjournent en Hongrie ou qui se présentent aux frontières de cet État membre, à se déplacer vers l’ambassade dudit État membre à Belgrade ou à Kiev afin de pouvoir, par la suite, retourner en Hongrie pour y présenter une demande de protection internationale »[60]. Toutefois, la Hongrie n’entendait pas entraver la présentation de demandes d’asile de la part de personnes soumises à une situation d’« instrumentalisation ». Celle-ci faisait valoir une justification fondée sur des motifs de santé publique et, plus particulièrement, sur la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. En l’espèce, la Cour de justice n’a pas accueilli favorablement cet argument. En effet, l’obligation de déplacement avant le retour en Hongrie risquait d’aggraver la propagation de la maladie, alors que le droit de l’asile de l’Union prévoyait déjà des mesures destinées à la protection de la santé publique (conduite d’un examen médical, possibilité d’un confinement, dispense de l’entretien personnel ou encore réalisation de l’entretien à distance).
Reste donc à savoir si la Cour de justice admettrait, « à titre exceptionnel », que les États membres puissent imposer des « modalités particulières » de présentation des demandes d’asile pour faire face à une situation d’« instrumentalisation » des migrations[61]. Dans ce cas, il faudrait s’assurer que ces modalités « soient propres à garantir un tel objectif et ne soient pas disproportionnées au regard de celui-ci »[62]. Or, la Cour de justice pourrait bien considérer que le droit dérivé de l’Union européenne prévoit déjà des mesures destinées à la protection de la sécurité intérieure. D’abord, le droit de l’asile de l’Union européenne prévoit la possibilité de mettre en place des procédures spéciales aux frontières, y compris afin d’apprécier la recevabilité de demandes de protection internationale dans des situations où le comportement du demandeur tend à indiquer que sa demande est manifestement non fondée ou abusive[63]. Ensuite, dans la perspective de la mise en œuvre des instruments du Pacte, l’institution d’une procédure de filtrage aux frontières extérieures[64] a précisément pour « objectif [de] renforcer le contrôle »[65] des ressortissants de pays tiers, et éventuellement d’identifier les personnes qui « pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure »[66]. En effet, la procédure de filtrage comprend un contrôle de sécurité qui implique la consultation des bases de données de l’Union européenne[67]. Enfin, il convient de rappeler que les personnes à la recherche d’une protection internationale sont les premières victimes des situations dans lesquelles elles sont instrumentalisées. Dans le cas de la Russie et de la Biélorussie, la Commission européenne a bien reconnu que ces États « profitent d’êtres humains, [qu’ils] utilisent dans un acte d’hostilité, en faisant fi de leur vulnérabilité »[68]. En ce sens, la proportionnalité des contraintes imposées à la présentation d’une demande de protection internationale ne peut être appréciée sans tenir pleinement compte des besoins de protection des demandeurs d’asile.
Après avoir établi que l’effectivité du droit d’asile suppose de garantir l’accès à la procédure, l’analyse doit désormais porter sur l’évaluation des restrictions étatiques au bénéfice de la protection internationale.
II. L’évaluation des restrictions au bénéfice de la protection internationale à l’aune de l’article 18 CDFUE en cas d’« instrumentalisation » des migrations
Face à l’« instrumentalisation » des migrations, la garantie effective du droit d’asile de l’article 18 CDFUE apparaît fragilisée, tant dans sa dimension de « droit à l’asile », face aux obstacles à l’obtention d’une protection internationale (A), que dans celle de « droit d’asile provisoire », en raison des exceptions au droit de demeurer sur le territoire d’un État membre pendant l’examen d’une demande (B).
A. Des obstacles à l’obtention d’une protection internationale, un « droit à l’asile » modulable ?
Face à une situation d’« instrumentalisation » des migrations, le droit dérivé de l’asile applicable prévoit déjà la mise en place de procédures spéciales aux frontières permettant aux États membres d’exercer leurs responsabilités en matière de maintien de l’ordre public et de sauvegarde de la sécurité intérieure[69]. De plus, dans le cadre de l’application prochaine des instruments du Pacte européen, le « Règlement procédure » étend le recours à la procédure d’asile à la frontière[70] et le « Règlement crise » met à disposition des États membres des dérogations supplémentaires à la procédure d’asile.
Dans toute situation de « crise » ou en cas de « force majeure »[71], les États membres pourront prolonger le délai d’enregistrement des demandes de protection internationale, ainsi que la durée maximale de la procédure d’asile à la frontière. Le délai d’enregistrement pourra être porté à 4 semaines, au lieu de 5 jours ouvrés, à compter de la présentation des demandes de protection internationale[72]. Notons que les États membres pourront appliquer cette dérogation, avant même d’y être expressément autorisés par le Conseil de l’Union européenne, et ce, pour une durée maximum de 10 jours suivant la demande[73]. La durée maximale de la procédure d’asile à la frontière sera, quant à elle, portée à une période supplémentaire de six semaines[74] (au-delà de la période de 12 semaines prévue par le Règlement procédure). Ceci portera le confinement potentiel des demandeurs de protection internationale aux frontières à une durée de plus de 4 mois. Par ailleurs, dans le cas spécifique d’une situation d’instrumentalisation, les États membres seront autorisés à avoir recours à la procédure d’asile à la frontière pour prendre des décisions sur « l’ensemble des demandes » de protection internationale[75].
La possibilité d’appliquer ces dérogations tout en respectant « les principes de base du droit d’asile » (« right to asylum » dans la version anglaise)[76] doit alors être questionnée. En effet, si une situation d’« instrumentalisation » se caractérise par un contexte d’afflux massif, il est alors difficile d’imaginer comment le confinement des demandeurs d’asile aux frontières, associé à l’accélération de l’examen au fond des demandes concernées[77], peut être compatible avec le maintien de garanties procédurales appropriées, à même de garantir l’octroi d’un statut protecteur aux personnes qui en ont besoin. Or, la Cour de justice a clairement affirmé, dans son arrêt FMS et autres du 14 mai 2020, l’existence d’un « droit, tel qu’il est consacré à l’article 18 de la Charte et concrétisé par les directives 2011/95 [qualification] et 2013/32 [procédure], d’obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale, dès lors que les conditions requises par le droit de l’Union sont réunies »[78]. La Cour de justice a fait référence à sa décision FMS et autres dans deux arrêts de janvier 2024, confirmant « le droit fondamental consacré à l’article 18 de la Charte d’obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale dès lors que les conditions requises par le droit de l’Union sont réunies »[79].
L’affaire FMS et autres, en particulier, concernait des demandes d’asiles, déposées dans la zone de transit de Röske, à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Ces demandes avaient été rejetées comme irrecevables en vertu de la législation nationale[80]. Or, l’irrecevabilité de ces demandes s’appuyait sur le simple transit des demandeurs par la Serbie, et ne pouvait donc pas être justifiée par l’application du concept de « pays tiers sûr », en vertu du droit de l’Union[81]. Par conséquent, la Cour de justice a affirmé que « l’effet utile » du droit reconnu au demandeur d’une protection internationale d’obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale « serait gravement compromis » si une demande ultérieure pouvait être déclarée irrecevable « alors que le rejet de la première demande est intervenu en méconnaissance du droit de l’Union »[82]. En effet, une telle interprétation de la notion de « demande ultérieure », en vertu de la Directive procédure, était seule à même de permettre un nouvel examen de la demande d’asile, et l’éventuel octroi d’un statut protecteur, conformément à la Directive qualification. En d’autres termes, la Cour de justice s’est appuyée sur l’article 18 CDFUE, et le droit fondamental qu’il consacre, afin d’articuler l’application des Directives procédure et qualification[83].
D’une part, la Cour de justice semble donc avoir désavoué la vision exprimée par l’avocat général Niilo Jääkinsen, en 2013, selon laquelle l’article 18 CDFUE et l’article 78 TFUE « ne créent pas, pour les demandeurs d’asile, un droit subjectif matériel à se voir accorder l’asile »[84]. Au contraire, la Cour semble plutôt soutenir les conclusions de Serge Bodart, qui place « le droit à un statut » parmi les composantes du droit d’asile de l’article 18 CDFUE[85], et de María-Teresa Gil-Bazo, selon laquelle « le droit d’asile de l’article 18 de la Charte doit être compris comme un droit subjectif opposable pour les individus, de se voir accorder l’asile en vertu du droit de l’Union »[86]. En d’autres termes, l’article 18 CDFUE garantie un « droit à l’asile », c’est-à-dire un droit à l’obtention d’un statut protecteur dès lors que les conditions établies par le droit de l’Union sont réunies. D’autre part, il apparaît que, si la mauvaise qualité des procédures d’asile à la frontière aboutit au refus d’octroyer l’asile, en violation du droit de l’Union européenne, la garantie d’un droit d’asile de l’article 18 CDFUE exige la recevabilité de toute demande ultérieure[87]. En d’autres termes, l’effectivité du « droit à l’asile » dépend de la possibilité effective de voir sa demande examinée. Se référant à l’arrêt FMS et autres, l’avocat général Nicholas Emiliou reconnaissait, dans ses conclusions du 7 septembre 2023, l’« importance » du droit, consacré à l’article 18 CDFUE, d’obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale[88]. En outre, il relevait que l’article 78§1 TFUE indique que la politique commune développée par l’Union en matière d’asile vise « non seulement à assurer le respect du principe de non-refoulement, mais également à offrir un “statut approprié” à tout ressortissant d’un pays tiers “nécessitant une protection internationale” »[89]. Sur cette toile de fond, une véritable cohérence semble donc établie entre les objectifs affichés de la politique commune d’asile, la consécration d’un droit fondamental à l’asile, et l’adoption d’instruments qui « concrétisent » ce droit.
Il est évident que l’exercice de ce « droit à l’asile » connaît de nombreuses limitations, conformément au droit de l’asile de l’Union européenne. On pense notamment à la possibilité de révoquer ou de ne pas octroyer le statut de réfugié en cas de menace pour la sécurité de l’État membre[90], ou encore à l’application du concept de pays tiers sûr qui permet d’écarter l’accès à une protection sur place[91]. Toutefois, ce qu’il reste à déterminer est la possibilité de limiter ce « droit à l’asile », de façon particulière, en cas d’« instrumentalisation » des migrations. Concernant la possibilité de déroger au droit dérivé de l’asile, en vertu de l’article 72 TFUE, il a déjà été rappelé que les dérogations prévues par le droit dérivé de l’asile applicable sont susceptibles de faire échec à l’invocation de cet article[92]. Dans l’optique de la mise en œuvre du Règlement crise, à partir du 1er juillet 2026, il faut anticiper que les dérogations supplémentaires à la procédure d’asile qu’il prévoit pour face à l’« instrumentalisation » des migrations permettront, a fortiori, de neutraliser le recours à l’article 72 TFUE.
Quelques précisions finales méritent sans doute d’être apportées concernant les mesures présentées comme « nécessaires pour atteindre l’objectif visant à lutter contre les pratiques frauduleuses ou abusives »[93]. L’argument tiré d’un éventuel abus du droit d’asile, dans le cadre de l’« instrumentalisation » des migrations, concentre en effet les préoccupations. Un tel argument, tiré du comportement des personnes considérées, a été reçu favorablement par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « Cour EDH »), dans des affaires concernant des arrivées aux frontières. Concrètement, la Cour EDH a pu priver les personnes ayant « recours à la force » et tirant parti de l’« effet de masse » aux frontières du bénéfice de l’interdiction des expulsions collectives[94]. D’après la Cour, un tel comportement était en outre susceptible d’« engendrer des désordres manifestement difficiles à maîtriser et [de] menacer la sécurité publique »[95]. Toutefois, il faut bien souligner que ces situations ne correspondaient pas au contexte de l’« instrumentalisation » des migrations. Les personnes soumises à une instrumentalisation sont avant tout les victimes de cette situation. Il s’agit donc de ne pas confondre l’éventualité d’un abus du droit d’asile avec la situation des personnes dont la vulnérabilité est exploitée, par des pays tiers, à des fins géopolitiques.
B. De la possibilité de restreindre le droit de rester sur le territoire le temps de voir sa demande examinée, un « droit à l’asile provisoire » confisqué ?
Le droit de solliciter l’asile, dès l’arrivée aux frontières, n’est soumis à aucun formalisme et s’articule alors avec un « droit à l’asile provisoire », dès la présentation d’une demande de protection. En effet, le fait pour un ressortissant de pays tiers de manifester sa volonté de solliciter une protection internationale suffit à lui conférer la qualité de demandeur d’asile[96]. Il en ira de même avec l’application du Règlement procédure[97], qui prévoit que, en cas de doute sur les intentions d’une personne, il faudra lui demander explicitement si elle souhaite bénéficier d’une protection internationale[98]. En découle, en principe, le droit de rester dans l’État membre pendant l’examen de sa demande[99]. En effet, un demandeur « ne peut, en principe, être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de l’État membre concerné, tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande en premier ressort, sauf à compromettre l’effectivité du droit d’asile, tel qu’il est garanti par l’article 18 de la Charte »[100]. En ce sens, le droit d’asile, garanti par l’article 18 de la Charte, accompagne et dépasse le principe de non-refoulement aux frontières extérieures. Non seulement le refoulement sommaire des personnes interceptées aux frontières serait contraire au principe de non-refoulement, tel que protégé en vertu des articles 18 et 19 CDFUE[101], mais ces personnes doivent être orientées vers les procédures nationales d’asile[102] et pouvoir demeurer sur le territoire le temps de l’examen de cette demande. Comme le rappelle l’Agence de l’Union européenne pour les droits fondamentaux, les demandes d’asile des ressortissants de pays tiers soumis à une « instrumentalisation » doivent être enregistrées et examinées conformément aux garanties procédurales ancrées dans l’acquis de l’Union en matière d’asile, et doivent respecter le droit à un recours effectif, conformément à l’article 47 de la Charte[103].
Ici, la Communication de la Commission du 11 décembre 2024 a pu être identifiée comme une tentative d’influer sur le traitement d’affaires pendantes devant la Cour EDH[104], qui concernent précisément des allégations de refoulements aux frontières extérieures de l’Union européenne avec la Biélorussie[105]. Même à envisager que la Cour EDH conclut à une interprétation évolutive de la Convention européenne des droits de l’homme dans le sens d’une restriction des droits protégés par la Convention, « il s’ensuivrait simplement que le droit de l’Union assurerait alors, aux articles 18 et 19[§2] de la Charte, une protection plus étendue que la CEDH, comme le permet expressément l’article 52[§3 CDFUE] »[106].
Toutefois, ce « droit d’asile provisoire » risque d’être fragilisé avec la mise en œuvre des instruments du Pacte européen sur la migration et l’asile.
D’abord, l’institutionnalisation d’une procédure de filtrage aux frontières extérieures aboutit à la création d’une véritable « fiction de non-entrée »[107]. En effet, les personnes soumises à la procédure de filtrage[108] ne seront pas autorisées à entrer sur le territoire[109], sans égard à la situation particulière des personnes à la recherche d’une protection internationale. L’instauration de cette « procédure préalable à l’entrée »[110] soulève des doutes quant à sa compatibilité avec l’article 18 de la Charte. En effet, la Cour de justice a déjà jugé qu’une « procédure préalable » imposée par la Hongrie avant le dépôt d’une demande d’asile sur son territoire méconnaissait la garantie du droit d’asile[111].
Ensuite, le Règlement procédure ajoute une exception au droit du demandeur de rester sur le territoire pendant la procédure lorsque celui-ci constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale[112]. Or, il ne s’agirait pas de considérer qu’un demandeur constitue un tel danger du seul fait qu’il soit victime d’une situation d’« instrumentalisation » des migrations.
De plus, le Règlement procédure prévoit des exceptions à l’effet suspensif de l’appel[113], dans plusieurs cas de figure. Or, c’est précisément le cas lorsqu’une demande de protection est rejetée, après examen au fond, dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière[114]. La généralisation du recours à la procédure d’asile à la frontière, en cas d’« instrumentalisation » des migrations, emporte donc le risque de fragiliser le « droit d’asile provisoire » aussi bien que le « droit à l’asile ». Ceci est particulièrement problématique dans l’éventualité où une première demande est refusée au fond, en violation du droit de l’Union européenne.
Enfin, il conviendra de déterminer dans quelle mesure la possibilité de confiner un demandeur d’asile dans le cadre de la procédure de filtrage, puis de la procédure d’asile à la frontière, est compatible avec le principe selon lequel un demandeur d’asile ne peut pas être considéré comme étant en séjour irrégulier jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande en première instance[115].
Conclusion
Finalement, force est de constater que les outils destinés à la lutte contre l’« instrumentalisation » des migrations ne viennent pas directement enrayer la mécanique selon laquelle des États tiers peuvent user de la pression migratoire comme d’un outil diplomatique[116]. En effet, la dimension externe de la politique d’immigration de l’Union européenne s’appuie largement sur la « coopération » des États tiers situés sur les routes migratoires à destination de l’Union, afin de contrôler les arrivées. Ces mêmes États tiers sont ainsi en mesure d’exercer une certaine pression sur l’Union et ses États membres[117], en utilisant un « effet de levier inversé ». Au-delà du cas de la Biélorussie, ce phénomène a d’ailleurs été observé le long de la frontière entre l’Espagne et le Maroc[118], ou encore entre la Grèce et la Turquie[119].
La Commission affirme que l’Union européenne « ne laissera aucun État hostile mettre à mal les valeurs européennes »[120]. Pourtant, la fragilisation du droit d’asile aux frontières extérieures de l’Union européenne met certainement à mal le « respect de la dignité humaine […] de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme »[121]. Face à l’impératif, porté par la Commission européenne, de « se défendre contre des menaces extérieures »[122] par l’adoption de mesures exceptionnelles, certains auteurs dénoncent, au contraire, le risque de céder aux préférences d’États tiers marqués par des régimes autoritaires[123] et préviennent du risque pour l’Union de devenir victime de ses propres démons[124].
Dans ce contexte, le droit d’asile de l’article 18 CDFUE peut encore être mobilisé par le juge, national comme européen. Consacrant un droit à un statut protecteur, conformément au droit dérivé de l’asile, l’effectivité du droit d’asile dépend de la possibilité de solliciter une protection dès l’arrivée aux frontières extérieures de l’Union, y compris en cas d’« instrumentalisation » des migrations.
Notes de bas de page
- [1] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la lutte contre les menaces hybrides résultant de l’instrumentalisation de la migration ainsi qu’au renforcement de la sécurité aux frontières extérieures de l’UE, COM(2024) 570 final, 11 décembre 2024, p. 7.
- [2] Voir notamment HCR, Observations on the Order of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia on the Declaration of Emergency Situation (No 518), 13 octobre 2021, disponible en ligne [refworld.org] ; ECRE, Extraordinary Responses: Legislative Changes in Lithuania, 2021, ECRE’s assessment of recent changes to asylum legislation in Lithuania and their impact, with reference to compliance with EU and international law, legal note no 11, 2021, disponible en ligne [ecre.org]; HCR, Observations on the draft law amending the Act on Foreigners and the Act on Granting Protection to Foreigners in the territory of the Republic of Poland (UD265), 16 septembre 2021, disponible en ligne [refworld.org].
- [3] Voir notamment The Black Book of Pushbacks, décembre 2022, disponible en ligne[acrobat.adobe.com]. Voir aussi AIDA et ECRE, Poland Country Report, Access to the Territory and Push Backs, dernière mise à jour le 15 juillet 2025, disponible en ligne [asylumineurope.org] et AIDA et ECRE, Lithuania Country Report, Access to the Territory and Push Backs, dernière mise à jour le 15 juillet 2025, disponible en ligne [asylumineurope.org].
- [4] Voir notamment Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Repoussés au-delà des limites. Quatre domaines d’action urgente pour faire cesser les violations des droits de l’homme aux frontières de l’Europe, mars 2022, disponible en ligne [coe.int], p. 8 ; CDH, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, Felipe González Morales. Visite en Pologne, A/HRC/53/26/Add.1, 21 avril 2023, disponible en ligne [un.org] ; APCE, Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations, Rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (Rapporteur : M. Pierre-Alain FRIDEZ), Doc. 15604, 12 septembre 2022 ; A. Radjenovic Anja, Pushbacks at the EU’s external borders, Briefing, Service de recherche du Parlement européen, PE 689.368, mars 2021, disponible en ligne [europarl.europa.eu] ; K. Luyten, Addressing pushbacks at the EU’s external borders, Briefing, Service de recherche du Parlement européen, PE 738.191, octobre 2022, disponible en ligne [europarl.europa.eu] ; S. Ganty, A. Ancite-Jepifanova, D.V. Kochenov, « EU Lawlessness Law at the EU-Belarusian Border: Torture and Dehumanisation Excused by ‘Instrumentalisation’ », Hague Journal on the Rule of Law, 2024, disponible en ligne [link.springer.com].
- [5] Voir notamment Cour EDH, 11 décembre 2018, M.A. et autres c. Lituanie, req. no 59793/17 ; Cour EDH, 23 juillet 2020, M.K. et autres c. Pologne, req. no 40503/17, 42902/17 et 43643/17 ; Cour EDH, 8 juillet 2021, D.A. et autres c. Pologne, req. no 51246/17 ; Cour EDH, 30 juin 2022, A.I. et autres c. Pologne, req. no 39028/17 ; Cour EDH, 30 juin 2022, A.B. et autres c. Pologne, req. no 42907/17 ; Cour EDH, 7 juillet 2022, Safi et autres c. Grèce, req. no 5418/15 ; Cour EDH, 13 octobre 2022, T.Z. et autres c. Pologne, req. no 41764/17 ; Cour EDH, 16 janvier 2023, Alkhatib et autres c. Grèce, req. no 3566/16 ; Cour EDH, 2 février 2023, Alhowais c. Hongrie, req. no 59435/17 ; Cour EDH, 5 octobre 2023, Shahzad c. Hongrie (no 2), req. no 37967/18. Voir aussi CJUE, 30 juin 2022, M.A. c. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, aff. C-72/22 PPU ; CJUE, 29 février 2024, X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), aff. C‑392/22, §§ 50-57.
- [6] Voir la lettre envoyée par la Comission LIBE du Parlement européen à la Commission européenne, en date du 10 février 2022, disponible en ligne [twitter.com].
- [7] CJUE, 30 juin 2022, M.A. c. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, aff. C-72/22 PPU.
- [8] Voir Proposition de Décision du Conseil relative à des mesures provisoires d’urgence en faveur de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne, COM(2021) 752 final, 1er décembre 2021, pp. 1-5.
- [9] Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faire face aux situations d’instrumentalisation dans le domaine de la migration et de l’asile, COM(2021) 890 final, 14 décembre 2021.
- [10] Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (« Règlement crise »), J.O., série L, 22 mai 2024.
- [11] Pour une vision d’ensemble, voir [home-affairs.ec.europa.eu] ; P. De Bruycker, « Genealogy of and futurology on the pact on migration and asylum », EU Immigration and Asylum Law and Policy, 6 mai 2024, disponible en ligne [eumigrationblog.eu].
- [12] Règlement (UE) 2024/1717 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen), J.O., série L, 20 juin 2024.
- [13] Voir I. Goldner Lang, « Instrumentalisation of Migrants: It is Necessary to Act, but How? », EU Immigration and Asylum Law and Policy, 15 octobre 2024, disponible en ligne [eumigrationblog.eu].
- [14] Voir M. Gkliati, « Let’s Call It what It Is: Hybrid Threats and Instrumentalisation as the Evolution of Securitisation in Migration Management », European Papers – Carnets Européens, vol. 8, 2023, no 2, pp. 561-578, disponible en ligne [europeanpapers.eu] ; J. M. Porras Ramirez, « El nuevo Reglamento de la UE sobre las situaciones de crisis y fuerza mayor en la migración y el asilo: o como supeditar la solidaridad a la seguridad », La Ley Unión Europea, nº 125, mai 2024.
- [15] Voir V. Chetail, « L’instrumentalisation des migrations et la tentation de l’état d’urgence permanent : le droit européen d’asile en question », Annuaire Français de Droit International, vol. 67, no 1, 2021, pp. 437‑447.
- [16] Voir V. Moreno-Lax, « The “Crisification” of Migration Law: Insights from the EU External Border », in S. Burch Ellias, K. Cope, J. Goldenziel (dirs.), The Oxford Handbook of Comparative Immigration Law, Oxford, Oxford University Press (à paraître), disponible en ligne [ssrn.com], en particulier pp. 21 s.
- [17] COM(2024) 570 final, op. cit.
- [18] Voir Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 72.
- [19] CJUE, 2 avril 2020, Commission européenne c. République Tchèque, Hongrie et République de Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale), aff. C-715/17, C-718/17 et C-719/17, §§ 143-147.
- [20] Voir Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 52§1.
- [21] Ibid.
- [22] COM(2024) 570 final, op. cit., p. 7.
- [23] TUE, 30 mars 2022, RT France c. Conseil de l’UE (ordonnance), T-125/22. Le Tribunal de l’UE a également rejeté le recours formé contre cette ordonnance. Voir TUE (grande chambre), 27 juillet 2022, RT France c. Conseil de l’UE, T-125/22.
- [24] COM(2024) 570 final, op. cit., p. 8.
- [25] Voir AGNU, Déclaration sur l’asile territorial, résolution 2312 (XXII), 14 décembre 1967, article 1§1. Voir aussi D. Lopez Garrido, El derecho de asilo, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, Trotta, coll. Estructuras y procesos: serie Derecho, 1991, pp. 15 s. ; F. Moderne, Le droit constitutionnel d’asile dans les États de l’Union européenne, Paris, Economica, coll. Droit public positif, 1997, pp. 24 s.
- [26] Voir en particulier M.-T. Gil Bazo, « The Charter of fundamental rights of the European Union and the right to be granted asylum in Union’s law », Refugee Survey Quarterly, vol. 27, no 3, 2008, pp. 33-55. Voir aussi N. Arenas Hidalgo, « El derecho de asilo en la carta (article 18 CDFUE): un corolario esencial del “sistema europeo común de asilo” », in P. A. Fernandez Sanchez (dir.), Integración europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro integrado, Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, coll. Estudios constitucionales, 2009, pp. 513-539 ; M. Den Heijer, « Article 18 », in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward (dirs.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford, Hart, 2014, notamment p. 535, § 18.38 ; S. Bodart, « Article 18. Droit d’asile », in F. Picod, S. Rizcallah, S. Van Drooghenbroeck (dirs.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 417-418, § 4 ; T. Locke, « Article 18 CFR », in M. Kellerbauer, M. Klamert, J. Tomkin (dirs.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights : A Commentrary, Oxford, Oxford University Press, 2019, pp. 2153-2154, § 1.
- [27] Voir notamment M.-L. Basilien-Gainche, « Sécurité des frontières et/ou protection des droits », Cités, vol. 2, no 46, 2011, pp. 47-68 ; B. Mikolajczyk, « Polish law restricting the right to asylum at borders », EU Immigration and Asylum Law and Policy, 3 juillet 2025, disponible en ligne [eumigrationblog.eu] ; J. Pirjola, « Hostile Instrumentalized Migration and the Right to Seek Asylum », Eur. J. Mig. & Law, vol. 27, no 1, no 3-4, 2025, pp. 1-19 ; M. Mouzourakis, « Asylum bans in the European Union: How states break the law and get away with it », Heinrich Böll Foundation, 21 aout 2025, disponible en ligne [gr.boell.org].
- [28] Entre le 1er décembre 2009 et le 4 juillet 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a fait mention de l’article 18 CDFUE, dans son raisonnement, dans 41 arrêts et ordonnances. 37 de ces 41 décisions ont été prises depuis 2017.
- [29] CJUE, 30 juin 2022, M.A. c. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, aff. C-72/22 PPU, §§ 61-62.
- [30] Ibid., § 63.
- [31] CJUE, 17 décembre 2020, Commission c. Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), C-808/18, § 102.
- [32] Voir Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (« Règlement procédure »), J.O., série L, 22 mai 2024, Chapitre III, Section 1 Accès à la procédure, article 26 (présentation), 27 (enregistrement) et 28 (introduction) (applicable à partir du 12 juin 2026).
- [33] CJUE, 22 juin 2023, Commission européenne c. Hongrie (Déclaration d’intention préalable à une demande d’asile), aff. C-823/21.
- [34] Ibid., § 52.
- [35] CJUE, 30 juin 2022, M.A. c. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, aff. C-72/22 PPU, § 72.
- [36] Voir notamment CJUE, 17 décembre 2020, Commission européenne c. Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), aff. C-808/18, §§ 222-224.
- [37] CJUE, 30 juin 2022, M.A. c. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, aff. C-72/22 PPU, § 74.
- [38] Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Countering the instrumentalisation of migrants and refugees and respecting fundamental rights, 25 juillet 2025, disponible en ligne [fra.europa.eu], p. 5, § 4 : « De jure or de facto denial of access to asylum procedures breaches Article 18 of the Charter on the right to asylum ».
- [39] Règlement (UE) 2024/1359 (Règlement crise), op. cit., considérant no 18 (applicable à partir du 1er juillet 2026).
- [40] N. Emiliou, Conclusions présentées le 2 juin 2022 dans l’affaire M.A. c. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, aff. C-72/22 PPU, § 137.
- [41] FRA, Countering the instrumentalisation of migrants and refugees and respecting fundamental rights, 25 juillet 2025, disponible en ligne [fra.europa.eu], p. 11, § 37 : « key aspect » et « essential element ».
- [42] Règlement (UE) 2024/1348 (Règlement procédure), op. cit., article 30§3 (applicable à partir du 12 juin 2026) ; Règlement (UE) 2024/1359 (Règlement crise), op. cit., article 11§10 (applicable à partir du 1er juillet 2026).
- [43] Règlement (UE) 2024/1348 (Règlement procédure), op. cit., article 30§3 ; Règlement (UE) 2024/1359 (Règlement crise), op. cit., article 11§10.
- [44] Ibid.
- [45] CJUE, 3 juin 2025, Kinsa, C‑460/23, § 62.
- [46] Ibid.
- [47] Voir CJUE, 3 juin 2025, Kinsa, C‑460/23.
- [48] Voir CJUE, 16 novembre 2021, Commission européenne c. Hongrie (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile) [GC], C-821/19.
- [49] Ibid., § 133.
- [50] Voir Règlement (UE) 2024/1359 (Règlement crise), article 1§4(b) (applicable à partir du 1er juillet 2026).
- [51] Voir ibid., respectivement considérant no 15 et 16.
- [52] Code frontières Schengen tel que modifié par le Règlement (UE) 2024/1717, op. cit., article 5§4.
- [53] Ibid.
- [54] Voir CJUE, 17 décembre 2020, Commission européenne c. Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), aff. C-808/18.
- [55] Règlement (UE) 2024/1717, op. cit., considérant no 14.
- [56] Code frontières Schengen tel que modifié par le Règlement (UE) 2024/1717, op. cit., article 5§4 al. 2(c).
- [57] CJUE, 22 juin 2023, Commission européenne c. Hongrie (Déclaration d’intention préalable à une demande d’asile), aff. C-823/21.
- [58] Ibid., § 56.
- [59] Ibid., § 59.
- [60] Ibid.
- [61] Ibid., § 57 : par analogie, afin de limiter la propagation d’une maladie contagieuse.
- [62] Ibid.
- [63] Voir notamment CJUE, 17 décembre 2020, Commission européenne c. Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), aff. C-808/18, §§ 222-224.
- [64] Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (« Règlement filtrage »), J.O., série L, 22 mai 2024 (applicable à partir du 12 juin 2026). Présenté par la Commission comme un outil de gestion des arrivées de « flux mixtes » aux frontières extérieures (associant des personnes dans le besoin d’une protection internationale et des personnes ne pouvant prétendre à une telle protection), le filtrage doit assurer l’identification rapide des personnes et leur orientation vers une procédure de retour ou, le cas échéant, vers une procédure d’examen de leur demande de protection internationale.
- [65] Règlement (UE) 2024/1356 (Règlement filtrage), op. cit., article 1. Le Règlement filtrage est fondé sur l’article 77§2(b) et (d) : respectivement les « contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures » et l’« établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures ».
- [66] Ibid.
- [67] Règlement (UE) 2024/1356 (Règlement filtrage), op. cit., article 15.
- [68] COM(2024) 570 final, op. cit., p. 2.
- [69] CJUE, 30 juin 2022, M.A. c. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, aff. C-72/22 PPU, § 74.
- [70] Dans le cadre du Pacte, la procédure à la frontière sera rendue obligatoire dans 3 cas de figures : soit que le demandeur a induit les autorités en erreur, soit qu’il représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres, soit qu’il provient d’un pays tiers pour lequel le taux de décisions positives est inférieur à 20 %. Voir Règlement (UE) 2024/1348 (Règlement procédure), op. cit., article 45§1 (applicable à partir du 12 juin 2026).
- [71] Pour une définition des situations de « crise » ou de « force majeure » voir Règlement (UE) 2024/1359 (Règlement crise), op. cit., article 1§4 et 5 (applicable à partir du 1er juillet 2026). La situation d’« instrumentalisation » y est identifiée comme une situation de « crise » (article 1§4(b)).
- [72] Ibid., article 10§1.
- [73] Ibid., article 10§6.
- [74] Ibid., article 11§1.
- [75] Ibid., article 11§6. Seules deux exceptions sont prévues, dans le cas des mineurs de moins de douze ans et des membres de leur famille, ainsi que des personnes ayant des besoins spéciaux (article 11§7).
- [76] Ibid., article 11§10.
- [77] Le recours à la procédure à la frontière est associé à l’accélération de cet examen au fond, voir Règlement (UE) 2024/1348 (Règlement procédure), op. cit., article 44§1(b) (applicable à partir du 12 juin 2026).
- [78] CJUE, 14 mai 2020, FMS, FNZ SA et SA junior c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, aff. C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, § 192.
- [79] CJUE, 29 février 2024, X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), aff. C‑392/22, § 51. Voir aussi aussi CJUE, 8 février 2024, A.A. c. Bundesrepublik Deutschland (Recevabilité d’une demande ultérieure), aff. C-216/22, § 39.
- [80] Voir CJUE, 14 mai 2020, FMS, FNZ SA et SA junior c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, aff. C-924/19 PPU et C-925/19 PPU.
- [81] Pour une définition du concept de « pays tiers sûr », voir Directive 2013/32/UE (Directive procédure – refonte), op. cit., article 38.
- [82] CJUE, 14 mai 2020, FMS, FNZ SA et SA junior c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, aff. C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, § 196.
- [83] Rappelons que la Directive procédure vise à « favoriser l’application » de l’article 18 CDFUE (considérant n° 60), et que la Directive qualification « vise à garantir le plein respect […] du droit d’asile » (considérant no 16). Des formulations similaires peuvent être trouvées dans le Règlement procédure (considérant n° 108) et le Règlement qualification (considérant n° 11), applicables à partir du 12 juin 2026.
- [84] N. Jaaskinen, Conclusions présentées le 18 avril 2013 dans l’affaire Bundesrepublik Deutschland c. Kaveh Puid, aff. C-4/11, § 49.
- [85] Voir S. Bodart, « Article 18. Droit d’asile », in F. Picod, S. Rizcallah, S. Van Drooghenbroeck (dirs.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles : Bruylant, 2017, pp. 439-440.
- [86] M.-T. Gil Bazo, « The Charter of fundamental rights of the European Union and the right to be granted asylum in Union's law », Refugee Survey Quarterly, vol. 27, no 3, 2008, p. 52 : « the right to asylum in article 18 of the Charter is to be construed as a subjective and enforceable right of individuals to be granted asylum under the Union’s law ». Voir aussi de la même auteure, « Refugee Status and Subsidiary Protection under EC Law: The Qualification Directive and the Right to Be Granted Asylum », in A. Baldaccini, E. Guild, H. Toner (dirs.), Whose freedom, security and justice? EU immigration and asylum law and policy, Oxford, Hart, 2007, coll. Essays in European Law, pp. 229-264.
- [87] Voir CJUE, 14 mai 2020, FMS, FNZ SA et SA junior c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, aff. C-924/19 PPU et C-925/19 PPU ; voir aussi CJUE, 8 février 2024, A.A. c. Bundesrepublik Deutschland (Recevabilité d’une demande ultérieure), aff. C-216/22.
- [88] N. Emiliou, Conclusions présentées le 7 septembre 2023, Bundesrepublik Deutschland, aff. C-216/22, § 57.
- [89] Ibid., § 58.
- [90] Voir Directive 2011/95/UE (Directive qualification – refonte), op. cit., article 14§4 et 5. Voir aussi Règlement (UE) 2024/1347 (Règlement qualification), op. cit., article 14§1 et 2 (applicable à partir du 12 juin 2026).
- [91] Voir Directive 2013/32/UE (Directive procédure – refonte), op. cit., article 33§2(c) et article 38. Voir aussi Règlement (UE) 2024/1348 (Règlement procédure), article 38§1(b) et article 59 (applicable à partir du 12 juin 2026).
- [92] Voir CJUE, 30 juin 2022, M.A. c. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, aff. C-72/22 PPU, § 74.
- [93] CJUE, 16 novembre 2021, Commission européenne c. Hongrie (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile) [GC], C-821/19, § 133.
- [94] Voir Cour EDH, 13 février 2020, N.D. et N.T. c. Espagne [GC], req. no 8675/15 et no 8697/15, § 200. Voir aussi Cour EDH, 5 avril 2022, A.A. et autres c. Macédoine du Nord, req. no 55798/16, § 114.
- [95] Cour EDH, 13 février 2020, N.D. et N.T. c. Espagne [GC], req. no 8675/15 et no 8697/15, § 201.
- [96] Voir notamment CJUE, 25 juin 2020, Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale), C-36/20 PPU, §§ 86-94.
- [97] Voir Règlement (UE) 2024/1348 (Règlement procédure), op. cit., article 3§13 (définition du demandeur d’asile) et 26 (présentation d’une demande de protection internationale) (applicable à partir du 12 juin 2026).
- [98] Ibid., article 26§1.
- [99] Directive 2013/32/UE (Directive procédure – refonte), op. cit., article 9. Voir aussi Règlement (UE) 2024/1348 (Règlement procédure), op. cit., article 10. Ce droit de rester sera exercé « jusqu’à l’expiration du délai dans lequel [les demandeurs d’asile] peuvent exercer leur droit à un recours effectif devant une juridiction de première instance et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours ».
- [100] CJUE, 3 juin 2025, Kinsa, C‑460/23, § 61.
- [101] FRA, Countering the instrumentalisation of migrants and refugees and respecting fundamental rights, 25 juillet 2025, disponible en ligne [fra.europa.eu], p. 25, § 118. Pour rappel, l’article 19 de la Charte consacre l’interdiction des expulsions collectives (§ 1) et le principe de non-refoulement (§ 2).
- [102] Ibid., p. 25, § 117. Voir aussi pp. 31-32, § 153.
- [103] Ibid., p. 26, § 124.
- [104] Voir notamment M. Stiller, « How the EU Commission Backs up Pushbacks at the EU-Belarussian Border », Verfassungsblog, 7 janvier 2025, disponible en ligne [verfassungsblog.de] ; D. Thym, « Does the Commission Cross the Rubicon? Legalising ‘Pushbacks’ on the Basis of Article 72 TFEU », EU Immigration and Asylum Law and Policy, 10 janvier 2025, disponible en ligne [eumigrationblog.eu].
- [105] Voir notamment R.A. et autres c. Pologne, req. no 42120/21 ; H.M.M. et autres c. Lettonie, req. no 42165/21 ; C.O.C.G. et autres c. Lituanie, req. no 17764/22. Des audiences de grande chambre concernant ces affaires ont été tenues le 12 février 2025. Ces trois affaires font partie de plus de 30 affaires de même type, actuellement pendantes devant la Cour contre la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.
- [106] N. Emiliou, Conclusions présentées le 2 juin 2022 dans l’affaire M.A. c. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, aff. C-72/22 PPU, § 143.
- [107] Pour une critique en ce sens voir notamment HCR, UNHCR’s Recommendations for the Swedish and Spanish Presidencies of the Council of the European Union (EU), janvier 2023, disponible en ligne [refworld.org]. Le Haut Commissariat use aussi de la formule de « fiction de pré-entrée » (« pre-entry fiction »).
- [108] Cette procédure est applicable à toutes les personnes qui ont franchi la frontière extérieure de façon irrégulière, ont demandé une protection internationale lors des vérifications aux frontières, ou ont été débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. Voir Règlement (UE) 2024/1356 (Règlement filtrage), op. cit., article 1(a).
- [109] Règlement (UE) 2024/1356 (Règlement filtrage), op. cit., article 6.
- [110] Voir la proposition initiale de la Commission européenne visant l’établissement d’un filtrage : COM(2020) 612 final, pp. 1, 8, 25 et 43.
- [111] Voir CJUE, 22 juin 2023, Commission européenne c. Hongrie (Déclaration d’intention préalable à une demande d’asile), aff. C-823/21.
- [112] Règlement (UE) 2024/1348 (Règlement procédure), op. cit., article 10§4(c) (applicable à partir du 12 juin 2026).
- [113] Ibid., article 68§3.
- [114] Ibid., article 68§3(a)(ii). Cette exception ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés.
- [115] Voir CJUE, 3 juin 2025, Kinsa, C‑460/23, § 61.
- [116] Voir notamment M. Sie Dhian Ho, M. Wijnkoop, « The instrumentalization of migration. A geopolitical perspective and toolbox », Clingendael Report, décembre 2022, disponible en ligne [clingendael.org].
- [117] Voir E. Guild, « The Pitfalls of Migration Diplomacy: The EU Pact and Relations with Third Countries in Reforming », in D. Thym, Odysseus Academic Network (dirs.), Reforming the Common European Asylum System. Opportunities, Pitfalls, and Downsides of the Commission Proposals for a New Pact on Migration and Asylum, Nomos, coll. Schriften zum Migrationsrecht, vol. 38, 2022, disponible en ligne [nomos-elibrary.de], pp. 209-222 et en particulier p. 218.
- [118] En mai 2021, par exemple, plus de 8 000 personnes ont franchi la frontière de l’enclave espagnole de Ceuta avec le Maroc en moins de 24 heures, face à la passivité des garde-frontières marocains. À la fin du mois d’avril de la même année, le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali, était accueilli en Espagne pour y être soigné du Covid-19, entrainant des tensions entre les deux pays. Voir notamment « Ceuta : la moitié des 8 000 migrants entrés dans l’enclave lundi a été expulsée par Madrid », Le Monde, 18 mai 2021, disponible en ligne [lemonde.fr].
- [119] Le 28 février 2020, le chef d’État turc Recep Tayyip Erdogan a menacé de ne plus contrôler les arrivées de personnes depuis la Turquie vers l’Union, en contradiction avec la Déclaration UE-Turquie, du fait d’un manque qu’il reproche à l’Europe dans un contexte de tensions avec la Syrie et la Russie. Voir notamment, « Erdogan ouvre les portes de l’Europe aux migrants », Le Temps, 29 février 2020, disponible en ligne [letemps.ch].
- [120] COM(2024) 570 final, op. cit., p. 9.
- [121] Traité sur l’Union européenne, article 2.
- [122] COM(2024) 570 final, op. cit., p. 8.
- [123] Voir J.-P. Cassarino, « Multi-layered Cooperation on Readmission in the Euro-Mediterranean and Euro-African Areas », in J.-P. Cassarino (dir.), L. Gabrielli, D. Perrin, , Cooperation on Readmission in the Euro-Mediterranean Area and Beyond: Lessons Learned and Unlearned, IEMed, Euromesco Policy Study, no 28, 2023, pp. 20-39, disponible en ligne [euneighbours.eu]. Voir aussi I. Mandraud, « Contre l’Europe, l’arme migratoire des régimes autoritaires », Le Monde, 29 novembre 2021, disponible en ligne [lemonde.fr].
- [124] Voir V. Chetail, « L’instrumentalisation des migrations et la tentation de l’état d’urgence permanent : le droit européen d’asile en question », Annuaire Français de Droit International, vol. 67, no 1, 2021, pp. 437‑447.