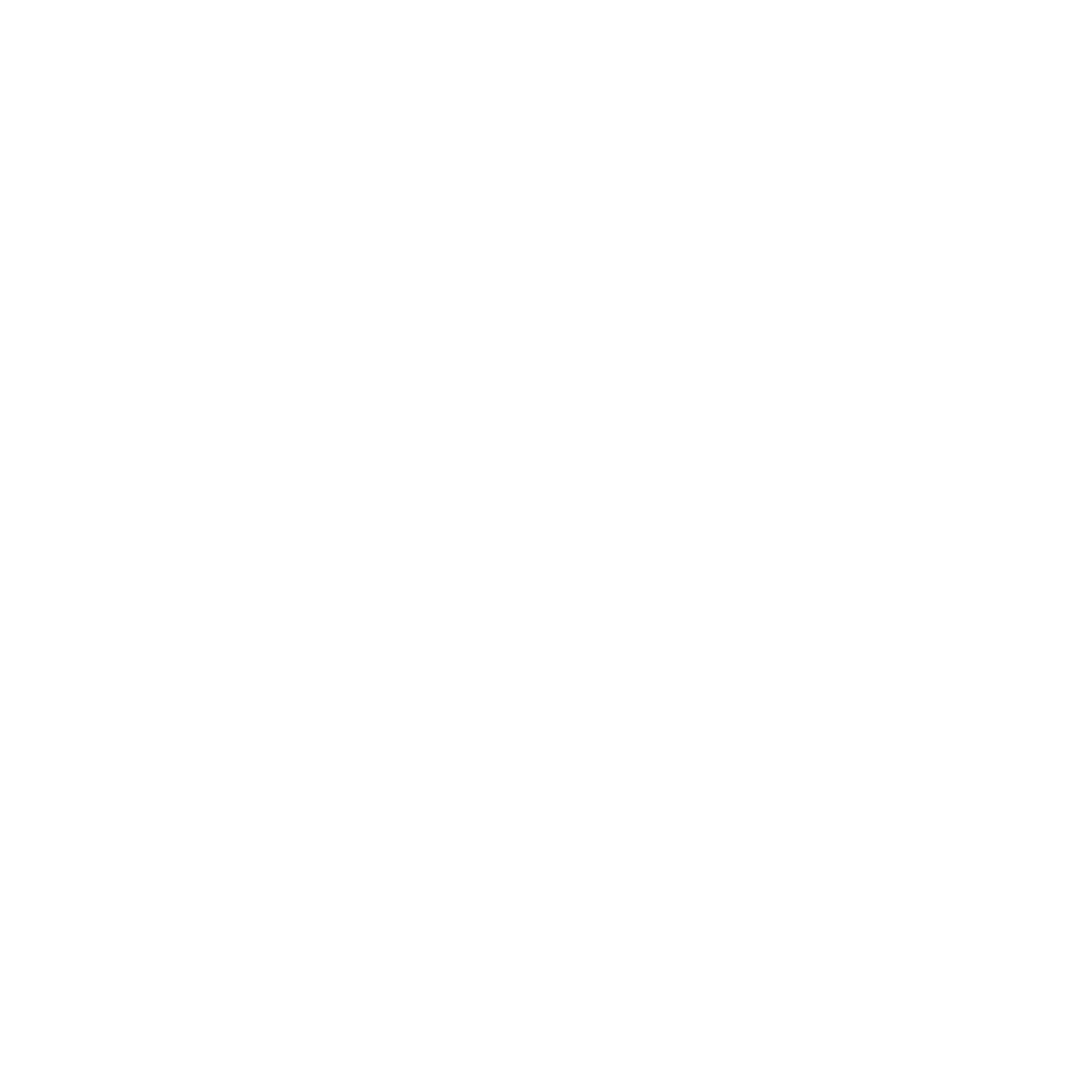Franchir les frontières en toute sécurité présente un intérêt tant pour les personnes ayant besoin d'une protection internationale, que pour les États d'accueil : d'une part, des milliers de personnes meurent en route vers l'Europe et d'autres risquent d'entreprendre des voyages dangereux par mer et par terre à la recherche de sécurité et/ou d'une vie meilleure[1] ; d'autre part, près de 400 000 personnes sont arrivées irrégulièrement en Europe en 2023[2], ce qui représente un grave problème politique – voire sécuritaire, aussi bien pour l'Union européenne (ci-après « UE »), que pour ses États membres, en raison des atteintes à la prérogative souveraine des États de contrôler leurs frontières[3]. Dans ce contexte, les voies légales promettent de répondre à deux préoccupations étroitement liées: réduire, sinon supprimer, la nécessité pour les réfugiés d'entreprendre des voyages dangereux et risqués en mer comme sur terre, et ce faisant, réduire les arrivées irrégulières.
Afin de comprendre si et comment les voies légales de protection pourraient relever avec succès les objectifs susmentionnés, il faut d'abord comprendre ce qu'elles sont. L’entreprise se révèle rapidement très ardue, puisqu’ il n'existe pas de définition commune des voies légales. Si celles-ci « regroupent, de manière générale, l'ensemble des mécanismes qui permettent un accès légal et sécurisé à une protection effective sur le territoire de l'État d'accueil depuis un pays de transit ou un pays d'origine »[4], une diversité de termes désigne toutefois les processus et les pratiques permettant aux personnes ayant besoin d'une protection internationale d'entrer et de séjourner légalement sur le territoire de l'État d'accueil.
Les idées qui sous-tendent les voies légales ne sont pas nouvelles, mais la notion en tant que telle est très récente[5]. Elle est apparue pour la première fois dans la Déclaration de New York de 2016[6], précurseur du Pacte mondial sur les réfugiés (ci-après « PMR »)[7] adopté en 2018. La Déclaration précise que :
« L'objectif est d'offrir des places de réinstallation et d'autres voies légales d'admission à une échelle qui permette de répondre aux besoins annuels de réinstallation identifiés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés »[8].
En outre, dans son annexe I, la Déclaration explique le lien entre les voies légales et les « voies complémentaires », en précisant que « [des mesures doivent être prises] pour rechercher les solutions durables suivantes : rapatriement volontaire, solutions locales, réinstallation et voies d'admission complémentaires »[9]. Il en résulte que les voies légales sont un terme plus large qui inclut à la fois la réinstallation et les voies complémentaires et s'adressent aux personnes ayant besoin d'une protection internationale.
Si la réinstallation fait l'objet d'une définition a priori fixe, élaborée par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après « HCR ») dans son Manuel sur la réinstallation, selon laquelle elle « implique la sélection et le transfert de réfugiés d'un État dans lequel ils ont cherché protection vers un État tiers qui a accepté de les admettre - en tant que réfugiés - avec un statut de résident permanent »[10], la notion de voies complémentaires est plus mouvante[11]. Elle a été évoquée – sans être définie – dans le PMR, qui considère les voies complémentaires comme l'un des moyens de faire face aux mouvements de réfugiés à grande échelle et aux situations de réfugiés prolongées[12]. Une définition est néanmoins fournie dans un document d'orientation du HCR, en vertu duquel les voies complémentaires sont « des voies sûres et réglementées pour les réfugiés qui complètent la réinstallation en offrant un séjour légal dans un pays tiers où leurs besoins en matière de protection internationale sont satisfaits »[13]. S’y insèrent : les programmes de parrainage privés ou communautaires, qui s'ajoutent à la réinstallation ordinaire, aux visas humanitaires, aux couloirs humanitaires et autres programmes d'admission humanitaire ainsi qu’aux possibilités d'éducation et de mobilité professionnelle pour les réfugiés[14]. Tout comme pour la réinstallation[15], les États ne sont pas tenus d’ouvrir des voies complémentaires mais, contrairement à la réinstallation[16], une fois ces voies complémentaires mises en œuvre, les aspects relatifs au séjour (en particulier à long terme) et aux solutions durables ne sont pas garantis[17].
Ainsi défrichée, la notion de voies légales montre la complexité des différents mécanismes d'admission et de séjour légaux dans les pays tiers et les différences subtiles qui existent entre eux. Compte tenu de cette situation au niveau international, il n'est pas surprenant qu'au moment de la mise en œuvre au niveau national, la situation soit à peine plus claire, voire plus compliquée. Afin d'illustrer la manière dont les voies légales sont réglementées et mises en œuvre au niveau national, cet article se concentre sur l'exemple de la France.
La France reste l'un des principaux pays de destination des demandeurs d'asile dans l'UE[18]. La situation géographique du pays explique certaines spécificités liées à la question de l'accès à l'asile. Étant donné que les principaux flux de réfugiés vont du Sud vers le Nord[19], la France ne peut pas être considérée comme étant à l'avant-garde de ces mouvements, contrairement à d'autres pays méditerranéens. Une caractéristique des frontières intérieures françaises est la réintroduction des contrôles aux frontières, depuis 2015, sur la base de deux dispositions du « Code frontières Schengen »[20]. Cette pratique obscurcit l'accès à l'asile en France et peut être contraire au principe de non-refoulement[21].
Mais si le gouvernement français déploie d'importants efforts pour empêcher les entrées irrégulières, y compris à des fins d'asile, cela signifie-t-il qu'il a ouvert des voies légales de protection[22] ? Des initiatives concrètes, entreprises par divers acteurs (organisations internationales, ONG, universités, entreprises, communautés religieuses) en coopération avec les autorités françaises, ont été identifiées comme des exemples de voies légales en France[23]. Il s'agit notamment de la réinstallation, des visas d'asile, des couloirs humanitaires, des couloirs universitaires, d'un programme naissant de mobilité de la main-d'œuvre, ainsi que du regroupement familial[24]. Ces initiatives, bien que relativement modestes, ne sont guère récentes, mais se sont développées de manière significative dans le contexte de la « crise des réfugiés » en 2015. La France a par exemple réinstallé des réfugiés à chacune des grandes crises – hongroise, indochinoise, etc. – et se positionne depuis peu comme un État de réinstallation majeur en Europe, devenant ainsi un objet d’étude particulièrement intéressant en matière de voies légales[25].
Le terme préféré pour désigner les voies légales en français est celui de « voies légales et sûres ». Cependant, ce n’est pas la seule manière de parler des voies légales dans le discours public. On utilise également les expressions « voies d’accès sûres », « voies complémentaires d’admission » ou encore en faisant référence à une voie spécifique[26]. Cette situation témoigne d'un niveau élevé de fragmentation des pratiques en matière de voies légales et sûres et de l'absence d'une compréhension commune de la question. Une réglementation peut-elle aider à résoudre ce problème ou, au contraire, contribuer à l'aggraver ?
Cet article s'interroge alors, premièrement, sur la manière dont les voies légales et sûres, en particulier la réinstallation et les couloirs humanitaires, sont réglementées dans la législation française et sur la manière dont elles sont mises en œuvre dans la pratique, et deuxièmement, sur les implications de cette réglementation et de cette mise en œuvre sur la promesse d’offrir des entrées régulières aux fins d'asile.
En utilisant une approche juridique et politique, notre recherche montre qu'il n'y a pas ou pas suffisamment de réglementation juridique des voies légales dans la législation française (I). Ce fait permet une flexibilité dans la pratique qui convient aux différentes parties participant au processus de mise en œuvre. La flexibilité peut également être considérée comme un avantage qui rend les voies légales possibles dans un contexte politiquement conflictuel. Toutefois, en l'absence de réglementation claire, il n'y a pas de garanties de prévisibilité et de régularité de la procédure tant pour les bénéficiaires de ces voies, que pour les organisations qui les mettent en œuvre. De plus, cette situation ne contribue pas à réduire la fragmentation des voies légales, ce qui soulève la question de l'opportunité de leur régulation non seulement en France, mais également de manière plus large (II).
I. Les voies légales en France : à la périphérie du droit
Les voies légales constituent des modes « d’accès à la procédure d’asile depuis l’étranger » à côté des modes « d’accès à la frontière » ou sur le territoire[27]. Mais qu’elle ait lieu depuis l’étranger ou à la frontière, la procédure d’accès à l’asile en France est encadrée par le droit de l’asile. Ce droit a connu des évolutions à la faveur de multiples réformes (plus de 16 depuis 1980)[28], toutes portées par l’idée de le rationaliser – voire le durcir – et dont l’ensemble est consigné principalement dans le livre V du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « CESEDA »)[29] lequel s'adresse à une diversité d’acteurs, aux premiers rangs desquels figurent le Ministère de l’Intérieur, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après « OFPRA ») en charge de l’enregistrement et examen des demandes d’asile et la Cour nationale du droit d’asile (ci-après « CNDA ») chargée du contentieux de l’asile[30]. Le récent durcissement des dispositions du CESEDA régissant l'accès au territoire français, y compris à des fins d'asile[31], a-t-il eu une incidence sur la régulation des voies légales ?
Malgré ces nombreuses évolutions, et ainsi qu’on le constatera, les voies légales se situent à la périphérie du droit de l’asile – voire du droit tout court – alors que leur existence est constatée depuis longtemps[32]. Mais, bien qu’étant à la marge du droit, toutes les voies d’accès à la protection en France ne sont pas régulées de la même manière. Une sorte de summa divisio s’est en fait tissée en la matière : la réinstallation jouit d’un traitement légèrement différent par rapport aux autres voies. Le mécanisme a connu un début d’encadrement, ce qui a atténué – certes très timidement - son absence de cadre juridique (A) alors que les autres voies – dont les corridors humanitaires qui nous intéressent ici - n’ont pas encore connu une telle opération, de sorte qu’elles sont maintenues dans une forme de vide juridique (B).
A. La modeste atténuation du vide juridique
Depuis quelques années, la réinstallation dispose d’un traitement plus spécifique dans l’ordre juridique français. Alors que le mécanisme a été introduit par la loi et se déploie au moyen de quelques actes administratifs et autres documents[33], son émanation en droit français résulte d’une réception du droit international dans l’ordre juridique interne.
L’accord conclu le 4 février 2008 entre le gouvernement de la République française et le HCR lance les premiers jalons du cadre de la réinstallation en France[34]. Cet accord général, qui fixe les contours de la collaboration entre le HCR et la France, prévoit ainsi en son article 5 que:
« sur la base des soumissions du HCR, transmises à la Représentation de la France auprès des Nations Unies à Genève, la République française examinera les dossiers des réfugiés dont la réinstallation sur le territoire national est envisagée »; « les personnes dont les dossiers seront soumis aux autorités françaises devront remplir les critères d’éligibilité au regard du mandat strict du HCR et de la législation française relative à l’octroi du statut du réfugiés » ; « dans le cadre des priorités stratégiques formulées par la Républiques française, le HCR soumettra aux autorités française une centaine de dossiers par an ».
À cet accord de 2008, dont la consistance – au demeurant très peu diserte en termes de régulation – irrigue encore le fonctionnement du mécanisme en France, s’ajoute le droit européen qui structure ou influence le cadre juridique de la réinstallation dans cet État, à travers une succession de communications et des programmes pluriannuels[35] puis avec le tout récent Règlement sur la réinstallation adopté en 2024, prévu pour entrer en vigueur en 2026[36]. S’il laisse une grande marge de manœuvre aux États à bien des égards – en faisant du volontariat la règle d’or – ce Règlement définit certains critères et procédures harmonisés devant guider la conduite du processus de la réinstallation dans chaque État membre de l’UE[37]. Par ses effets juridiques d’application directe et totale dans l’ordre juridique des États membres, le Règlement devrait constituer un instrument à part entière du cadre de la réinstallation en France.
Il a fallu toutefois attendre dix ans, depuis l’accord conclu en 2008 avec le HCR, soit au cours de l’année 2018, pour voir l’introduction de la réinstallation dans le droit interne français, par le truchement de la loi. L’article 7 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, reconduite par les lois qui ont suivi, assure l’entrée de la réinstallation dans le CESEDA. Plus exactement, l’article L520-1 du CESEDA lui sert de support en ces termes :
« Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente ».
Cette introduction dans et par la loi ne consacre cependant qu’un cadre juridique rudimentaire – sinon une simple base légale – de la réinstallation en France. Il ne faut pas en effet y voir une régulation solide du mécanisme en droit français pour deux raisons essentielles. D’une part, l’article L520-1 du CESEDA sert seulement de véhicule juridique à des opérations de réinstallation préexistantes et se déroulant en dehors de tout cadre légal clair, à l’effet de garantir leur pérennité[38] et n’implique pas d’action particulière de la part des préfectures[39]. D’autre part, la disposition est porteuse d’une ambition régulatrice très modeste puisqu’elle se formule sous un libellé permissif sans véritables contraintes pour les autorités[40], tout en demeurant silencieuse sur diverses questions que peut générer la mise en œuvre du mécanisme[41].
Ce cadre de la réinstallation, qui se repait (de) et fonctionne (par) quelques instructions ministérielles[42] et autres documents d’orientations[43], entraine alors un traitement de la procédure de réinstallation à la charnière entre le droit de l’asile stricto sensu et celui des étrangers en général. S’il est rudimentaire, et comporte à ce titre de nombreuses failles, le cadre spécifique de la réinstallation a néanmoins le mérite d’exister en droit français, ce qui n’est pas tout à fait le cas des corridors humanitaires qui restent dominés pas la persistance du vide.
B. La persistance regrettable du vide juridique
À la différence de la réinstallation, les corridors humanitaires ne disposent d’aucun fondement juridique spécifique. Ils ne possèdent aucune base textuelle en droit, qu’elle soit légale ou réglementaire, pas plus qu’une tentative claire d’introduction dans le droit positif.
Les corridors humanitaires fonctionnent principalement sur la base des visas dits « d'asile ». L'expérience des ONG et des avocats qui font appel des refus de visa confirme l'existence de cette pratique administrative[44]. En fait, au cours de la période 2006-2015, le CESEDA faisait une référence indirecte aux visas d'asile dans le CESEDA qui se lisait comme suit :
« s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention « étranger admis au titre de l'asile », d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4 »[45].
Cette mention indirecte fut par la suite supprimée. Les raisons de cette suppression, au plus fort de l'afflux de réfugiés de 2015-2016, n'apparaissent pas clairement, si ce n'est une tendance générale à la suppression de la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une ambassade à l'étranger[46]. À la vérité, la mention ne pouvait pas résister longtemps au caractère facultatif des visas humanitaires, « entendus comme une autorisation d'accéder au territoire d'un État, qui est accordée par dérogation aux règles applicables pour des raisons humanitaires spécifiques »[47], posé tant par le droit européen[48] que par le droit français[49].
Outre le fait que la disposition qui reconnaît l'existence de visas de longue durée au titre de l'asile fut finalement retirée du CESEDA, il n'existait pas non plus – et il n’existe toujours pas – de réglementation officielle quant aux conditions de délivrance de ces visas. Noll soulignait ainsi que:
«[l]a loi française ne contient aucune disposition régissant la procédure permettant de déposer des demandes d'asile dans les représentations diplomatiques ou consulaires françaises à l'étranger [... et que] [l]'Instruction Générale des Visas donne apparemment quelques indications à ce sujet. Toutefois, ces instructions, qui sont publiées par le Ministère des affaires étrangères à l'intention des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, ont un caractère interne et ne sont pas accessibles au public »[50].
Il ne faut en revanche pas conclure à une absence totale de cadre juridique applicable aux corridors humanitaires en France. Ces derniers suivent en pratique une régulation souple, par le canal d’orientations générales transmises des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères aux consulats[51] ou de protocoles[52] conclus avec des ONG. Un tel cadre demeure cependant fortement aléatoire. Il n'existe ainsi aucune information officielle statistique sur le nombre de visas d'asile délivrés annuellement[53], tout comme aucune information publique sur les critères de délivrance de ces visas[54]. En réalité, le droit applicable aux corridors humanitaires en France est le droit classique des visas long séjour. Manquant de base juridique spécifique, les corridors humanitaires s’inscrivent principalement dans le champ du droit des étrangers en général avec quelques aménagements tenant compte de la particularité de ses destinataires, lesquels ont besoin de protection.
L’exemple de la réinstallation et des corridors humanitaires illustre la marginalisation des voies légales dans le droit français. Ces voies, qui ne sont pas spécifiquement réglementées, fonctionnent à la périphérie du droit. Est-il pour autant opportun de les réguler ?
II. Les voies légales en France : de l’(in)opportunité d’une régulation
Il ne fait aucun doute que l’absence de régulation spécifique des voies légales en France possède des avantages mais aussi des inconvénients, que peuvent valablement défendre certains acteurs des mécanismes. Par exemple, l'absence de réglementation offre une grande flexibilité et une marge de manœuvre importante à l'exécutif pour réagir à certaines situations d'urgence, ce qui pourrait être considéré comme un avantage[55]. Comme l'histoire le montre, il pourrait facilement décider d'augmenter le nombre de places disponibles pour la réinstallation ou accepter d'accueillir davantage de personnes via des couloirs humanitaires provenant de certaines situations de crise[56]. Une telle réalité assure une effectivité des voies légales en France, qui, sur cette base, paraissent ne pas avoir besoin de régulation (A).
Si au contraire les voies légales sont réglementées de manière à garantir certains droits substantiels et/ou garanties procédurales à leurs bénéficiaires, cela serait très opportun. Mais l'inverse est également vrai, à savoir qu’à chaque modification de la loi – réalité assez constante – ces programmes peuvent être progressivement réduits ou supprimés, ce qui les laisse à la discrétion absolue du gouvernement au pouvoir. Pire encore, les gouvernements peuvent utiliser la mise en place de voies légales comme paravent pour mener des politiques d'asile et d'immigration toujours plus restrictives[57]. La régulation des voies légales se présente alors comme un chemin nécessaire, mais pas nécessairement opportun en l’état (B).
A. L’effectivité des voies légales comme argument en défaveur de la régulation
Malgré leur absence de régulation spécifique et claire en droit français, tant la réinstallation (1) que les corridors humanitaires (2) fonctionnent plutôt clairement en pratique[58]. Cet état de fait suffit à faire douter de la nécessité, voire de l’opportunité, de leur éventuelle régulation.
1. Réinstallation
Du cadre juridique en gestation de la réinstallation en France s’est en effet développée une pratique du mécanisme plus lisible, bien que sans aucune garantie. Quelques particularités existent cependant selon le type de « programme » dont le procédé global se subdivise lui-même en quatre grandes étapes : la prise d’engagement, la sélection, le transfert et l’intégration en France.
Le premier acte ouvrant le processus de la réinstallation en France est la prise d’engagements. Ces engagements représentent l’expression de la volonté de l’État français de réinstaller certains réfugiés sur son territoire. En pratique, deux types d’engagements se dessinent : des engagements sous l’angle de l’accord avec le HCR, qui représentent une centaine de dossiers par an et qui concernent toutes les nationalités et des engagements dans le cadre européen, dont le nombre est plus considérable – autour de 3000 par an depuis 2020 – qui se cantonnent à certaines nationalités (essentiellement Moyen-Orient et Afrique subsaharienne)[59].
À l’étape de prise d’engagements succède celle de la sélection des réfugiés que l’État français s’est alors engagé à réinstaller sur son territoire. Le processus se scinde à ce stade en deux aspects bien distincts: les modalités de sélection et les modes de sélection. Les modalités de sélection en vue d’une réinstallation en France ne varient pas en fonction du programme (engagements avec le HCR ou l’UE) : pour être éligible à la réinstallation, il faut avoir aussi bien besoin d’une « protection internationale » qu’être « vulnérable ». Le besoin de protection s’établit à raison de l’éligibilité soit au statut de réfugié – presque toujours le cas dans le cadre de l’accord avec le HCR – soit à la protection subsidiaire, comme prévu par le CESEDA[60]. Quant à la vulnérabilité, elle ne bénéficie en revanche d’aucune définition mais s’aligne en principe sur celle dégagée par le HCR. Ce dernier a élaboré sept catégories personnes qu’il considère comme vulnérables et qu’il propose comme telles aux États en vue d’une réinstallation[61]. En toute hypothèse, toute personne remplissant ces conditions ne peut prétendre à être réinstallée en France que suivant des modes de sélection précis : une présélection par le HCR[62] puis une soumission à l’État français. Ce dernier procède alors à une sélection soit sur dossier – toujours le cas quand il s’agit des dossiers proposés suivant l’accord avec le HCR – soit via des missions de sélection dans les États de premier asile des candidats proposés par ailleurs. Les missions de sélection, qui sont de facto le principal mode de sélection en vue d’une réinstallation en France, sont réalisées par des agents de l’OFPRA et du ministère de l’Intérieur[63]. Mais qu’elle résulte du simple examen des dossiers ou d’une mission, la décision de sélection est notifiée au HCR.
Une fois que les candidats sont sélectionnés, leur transfert sur le territoire français s’organise. Cette étape est confiée à l’Organisation Internationale pour la Migration, agissant avec le concours de plusieurs acteurs institutionnels. L’organisation du transfert est très complexe et concerne une pluralité de questions épineuses pour lesquels les solutions varient en fonction des contextes : la documentation – visas sortie et entrée – l’orientation culturelle avant départ qui permet d’expliquer les conditions de vie en France, l’examen médical, le voyage et enfin l’accueil à l’aéroport[64]. Avant leur arrivée en France, les candidats sélectionnés signent une note d'information sur les conditions de leur accompagnement en France. Par ce document, les autorités françaises s’engagent à fournir une aide complète à l'accueil et à l'intégration, tandis que les réfugiés s’engagent à respecter les valeurs françaises, à suivre le cours d'intégration républicaine, une formation ou un emploi, à accepter le logement proposé et, plus largement, à coopérer avec les autorités compétentes[65].
L’accueil des réfugiés clôt le processus mais ouvre une tout autre et complexe étape : celle de leur intégration en France. Pour la mener à bien, les réinstallés sont d’abord pourvus d’un statut. Ce dernier dépend du mode de sélection, comme l’a rappelé la CNDA dans une rare affaire en lien avec la réinstallation[66]. Les réfugiés sélectionnés sur dossier – cas de l’accord avec le HCR au moins – bénéficient du statut de réfugié et les autres se voient accordés le statut de réfugié ou celui de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Outre leur statut qui les rapproche en cela des autres réfugiés protégés en France, les réinstallés bénéficient d’un accompagnement plutôt enviable par rapport aux demandeurs d’asile primo-arrivants. À leur arrivée et sous la coordination des services déconcentrés de l’État, ils sont ventilés dans des départements pré-choisis selon des quotas, reçoivent un récépissé dans l’attente de leur titre de séjour définitif puis sont accompagnés, un an durant, par des opérateurs pour la jouissance de leurs droits[67]. Un tel fonctionnement d’apparence limpide ressort aussi de la pratique des couloirs humanitaires.
2. Couloirs humanitaires
Les couloirs humanitaires sont des initiatives de la société civile qui, en coopération avec les autorités compétentes, identifient les réfugiés vulnérables dans les pays d'asile afin de les accueillir en France de manière légale et de leur fournir un soutien à l'intégration dès leur arrivée. Ils le font en combinant deux mécanismes : les visas d'asile au point d'entrée, comme expliqué dans la section I.B., et le parrainage communautaire à l'arrivée[68]. En Europe, le modèle a été piloté par Sant'Egidio en Italie en 2015 et a ensuite été reproduit et réajusté en France, en Belgique et à Andorre[69]. En France, des corridors humanitaires ont été mis en place en 2017 sous les auspices du Président de la République[70]. Un protocole d'accord a été signé entre 5 organisations religieuses : Sant’Egidio France, la Fédération protestante de France, la Fédération de l'entraide protestante, la Conférence des Évêques de France et Caritas France (le Secours catholique), d'une part, et le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'autre part. Le protocole d'accord a été signé pour une période de trois ans et prévoyait le transfert en France de 500 réfugiés résidant au Liban[71]. Les nationalités convenues des bénéficiaires étaient principalement syriennes, éventuellement aussi irakiennes et palestiniennes vivant en Syrie. En 2021, la pratique du corridor humanitaire a été poursuivie, cette fois par deux protocoles d'accord distincts : l'un entre Sant'Egidio et les Semaines Sociales de France et les deux ministères concernés ; l'autre entre la Fédération protestante de France et la Fédération de l'entraide protestante et les deux ministères concernés. Les protocoles d'accord ont été signés pour la même période, soit trois ans, et ont concerné 300 personnes par protocole d'accord. Ils ont ciblé le même groupe : les réfugiés d'origine syrienne, irakienne ou palestinienne résidant au Liban. Au total, 504 réfugiés sont arrivés dans le cadre du premier protocole d'accord et, à la fin du mois de mai 2024, 120 étaient arrivés dans le cadre du protocole d'accord de Sant'Egidio ; 150 dans le cadre du protocole d'accord de la Fédération de l'entraide protestante[72].
Le processus se déroule comme suit, avec de légères différences entre les deux principales organisations (Sant'Egidio et la Fédération de l'entraide protestante). Les deux organisations ont des antennes locales au Liban qui soutiennent les réfugiés directement sur le terrain et travaillent également avec le HCR et l'ambassade de France à Beyrouth[73]. Il existe plusieurs façons de sélectionner les bénéficiaires potentiels du programme. Les deux organisations identifient elles-mêmes les réfugiés vulnérables à transférer ou reçoivent des recommandations du HCR. Sant'Egidio prend également en compte les recommandations d'autres parties.
Le protocole d'accord fixe les critères d'éligibilité suivants :
« a) des personnes ayant droit selon le HCR, au moins à première vue, à la reconnaissance du statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole afférent de 1967; ou
b) des personnes ne remplissant pas les conditions mentionnées au a) mais pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles seraient éligibles à la protection internationale et
c) qui, montrent une forte condition de vulnérabilité compte tenu en particulier de leur situation personnelle, de leur âge ou de leur santé.
De façon complémentaire et sans se substituer aux critères précédemment énoncés, l’admissibilité au titre du Protocole prendra également en compte l’existence de liens familiaux ou sociaux du bénéficiaire en France »[74].
Un dossier est préparé pour chaque cas, suivi d'un ou deux entretiens avec chaque réfugié/famille, au cours desquels le programme est expliqué et les réfugiés doivent accepter ou refuser d'y participer. L'une des organisations demande aux candidats de signer une déclaration stipulant les obligations des réfugiés participant à l'initiative. Ces dossiers sont ensuite transférés à l'ambassade de France, qui entame une procédure de contrôle de sécurité interne ainsi qu'une évaluation préliminaire visant à déterminer si les personnes proposées pourraient ultérieurement obtenir le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Si elles sont acceptées, les personnes se voient accorder un visa d'asile leur permettant de se rendre en France. Une fois sur le territoire français, elles devront déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA et attendre l'issue positive de leur demande. En attendant, les organisations religieuses accueillent les réfugiés le plus souvent dans des petites villes et des zones rurales où les réfugiés sont accompagnés par des groupes de bénévoles (l'une des organisations dispose également de travailleurs sociaux professionnels qui supervisent le travail des bénévoles) pour une période d'un an ou plus longtemps, si nécessaire, dans certains cas.
B. La discrétion des voies légales comme argument en faveur de la régulation
En France, les voies légales restent assez discrètes[75] et semblent fonctionner parallèlement au contexte politique très restrictif, au détriment de leur ampleur qui reste assez faible, comme illustré ci-dessus. Ces caractéristiques se muent facilement en une grande opacité, voire un certain état d’arbitraire, qui remet en cause l’efficacité même de ces voies, décrite dans la section précédente[76]. Les voies légales se soustraient ainsi d’un véritable contrôle parlementaire et judiciaire pourtant gage de leur légitimité[77].
En matière de réinstallation, par exemple, les engagements n’étant pas de réels accords internationaux – excepté l’accord avec le HCR, dont la juridicité demeure questionnable[78] – ceux-ci ne relèvent pas du contrôle parlementaire découlant des articles 53 et 54 de la Constitution[79]. L’option d’un contrôle budgétaire du parlement, qui résulterait de l’article 24 du même texte, n’est pas non plus envisageable puisque la réinstallation est financée par des fonds européens (FAMI), à raison de 10 000 euros par réfugiés, et non sur le budget de l’État[80]. En fait, les engagements en matière de réinstallation ne font l’objet d’aucun débat ou approbation devant le parlement, ni de publicité par des canaux réguliers. Ils relèvent de l’entière discrétion de l’exécutif et plus précisément du Président de la République. La situation concernant les couloirs humanitaires est encore moins favorable, parce que les engagements des ONG mettant en œuvre le protocole d'accord sont « entièrement autofinancé »[81]. Les défis financiers ainsi que la nécessité d'établir une forte présence locale à la fois dans le premier pays d'asile et en France militent contre l'élargissement du champ d'application de l'initiative.
En ce qui a trait au contrôle du juge, il n’est pas certain que les missions de l’OFPRA soient protégées par les mêmes garanties pour les réfugiés que lors des examens qui ont lieu sur le territoire français. Le juge n’a pas de moyens de contrôler ces opérations hors mur, ce d’autant plus qu’il n’existe pas de décision motivée en droit à l’issue à de celles-ci[82]. Les corridors humanitaires se confinent aux contentieux de droit commun des visas, avec les complexités qui leur sont déjà bien connues[83]. En fait, il n'existe aucun recours judiciaire spécifique en cas de rejet des dossiers. Les voies légales restent, au fond, une simple faveur.
Cette absence de contrôle s’aggrave par les nombreux aléas qui gouvernent les voies légales. Les quotas des bénéficiaires, qui se décident à bas bruit, peuvent varier et, sont, dans tous les cas, insuffisants. Concernant la réinstallation, par exemple, l’objectif annuel de 3000 personnes constitue un grand pas en avant mais se perd dans la masse des besoins mondiaux en constante évolution, qui s’élèvent à plus de 1,4 million depuis 2015 selon le HCR[84]. Ceci est d’autant plus révélateur que cet objectif annuel a décliné depuis 2020 dans le contexte de la Covid-19 puis de la guerre en Ukraine, passant de 5000 à 3000[85]. Par ailleurs, si les bénéficiaires des mécanismes sont en bonne partie en besoin de protection et dans une grande vulnérabilité[86], cela n’empêche pas le fait que des considérations autres sont prises en compte en vue de leur sélection. Il est bien connu que l’État examine le potentiel d’intégration des candidats, considère des aspects géopolitiques et stratégiques et tient compte des nationalités – dans le cas des engagements dans le cadre européen – ce qui rappelle un retour en arrière par rapport aux acquis de la convention de Genève puis du Protocole de 1967[87].
Enfin, les personnes accueillies peuvent voir leur prise en charge dans le programme de réinstallation retiré dans certaines circonstances[88]. D’autres – dans le cas de l’accord avec le HCR – sont considérés comme des primo-demandeurs d’asile et doivent suivre tout le parcours d’asile, en introduisant une demande formelle dans ce sens, alors qu’ils ont été choisis en amont, ce qui est également le cas des bénéficiaires des couloirs humanitaires. Certains bénéficiaires des couloirs humanitaires voient leur demande d'asile examinée dans le cadre d'une procédure accélérée (« comme manifestement fondée ») mais, en moyenne, la procédure de détermination de leur statut dure environ six mois, ce qui coïncide avec la pratique générale[89]. Bien qu'un protocole d'accord soit nécessaire à des fins de durabilité et de prévisibilité (sinon de transparence, puisque les protocoles d'accord ne sont pas publics), le niveau de discrétion demeure car les autorités ne sont pas tenues de délivrer des visas d'asile si tous les critères d'éligibilité, dans la mesure où ceux-ci existent, sont remplis. Comme dans le cas de la réinstallation, les couloirs humanitaires sont une faveur de l'exécutif et restent entièrement discrétionnaires.
La tentation de réguler les voies légales est alors grande. La régulation n’est cependant pas une finalité en soi. En fait, dans le contexte actuel, caractérisé par des dispositions légales de plus en plus restrictives[90], l'absence de réglementation peut être considérée comme un avantage ou bien comme une bénédiction déguisée. Plus concrètement, si l'existence des voies légales dépendait d'une disposition légale, avec toutes les modifications apportées au CESEDA, celle-ci pourrait facilement être abrogée. Cela pourrait hypothétiquement entraîner l'annulation des voies légales existantes, bien que limitées, ce qui n'est pas une perspective positive compte tenu des besoins actuels en matière de réinstallation des réfugiés. En ce sens, l'existence de voies légales à petite échelle qui ne sont pas largement connues du grand public peut en réalité jouer en faveur des voies légales existantes, mais pas en faveur de leurs promesses, notamment en termes de portée.
Cette situation nécessite de trouver un équilibre délicat. En effet, faut-il réglementer les voies légales dans la loi, garantissant ainsi leur pérennité et des garanties procédurales pour leurs bénéficiaires, mais au risque de les voir supprimées dans un contexte politique peu favorable à l'accueil des demandeurs d'asile, ou faut-il les laisser non réglementées, fragmentées, non pérennes et à petite échelle, mais continuant à bénéficier à plusieurs centaines de réfugiés vulnérables ? On peut soutenir que les régimes politiques restrictifs peuvent favoriser les voies légales au détriment des arrivées spontanées, en utilisant les premières comme « alibi humanitaire »[91] mais cela ne nécessite pas en soi une réglementation. La réglementation juridique des voies légales ne sera pas dans l'intérêt des réfugiés, à moins qu'ils ne bénéficient de garanties tant pour leurs droits substantiels que procéduraux, tels que la protection contre le refoulement et le droit à un recours effectif, une fois que les voies légales sont établies. Par conséquent, les nombreux défis découlant de l'absence de réglementation (arbitraire, absence de droits substantiels et de garanties procédurales) plaident en faveur d'une réglementation des voies légales. Cependant, dans le contexte politique actuel, il convient de faire preuve de prudence avant d'ouvrir un tel dialogue qui pourrait être contre-productif pour l'avenir, certes fragile, des voies légales en France. Aussi, comprend-on que l’état du droit actuel peut déjà jouer un grand rôle en la matière avant l’avènement de véritables réformes qui – avouons-le – peuvent être difficiles, voire dangereuses, à réaliser par les temps qui courent. La faible réglementation des voies légales au niveau européen peut représenter une lueur d'espoir mais seul l'avenir nous dira si elle serait justifiée.
Footnotes
- [1] Voir plus largement, ICRC, « Counting the Dead. How Registered Deaths of Migrants in the Southern European Sea Border Provide Only a Glimpse of the Issue », 2022.
- [2] Commission européenne, Statistiques sur la migration vers l'Europe. Migration to and from the EU, disponible ici : https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en#migration-to-and-from-the-eu .
- [3] Sur les notions contemporaines de souveraineté et leur relation avec le droit des migrations, voir C. Dauvergne, « Sovereignty, Migration and the Rule of Law in Global Times », Modern Law Review, 2004, n°67-4, p. 593 et s.
- [4] M. Tissier-Raffin, « Réinstallation - Admission humanitaire : solutions d'avenir pour protéger les réfugiés ou cheval de Troie du droit international des réfugiés ? », La Revue des Droits de l'Homme, 2018, n°13, p. 2.
- [5] Voir J. Van Selm, « Complementary Pathways to Protection : Promoting the Integration and Inclusion of Refugees in Europe ? », ANNALS, AAPSS, 2020, n°690.
- [6] AGNU, 71èmesession, Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, A/RES/71/1, 2016, §§77-78.
- [7] AGNU, 73èmesession, Pacte mondial sur les réfugiés, A/RES/73/151, 2018.
- [8] Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, §78, souligné par nous.
- [9] Ibid., Annexe I, point 10. Il existe trois solutions durables traditionnelles dans le droit des réfugiés : le rapatriement volontaire, l'intégration locale et la réinstallation. Voir HCR, ExCom, Conclusion sur l'intégration locale n°104 (LVI) - 2005, 56e session, A/AC.96/1021, 2005.
- [10] HCR, Manuel de réinstallation, 2011, p. 3.
- [11] Pour un historique de la réinstallation, voir M. Zieck, Resettlement as Protection. Integrating Resettlement of Refugees in International Refugee Law, Edward Elgar Publishing, 2024, p. 90 et s.
- [12] Pacte mondial sur les réfugiés, §7, 8 et 85. Voir supra, note 9.
- [13] HCR, Voies complémentaires d'admission des réfugiés dans les pays tiers, Genève, 2019, p.5, souligné par nous. Plus récemment, les Directives opérationnelles du HCR sur les voies complémentaires ont élaboré une définition plus nuancée des voies complémentaires, mais le principe reste le même (HCR, Directives opérationnelles sur les voies complémentaires, UNHCR/OG/2024/06, 2024, pp. 11-12).
- [14] Pacte mondial sur les réfugiés, op.cit., §95.
- [15] Les États ne sont pas tenus d'offrir des places de réinstallation, car une telle obligation n'a pas été incluse dans la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après « Convention de Genève »). En revanche, la réinstallation figure parmi les activités possibles du HCR (AGNU, Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Doc ONU A/RES/428(V), Annexe, 1950, § 9).
- [16] Voir dans ce sens, D. Burriez, « L'insuffisance du cadre juridique applicable à la réinstallation des réfugiés en droit français », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2021, n°4, p. 2 ; M. Zieck, Resettlement as Protection, op.cit., p. 15 (qui montre qu'en pratique la reconnaissance du statut de résident permanent n'est pas garantie).
- [17] HCR, ExCom, Conclusion n° 107 (LXXV) sur les solutions durables et le voies complémentaires, it. (f).
- [18] En 2022, elle se classait deuxième après l'Allemagne avec 137 510 demandes d'asile et troisième après l'Allemagne et l'Espagne en 2023, avec 145 095 demandes d'asile ; tandis qu'en 2024, elle se classait quatrième après l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie avec 129 820 demandes d'asile (Eurostat, Asylum applicants by type, citizenship, age and sex - annual aggregated data, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza/default/table?lang=en, consulté le 9 août 2025).
- [19] FRONTEX, Suivi et analyse des risques, https://www.frontex.europa.eu/what-we-do/monitoring-and-risk-analysis/migratory-map/, consulté le 9 août 2025.
- [20] Articles 25 et 29 du Règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Pour une critique de cette pratique, voir par exemple S. Platon, « 30 days, Six Months... Forever ? Border Control and the French Council of State », Verfassungsblog, 9 janvier 2018, disponible sur : https://verfassungsblog.de/30-days-six-months-forever-border-control-and-the-french-council-of-state/ .
- [21] Voir pour une affaire récente sur la question, CJUE, décision du 21 septembre 2023, ADDE et autres c. Ministre de l'Intérieur, C-143/22.
- [22] Sur le lien possible entre la mise en place de voies légales et la difficulté croissante pour les réfugiés d'accéder à l'asile dans l'UE, voir M. Tissier-Raffin, « Réinstallation - Admission humanitaire…», op.cit., p. 24.
- [23] L'un des auteurs a effectué un travail de terrain sur les voies légales en France au cours de la période mars-juin 2024, où elle a interrogé 21 décideurs, définis comme des représentants d'autorités nationales, d'organisations internationales et non gouvernementales, de praticiens du droit et d'universitaires impliqués dans l'élaboration et/ou la mise en œuvre de lois et de politiques sur les voies légales. Bien que les informations collectées ne soient pas directement analysées dans ce texte, elles en constituent néanmoins un socle important.
- [24] Voir M. Tardis, Offrir des voies sûres et légales aux réfugiés en France : un potentiel à développer, 2024, p. 17.
- [25] Ibidem.
- [26] Voir par exemple, Forum Réfugiés, Voies complémentaires à la réinstallation : boîte à outils, 2023, p. 9 ; Forum Réfugiés, Voies légales d'accès à la protection internationale, 2021 ; France Terre d'Asile, La Lettre de l'Asile et de l'intégration, Lettre de France Terre d'Asile n°81, 2017.
- [27] Voir Th. Fleury Graff, A. Marie, Droit de l’asile, Paris, PUF, 2021, 2ème éd, p. 57.
- [28] Voir Tchen, Droit des étrangers, Paris, LexisNexis, 2024, 3ème éd., p. 190.
- [29] Institué par l’Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que refondue par l’Ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et modifié par les lois successives, dont la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
- [30] Outre le manuel de Th. Fleury Graff et A. Marie, op.cit., voir D. Alland, C. Teitgen-Coly, Traité de droit de l’asile, Paris, PUF, 2002.
- [31] Le 26 janvier 2024, une nouvelle loi sur l'immigration est entrée en vigueur. Elle a été qualifiée de « controversée », de « loi sur l'immigration la plus régressive depuis des décennies » et de « contraire aux droits humains fondamentaux ». Même après que le Conseil constitutionnel ait invalidé 86 articles, la nouvelle loi reste plus restrictive que la version précédente (ECRE, France : une nouvelle loi sur l'immigration adoptée malgré le rejet par le Conseil constitutionnel de près de la moitié de ses articles, 2 février 2024, https://ecre.org/16309-2/).
- [32] Voir supra, note 24.
- [33] Voir infra, notes 39, 42 et 43.
- [34] Framework Agreement between the Government of the French Republic and the UNHCR, 4 février 2008.
- [35] Voir M.C. Dabire, La réinstallation des réfugiés dans l’Union européenne, Mémoire de master, Université de Nantes, 2021, p. 136.
- [36] Règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et modifiant le règlement (UE) 2021 /1147.
- [37] Voir E. Bratanova Van Harten, « The new EU Resettlement Framework: the Ugly Duckling of the EU asylum acquis? », EU Law Analysis, février 2023, https://eulawanalysis.blogspot.com/2023/02/the-new-eu-resettlement-framework-ugly.html.
- [38] D. Burriez, « L'insuffisance du cadre juridique applicable à la réinstallation… », op.cit., p. 8.
- [39] Instruction relative à la loi pour une immigration maitrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie – dispositions immédiatement applicables, 11 sep. 2018, NOR: INTV1824378, p. 5.
- [40] C’est presque toujours le cas ailleurs. Voir sur ce point, T. K. Acka, La réinstallation des réfugiés, Thèse de doctorat, Université Paris Panthéon-Assas, dir. Th. Fleury Graff, avril 2025.
- [41] Voir infra, section II.A.1.
- [42] Outre l’instruction précitée, voir Instruction sur la Nouvelle organisation de l’accueil des réfugiés réinstallés à partir de l’année 2020, 12 nov. 2019, NOR: INTV1929397; Instruction relative aux orientations de la politique d’accueil des réfugiés réinstallés pour l’année 2021, 24 févr. 2021, NOR: INTV2101167J; Information relative aux orientations de la politique d’accueil des réfugiés pour l’année 2024, 23 mai 2024, NOR: OIMV2412207J.
- [43] Voir par exemple, Ministère de l’intérieur, S’engager pour l’accueil des réfugiés réinstallés, Présentation à destination des acteurs locaux, non daté ; HCR, Manuel de réinstallation – chapitre pays – France, 2022.
- [44] Voir par exemple S. Slama, « La protection fonctionnelle au service des tarjuman », Plein droit, 2020, n°124.
- [45] Ancien article R. 742-1 du CESEDA. Le même texte semble avoir été hérité de la Loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. Voir sur ce point, GISTI, Une réglementation d'exclusion, 1994, https://www.gisti.org/spip.php?article3548.
- [46] Pour un état de la question en Europe en 2024, voir P. Endres de Oliveira, Safe Access to Asylum in Europe - Normative assessment of safe pathways to protection in the legal context of the European Union, Nomos, 2024.
- [47] M.C. Foblets, L. Leboeuf, « Introduction: Humanitarian admission to Europe. From policy developments to legal controversies and litigation », in M.C. Foblets, L. Leboeuf (dirs.), Humanitarian admission to Europe. Between promises and constraints, Hart Publishing, 2020, p. 14. Voir aussi U. Jensen, « Humanitarian visas: Option or obligation? », Study for the LIBE Committee, Brussel, 2014 ; W. Van Ballegooij; C. Navarra, « Humanitarian visas: European added value assessment accompanying the European Parliament's legislative own-initiative report », European Parliamentary Research Service, 2018.
- [48] Voir CJUE, GC, 7 mars 2017, X.X., C-638/16 ; Cour EDH, GC, 5 mai 2020, M.N., n°3599/18 et le commentaire de l’un des auteurs dans J. Fernandez, Th. Fleury Graff et A. Marie (dirs.), Decisions du droit de l’asile, Paris, PUF, 2025.
- [49] Voir CE, ordonnance du 9 juillet 2015, n° 391392 ; CE, ordonnance du 16 octobre 2017, n°408748.
- [50] G. Noll, « Safe Avenues to Asylum ? The Actual and Potential Role of EU Diplomatic Representations in Processing Asylum Requests », 2002, p. 42. Pour un constat similaire, et plus récent, voir E. Lenain, « Les visas long séjour aux fins demander l’asile en droit français : critère et procédure en l’absence de fondement législatif », in C. Billet, E. d’Halluin, et B. Taxil (dir.), L’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés aux portes de l’Europe, Mare et Martin, 2021.
- [51] E. Lenain, op.cit., p. 65.
- [52] Voir infra, sur les couloirs humanitaires, note 74.
- [53] Certaines données peuvent être trouvées sur une base ad hoc ou de manière informelle. Par exemple, des informations sur le nombre de visas d'asile délivrés au cours de la période 2012-2021 figurent dans les 28ème et 29ème rapports sur les étrangers en France, présentés par le ministère de l'intérieur au Parlement respectivement en 2021 et en 2022 (Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, Les étrangers en France. Rapport au Parlement sur les données de l'année 2020, : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressources/Documentation/Rapports-publics/Les-rapports-au-Parlement-article-L.-111-10-du-code-de-l-entree-et-du-sejour-des-etrangers-et-du-droit-d-asile-CESEDA ; Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, Les étrangers en France. Rapport au Parlement sur les données de l'année 2021, : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressources/Documentation/Rapports-publics/Les-rapports-au-Parlement-article-L.-111-10-du-code-de-l-entree-et-du-sejour-des-etrangers-et-du-droit-d-asile-CESEDA ).
- [54] Certaines informations sur ces critères ont été publiées par le GISTI et la Cimade, et sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.gisti.org/spip.php?article6645&var_mode=recalcul#6b3 .
- [55] En plus, le fait qu'elles soient réglementées par la loi n'exclut pas nécessairement la possibilité de réagir rapidement à des crises nouvellement apparues.
- [56] Voir section II.A.1. et II.A.2. ci-dessous.
- [57] N. Hashimoto, « Are New Pathways of Admitting Refugees Truly ‘Humanitarian’ and ‘Complementary’? », Journal of Human and Security Studies, 2021, n°10-2.
- [58] L'absence d'informations publiques sur les voies légales ne contredit pas la possibilité d'une mise en œuvre harmonieuse dans la pratique.
- [59] Constat ressortant des sources publiques disponibles notamment des instructions ministérielles, du HCR, Manuel de réinstallation-chapitre pays France et de rapports d’ONG tel que Forum réfugiés.[1] Article L-511-1.2 du CESEDA.
- [60] Article L-511-1.2 du CESEDA.
- [61] Voir HCR, Manuel de réinstallation, op. cit., pp. 271-329 et notre commentaire dans T. K. Acka, La réinstallation des réfugiés, op.cit..
- [62] La présélection du HCR est une étape très sophistiquée prévue et organisée par le Manuel de réinstallation. Voir, T. K. Acka, ibidem, pp. 365-381.
- [63] En 2024, 21 missions ont été menées dans sept États. Voir OFPRA, Rapport d’activité 2024, 20 juin 2025, p. 8.
- [64] Voir HCR, Manuel de réinstallation – chapitre pays France, op.cit..
- [65] Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, Instruction du 23 mai 2023 relative aux orientations de la politique d’accueil des réfugiés réinstallés pour l’année 2023, NOR : IOMV2313875J, Annex 8.
- [66] Voir CNDA, 21 décembre 2021, M. B. Mme A. M. B. M. B., n° 19014405, n° 19014406, n° 19014407 et n° 19014408.
- [67] Voir HCR, Manuel de réinstallation – chapitre pays France, op.cit..
- [68] M. Tissier-Raffin, « Réinstallation - Admission humanitaire…», op.cit., p. 13 : « le parrainage privé permet à des citoyens ou des organisations privées de proposer et de soutenir une personne ou une famille à réinstaller ».
- [69] F. Penot, « Choosing asylum seekers from afar : the case of Lebanon-France humanitarian corridors », Mondi Migranti, 2024-1, p. 5.
- [70] Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, Les étrangers en France. Rapport au Parlement sur les données de l'année 2020, p. 124 (Les rapports au Parlement / Rapports publics / Documentation / Info-ressources - Direction générale des étrangers en France - Ministère de l'Intérieur).
- [71] Fin 2023, 744 réfugiés étaient arrivés en France via le corridor humanitaire (F. Penot, « Choosing asylum seekers from afar…», op.cit., p. 7).
- [72] Entretien avec une ONG, 24 mai 2024 ; entretien avec une ONG, 27 mai 2024.
- [73] F. Penot, « Choosing asylum seekers from afar…», op.cit., p. 12.
- [74] Protocole d'accord de 2021 entre Sant'Egidio et Les Semaines Sociales de France, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, art. 3, dans les dossiers de l'auteur.
- [75] M. Tardis, Offrir des voies sûres et légales aux réfugiés, op.cit., p. 24.
- [76] T. De Boer, M. Zieck, « The Legal Abyss of Discretion in the Resettlement of Refugees. Cherry Picking and the Lack of Due Process in the EU », International Journal of Refugee Law, 2020, n°32-1.
- [77] Voir D. Burriez, « L’insuffisance du cadre juridique de la réinstallation en France… », op.cit., p. 11.
- [78] Voir D. Burriez, « La nature équivoque des engagements internationaux des États en matière de réinstallation des réfugiés : l’exemple français », RGDIP, 2020, n°3-4.
- [79] Constitution de la République française du 4 octobre 1958.
- [80] Voir site internet du ministère de l’intérieur, rubrique réinstallation: https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/La-reinstallation.
- [81] Protocole d'accord de 2021 entre Sant'Egidio et Les Semaines Sociales de France, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, préambule, point 12. Voir F. Penot, « Choosing asylum seekers from afar…», op.cit., p. 8. Parfois, ces ONG reçoivent un financement européen partiel et temporaire pour une partie de leurs activités (voir M. Tardis, « Offrir des voies sûres et légales aux réfugiés », op.cit., p. 23.
- [82] D. Burriez, « L’insuffisance du cadre juridique de la réinstallation en France… », op.cit., p. 12 et s.
- [83] Voir par exemple E. Lenain, « Les visas long séjour...», op.cit..
- [84] En 2026, 2,5 millions de réfugiés auront besoin de réinstallation, selon le HCR (UNHCR, Projected Global Resettlement Needs 2026, 2025). Ce n’est certes pas le propre de la France de proposer assez peu de places. Le nombre de places est globalement très bas et a rarement franchi la barre des 200 000 par an. Seuls quelques États, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie et jusqu'à récemment l’Allemagne, ont constamment proposé – hormis le gel 2016 et plus récent de 2025 des États-Unis – le plus grand nombre de places.
- [85] Forum Réfugiés, L’asile en France et en Europe – États des lieux, juin 2024, p. 144.
- [86] Eod. loc..
- [87] Voir M. Tissier Raffin, C. Gauthier, « La réinstallation; vers une remise en cause du système institutionnel et normatif du droit international des réfugiés ? », in C. Billet, E. D’Halluin, B. Taxil (dirs.), L’accueil des demandeurs d’asile…, op.cit.. Pour les corridors, voir E. Lenain, « Les visas long séjour...», op.cit..
- [88] Ministère de l’intérieur, Instruction du 23 mai 2023 relative aux orientations de la politique d’accueil des réfugiés réinstallés pour l’année 2023, NOR : IOMV2313875J, Annexe 8.
- [89] Sant'Egidio, Bilan du Premier Protocole, dans le dossier de l'auteur.
- [90] Voir supra, note 31.
- [91] J. Van Selm, «The Strategic Use of Resettlement: Changing the Face of Protection? », Refuge: Canada’s Journal on Refugees, 2004, n°22-1, p. 40.