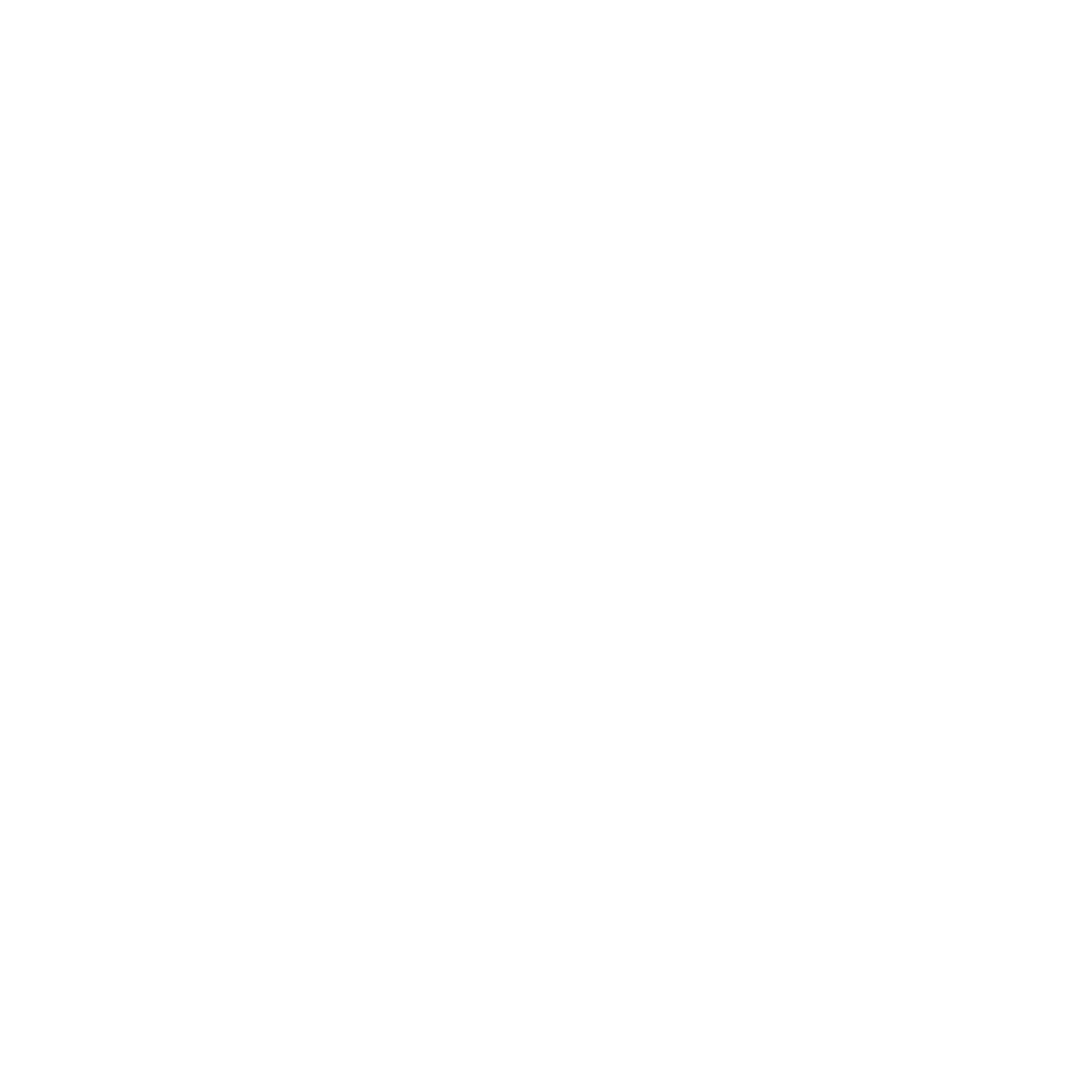Le changement climatique, phénomène global documenté par les rapports successifs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)[1], bouleverse profondément les conditions d’existence de millions d’individus. Parmi ses conséquences les plus préoccupantes, figure l’augmentation des déplacements forcés de populations, provoqués par la dégradation, parfois irréversible, de leur environnement naturel. Ces mobilités, qu’elles soient internes ou transfrontalières, soulèvent des défis inédits pour le droit international[2], notamment en matière de protection des personnes déplacées. Pourtant, le droit international de la protection des réfugiés, centré autour de la Convention de Genève de 1951 et de son Protocole de 1967 , ne reconnaît pas les déplacements environnementaux comme motif de protection[3]. Conçu pour répondre à des persécutions ciblées fondées sur des critères précis (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou opinions politiques)[4], ce régime exclut de facto les déplacés climatiques[5], dont les trajectoires ne relèvent ni d’une intentionnalité humaine ni d’une discrimination ciblée[6].
Dans ce contexte, le principe de non-refoulement apparaît comme un levier potentiel de protection. Afin de mieux saisir la portée de ce principe, il convient de distinguer deux régimes juridiques complémentaires. Le premier, issu du droit international des réfugiés, est consacré à l’article 33 de la Convention de Genève de 1951[7] et protège exclusivement les réfugiés reconnus contre le renvoi vers un territoire où leur vie ou leur liberté serait menacée. Le second relève du droit international des droits de l’homme, qu’il soit universel ou régional, et interdit le renvoi de toute personne, indépendamment de son statut, vers un pays où elle risquerait des traitements inhumains ou dégradants. Les articles 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après « PIDCP »)[8], 3 de la Convention contre la torture de 1984 (ci-après « CAT »)[9], 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »)[10], II (3) de la Convention de l’OUA de 1969[11] élargissent ainsi la portée du non-refoulement au-delà du cadre strict du statut de réfugié, en intégrant des considérations de dignité humaine et de protection contre les atteintes graves aux droits fondamentaux. Cette distinction est essentielle : si les déplacés climatiques ne peuvent prétendre à la qualité de réfugié au sens conventionnel, ils pourraient néanmoins bénéficier d’une protection contre l’expulsion dans certaines circonstances extrêmes[12]. Toutefois, cette protection interdit le renvoi mais ne confère ni droit au séjour, ni accès aux droits sociaux reconnus aux réfugiés.
La présente étude se propose ainsi, d’analyser dans quelle mesure le principe de non-refoulement, dans ses différentes déclinaisons, peut être mobilisé pour protéger les déplacés climatiques. Elle s’articulera en deux temps : d’abord, en examinant les limites structurelles du cadre actuel face aux réalités des déplacements environnementaux (I) ; ensuite, en explorant les pistes d’évolution du droit international, notamment à travers l’émergence du droit à un environnement sain et les initiatives régionales, pour une reconnaissance plus effective de ces nouvelles vulnérabilités (II).
I. Un principe de non-refoulement insuffisant face aux réalités du déplacement climatique
Le principe de non-refoulement, bien que fondamental pour la protection des réfugiés, ne répond pas adéquatement aux défis posés par les déplacements climatiques. Si ce principe interdit l’expulsion ou le retour forcé d’une personne dans un pays où elle risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants , il reste limité par le cadre traditionnel du droit d’asile, qui ne prend pas en compte les causes environnementales des déplacements. Ainsi se pose la question de savoir comment étendre ce principe afin d’y inclure les déplacés climatiques, qui, bien qu’exposés à des risques comparables, ne satisfont pas aux critères classiques définissant le statut de réfugié.
A. L’inadéquation du cadre conventionnel : une exclusion structurelle des déplacés climatiques du statut de réfugié
Le principe de non-refoulement, consacré à l’article 33 de la Convention de Genève, interdit à tout État partie d’expulser ou de refouler un réfugié vers un territoire « où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » . Largement consolidé, ce principe est érigé par la doctrine et la jurisprudence au rang de norme coutumière du droit international[13] et constitue l’un des fondements essentiels du régime de protection des réfugiés[14].
Toutefois, le champ d’application de cette disposition est défini ratione personae et ne bénéficie qu’aux individus reconnus comme réfugiés au sens de la Convention. Or, cette qualité suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’existence d’une persécution ciblée, et d’autre part, un lien de causalité entre cette persécution et l’un des cinq motifs conventionnels (la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques)[15]. Cette exigence d’individualisation, généralement associée à un agent persécuteur identifiable (qu’il s’agisse de l’État ou d’un acteur privé que l’État ne contrôle pas), a historiquement été conçue comme un mécanisme de régulation des flux migratoires, garantissant un équilibre entre impératifs humanitaires et souveraineté étatique[16]. Ce cadre normatif révèle cependant ses limites lorsqu’il est confronté aux réalités des déplacements environnementaux. Deux obstacles majeurs se dressent :
Premièrement, les phénomènes climatiques extrêmes, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles, de désertification, de montée des eaux ou d’effondrement des écosystèmes, ne procèdent pas d’une volonté humaine dirigée contre des individus ou des groupes. Ils échappent ainsi à la logique de la persécution intentionnelle. Comme le souligne Jane McAdam, « the impersonal nature of environmental risks makes it difficult to fit them within the traditional concept of persecution under the 1951 Convention »[17].
Deuxièmement, même lorsqu’un déplacement induit par le changement climatique met gravement en péril la vie ou la dignité humaine, il demeure exclu du champ conventionnel faute de correspondance avec l’un des cinq motifs de persécution. Les déplacements liés aux dégradations environnementales relèvent en effet de menaces globales et indifférenciées, qui frappent indistinctement des populations entières, sans distinction de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un groupe social ou d’opinion politique. Sauf à envisager des cas extrêmes – par exemple lorsqu’une minorité est intentionnellement privée d’accès aux ressources vitales pour des raisons discriminatoires – la vulnérabilité climatique ne peut être juridiquement rattachée à un motif conventionnel identifiable[18].
Cette inadéquation se reflète dans la pratique des organes internationaux qui demeure fidèle à une lecture littérale de la Convention de 1951. Certes, le Comité des droits de l’homme a reconnu, dans son Observation générale n°31, que le principe de non-refoulement peut s’étendre à toute menace grave pesant sur les droits fondamentaux[19]. Mais ni ce comité, ni la Cour européenne des droits de l’homme ou encore le Haut-Commissariat pour les réfugiés n’ont consacré l’environnement dégradé comme fondement autonome de protection.
Il apparaît dès lors que l’inadéquation ne réside pas tant dans le principe de non-refoulement lui-même que dans la définition étroite du réfugié consacrée par la Convention de 1951. Conçu pour répondre aux persécutions intentionnelles et ciblées du XXᵉ siècle, ce modèle normatif s’accorde difficilement avec la nature diffuse, cumulative et non intentionnelle des crises environnementales contemporaines. C’est précisément face à ces limites qu’ont émergé, dans la jurisprudence et la doctrine, des tentatives d’interprétation extensive du non-refoulement, oscillant entre innovations prudentes et résistances persistantes.
B. Les tentatives d’interprétation extensive du principe de non-refoulement : entre jurisprudences novatrices et résistances doctrinales
Si la construction classique du principe de non-refoulement limite son application aux victimes de persécutions ciblées, certaines évolutions récentes de la jurisprudence et de la doctrine tendent à élargir progressivement sa portée à des menaces nouvelles, dont certaines pourraient théoriquement inclure les risques environnementaux.
Une dynamique d’interprétation extensive du principe de non-refoulement s’est développée à partir du constat que les déplacés climatiques, exclus du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, peuvent néanmoins bénéficier de la protection offerte par le droit international des droits de l’homme. Contrairement au régime conventionnel issu de la Convention de Genève de 1951, qui conditionne l’application du non-refoulement à la reconnaissance préalable de la qualité de réfugié, les instruments tels que la CEDH et le PIDCP imposent aux États une interdiction de l’expulsion dès lors qu’un individu encourt un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, indépendamment de son statut juridique.
L’arrêt Soering c. Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi reconnu que l’expulsion d’une personne vers un pays où elle risquerait des traitements contraires à l’article 3 de la Convention est interdite, indépendamment du statut de réfugié[20].
Sur cette base, certains auteurs ont soutenu que des conditions de vie résultant de catastrophes environnementales extrêmes pourraient atteindre le seuil de gravité requis pour déclencher une protection contre l’expulsion[21]. La reconnaissance d’un droit à ne pas être renvoyé vers un environnement invivable constituerait ainsi une extension fonctionnelle du principe de non-refoulement. Cette perspective trouve un écho particulier dans l’affaire Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande, portée devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Dans sa décision du 7 janvier 2020, le Comité a admis que « les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles peuvent exposer des individus à une violation de leur droit à la vie » au sens de l’article 6 du PIDCP[22]. Bien que le seuil de risque n’ait pas été atteint dans le cas d’espèce, le Comité a reconnu en principe qu’une expulsion vers un territoire rendu invivable par le changement climatique pourrait constituer une violation engageant la responsabilité internationale de l’État[23].
Cette orientation a été renforcée par l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 23 juillet 2025, qui reconnaît que les effets du changement climatique peuvent créer des conditions mettant en danger la vie des personnes contraintes de fuir leur pays[24]. La Cour affirme à cet effet que les États sont liés par le principe de non-refoulement dès lors qu’il existe des motifs sérieux de croire que le retour d’un individu l’exposerait à un risque réel de préjudice irréparable à son droit à la vie[25]. La CIJ opère ici une fertilisation croisée avec l’affaire Teitiota[26], consolidant ainsi la reconnaissance juridique des déplacés climatiques dans le cadre du droit international des droits de l’homme.
De manière complémentaire, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans son avis consultatif du 29 mai 2025[27], a affirmé que les États ont l’obligation d’adopter des mesures de prévention, selon un standard de diligence renforcée (enhanced due diligence), afin de limiter les migrations et déplacements forcés résultant directement ou indirectement des catastrophes climatiques[28]. Elle insiste sur la nécessité pour les autorités nationales d’évaluer systématiquement les risques environnementaux dans toute décision de retour ou d’expulsion[29], en tenant compte de l’ensemble des droits fondamentaux concernés, tels que le droit à la vie, à l’intégrité personnelle, à la santé, à un environnement sain, au logement, à l’eau, à la sécurité sociale, à la culture et à l’éducation[30].
Au-delà de cette exigence d’évaluation, la Cour souligne que les États ne peuvent expulser ni renvoyer une personne vers un territoire où les effets du changement climatique compromettent gravement l’exercice de ses droits fondamentaux, consacrant en substance un principe de non-refoulement climatique[31]. Ce principe protège toute personne menacée par les effets des catastrophes climatiques, indépendamment de son statut de réfugié. Comme la CIJ, la Cour interaméricaine rappelle la position du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Teitiota c. Nouvelle-Zélande reconnaissant l’obligation de non-expulsion dans le contexte de menaces environnementales, même en l’absence du statut de réfugié[32].
La Cour interaméricaine va plus loin en imposant aux États le devoir d’intégrer explicitement ce principe dans leurs législations et politiques internes, à travers des instruments réglementaires, institutionnels et budgétaires adaptés[33]. Elle s’appuie notamment sur les bonnes pratiques identifiées dans la région telles que l’octroi de visas humanitaires ou d’autorisations temporaires pour les personnes déplacées par le climat au Brésil, en Équateur et au Pérou ainsi que sur les recommandations de la Nansen Initiative et du Plan d’action de Santiago +40, qui demandent de renforcer les cadres juridiques de protection des déplacés climatiques[34].
Cette évolution marque une avancée majeure : le non-refoulement, historiquement lié aux persécutions politiques ou aux risques de torture, est désormais étendu aux contextes environnementaux.
Toutefois, cette ouverture jurisprudentielle demeure étroitement encadrée. Premièrement, ni le Comité des droits de l’homme ni les juridictions internationales n’ont assimilé l’impact environnemental à une persécution au sens de la Convention de 1951. Deuxièmement, le seuil de gravité requis reste élevé : seules des situations de privation extrême de moyens de subsistance, rendant la vie humaine « insoutenable », peuvent justifier une interdiction de l’expulsion. Troisièmement, aucun statut juridique autonome de « réfugié climatique » n’a été reconnu, ce qui confirme la persistance d’une séparation structurelle entre les régimes de protection.
A cet effet, la doctrine est restée partagée sur l’opportunité de cette interprétation extensive. Certains auteurs craignent qu’un élargissement trop ambitieux du non-refoulement ne dilue la spécificité du régime conventionnel et n’affaiblisse son efficacité[35]. D’autres, au contraire, estiment que l’évolution inévitable des risques globaux impose une relecture dynamique des normes existantes à la lumière des défis contemporains[36].
En définitive, l’extension jurisprudentielle du principe de non-refoulement aux contextes environnementaux marque une avancée non négligeable. Toutefois, sa mise en œuvre demeure empreinte de prudence et rencontre encore des réticences dans la doctrine, ce qui en limite la portée normative. À ce stade, elle ne confère qu’une protection résiduelle, centrée sur l’interdiction du retour, sans ériger un véritable statut juridique propre aux déplacés climatiques.
Toutefois, il reste à souligner que ces derniers ne sont cependant pas entièrement dépourvus de garanties[37]. Dans des situations extrêmes, ils peuvent invoquer, à titre subsidiaire, les instruments de protection des droits de l’homme, tels que l’article 3 de la CEDH ou l’article 7 du PIDCP, afin de s’opposer à une expulsion vers un territoire où ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Néanmoins, cette protection demeure minimaliste : elle se limite à empêcher le refoulement, sans conférer un véritable statut juridique ni les droits attachés à la reconnaissance du statut de réfugié.
Cette approche fragmentaire met en lumière une lacune normative majeure. En l’absence d’un cadre juridique spécifique, cohérent et universellement applicable, les déplacés climatiques demeurent confinés dans une zone d’incertitude du droit international[38]. Or, face à l’ampleur croissante des mobilités contraintes par les changements environnementaux, il devient urgent d’envisager une évolution normative. Celle-ci pourrait s’articuler autour de l’adaptation des instruments existants, de l’émergence de nouveaux fondements juridiques tels que la consécration du droit à un environnement sain ou encore du développement d’initiatives régionales et sectorielles visant à combler ce vide. C’est à l’examen de ces perspectives d’évolution que se consacrera désormais la seconde partie de la présente étude.
II. Vers une reconnaissance effective des déplacés climatiques : pistes d’évolution du droit international
L’absence de reconnaissance de la qualité de réfugié pour les déplacés climatiques dans le droit international soulève, en premier lieu, des défis considérables pour leur protection. Toutefois, les initiatives régionales et certaines évolutions récentes du droit international montrent que des solutions innovantes commencent à émerger, même si elles demeurent limitées par les failles structurelles du cadre juridique actuel. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire d’explorer de nouvelles pistes intégrant explicitement la dimension environnementale dans la protection des personnes déplacées. À cet égard, l’émergence d’un droit à un environnement sain constitue un levier juridique particulièrement significatif pour adapter le droit international aux réalités des déplacements environnementaux. En définitive, une telle évolution offrirait la possibilité de combler les lacunes existantes et de garantir une prise en compte plus large des défis liés au changement climatique dans le domaine des migrations.
A. L’émergence d’un droit à un environnement sain comme levier d’élargissement de la protection
L’exclusion des déplacés climatiques du statut conventionnel de réfugié a conduit une partie de la doctrine et de la jurisprudence à explorer des fondements alternatifs de protection, notamment dans le champ du droit international des droits de l’homme. Parmi ces fondements, le droit à un environnement sain émerge comme une norme transversale, susceptible de fonder des obligations positives pour les États et de servir de levier pour une protection indirecte contre le refoulement. Longtemps considérée comme relevant de la « soft law »[39], cette exigence environnementale connaît une institutionnalisation croissante au sein du droit international des droits de l’homme[40].
L’avis consultatif de la CIJ relatif aux Obligations des Etats en matière de changement climatique[41] constitue une étape décisive dans cette évolution. La Cour y affirme que « le droit à un environnement propre, sain et durable fait partie des droits humains »[42], et qu’il constitue une condition préalable à la jouissance de nombreux autres droits, notamment le droit à la vie, à la santé et à un niveau de vie adéquat, qui inclut l’accès à l’eau, à l’alimentation et au logement[43]. Elle insiste sur l’interdépendance entre les droits de l’homme et la protection de l’environnement, et considère que les obligations des États en matière climatique relèvent désormais du droit coutumier, avec une portée erga omnes[44]. Ce glissement vers une normativité renforcée est d’autant plus significatif que la Cour souligne que les États doivent évaluer les risques environnementaux dans toutes leurs décisions, y compris migratoires, en se fondant sur les meilleures données scientifiques disponibles[45].
Nonobstant, cette reconnaissance du droit à un environnement sain comme droit humain universel n’est pas nouvelle. Elle remonte depuis 1972 avec la Conférence de Stockholm, qui adopte une Déclaration[46] affirmant au point 1 et 2 du préambule que l’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, et que sa protection est essentielle au bien-être humain. Son principe 1 lie les droits de l’homme à un environnement de qualité, garantissant dignité et bien-être. Ce principe a influencé la Charte mondiale de la nature adoptée en 1982 par l’Assemblée générale des Nations unies[47] qui insiste sur la nécessité d’assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun , ainsi que le Rapport Brundtland de 1987, qui proclame que tout être humain a le droit fondamental à un environnement suffisant pour assurer sa santé et son bien-être.
La Déclaration de Rio de 1992 a poursuivi cette dynamique en introduisant le principe du développement durable[48], la satisfaction équitable des besoins des générations présentes et futures[49], et le principe des responsabilités communes mais différenciées[50]. Elle a également consacré, dans son principe 10, l’accès à l’information environnementale, la participation du public aux décisions, et l’accès à la justice, éléments désormais considérés comme procédurales du droit à un environnement sain[51]. En complément, les organes onusiens ont, dans plusieurs résolutions, reconnu l’impact de la dégradation environnementale sur les droits humains. Le processus s’ouvre avec la résolution 48/13[52] adoptée par le Conseil des droits de l’homme qui consacre le droit à un environnement propre, sain et durable comme essentiel à l’exercice des autres droits. Cette reconnaissance a été confirmée par la résolution A/76/L.75, adoptée par l’Assemblée générale le 26 juillet 2022[53], qui érige ce droit au rang de droit humain[54] et appelle les États à adopter de bonnes pratiques pour en assurer la réalisation[55].
Le rapport spécial du Conseil des droits de l’homme[56] définit la notion de « bonne pratique » comme « les lois, politiques, règles jurisprudentielles, stratégies, programmes, projets et autres mesures de nature à atténuer la dégradation de l’environnement, à améliorer la qualité de l’environnement et à garantir l’exercice des droits de l’homme »[57]. Elles concernent à la fois les éléments de procédure (accès à l’information, participation du public, accès à la justice) et les éléments de fond (air pur, climat sûr, eau potable, assainissement adéquat, aliments sains, environnement non toxique, biodiversité et écosystèmes sains). En application de ces bonnes pratiques, ce droit est désormais reconnu dans la législation de plus de 80 % des États membres de l’ONU, soit 156 sur 193. Cette reconnaissance normative, bien qu’encore inégalement mise en œuvre, constitue un levier juridique majeur pour fonder des obligations positives à la charge des États, y compris en matière de non-refoulement. En effet, si le retour d’un individu vers un territoire gravement dégradé compromet l’exercice de ses droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, à la santé ou à la dignité[58], l’État d’accueil pourrait être tenu de s’abstenir de l’expulser, en vertu de ses engagements internationaux.
La jurisprudence n’est pas à cet égard resté muette. En 2019, la Cour suprême des Pays-Bas, dans l’affaire Urgenda, a jugé que l’inaction climatique des autorités constituait une violation des droits fondamentaux à la vie et au respect de la vie privée, protégés par la CEDH[59]. L’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse[60] rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en avril 2024 est venu murir cette idée. La Cour y constate que de graves lacunes dans le cadre réglementaire de la Suisse, notamment l’absence de quantification contraignante des émissions nationales, constituent une violation de l’article 8 CEDH, lequel protège la vie privée et familiale[61]. Elle souligne que les États doivent définir des trajectoires claires vers la neutralité carbone, intégrées dans un cadre réglementaire contraignant assorti d’objectifs intermédiaires, de mesures immédiates et effectivement mises en œuvre, fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles[62]. Ce raisonnement de la Cour, fondé sur la vulnérabilité différenciée et sur l’obligation des États de protéger les individus contre des atteintes graves à leurs droits fondamentaux, ouvre la voie à une lecture contextuelle du principe de non-refoulement. Dans cette perspective, le non-refoulement ne s’analyserait pas uniquement à travers la persécution ciblée, mais aussi à travers l’exposition à des risques graves et prévisibles pour les droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la santé ou à la vie privée et familiale, lorsque ceux-ci sont menacés par la dégradation environnementale. Ainsi, si le retour d’un individu vers un territoire rendu invivable par le changement climatique compromet l’exercice effectif de ces droits, l’État d’accueil pourrait être tenu de s’abstenir de l’expulser, en vertu de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme. Toutefois, cette protection demeure indirecte, conditionnelle et fragmentaire. Elle ne confère pas de statut juridique autonome aux déplacés climatiques, mais constitue un levier complémentaire, mobilisable dans le cadre du droit international des droits de l’homme. Son effectivité dépend largement de l’interprétation des juridictions et de la volonté politique des États. En ce sens, elle ne saurait se substituer à une réforme structurelle du droit international, mais elle en constitue un jalon essentiel.
B. Les initiatives régionales et sectorielles : laboratoires d’innovation pour une protection différenciée
En l’absence d’un cadre universel contraignant pour la protection des déplacés climatiques, plusieurs instruments régionaux et sectoriels ont tenté d’apporter des réponses juridiques aux défis posés par les déplacements liés aux catastrophes environnementales. Bien que leur portée demeure limitée, ces initiatives constituent des espaces d’expérimentation normative, susceptibles d’inspirer une évolution plus inclusive du droit international, notamment en matière de non-refoulement.
A cet égard, la Convention de Kampala adoptée au sein de l’Union africaine le 23 octobre 2009 constitue le premier traité juridiquement contraignant à reconnaître explicitement les déplacements internes causés par des catastrophes naturelles ou anthropiques[63]. Elle impose aux États parties l’obligation de « protéger et d’assister les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à cause (...) des catastrophes naturelles (...) »[64]. Si cette protection ne s’étend pas aux franchissements de frontières, elle consacre une approche fondée sur la vulnérabilité environnementale plutôt que sur la persécution ciblée. Ce déplacement du critère de protection préfigure une extension fonctionnelle du principe de non-refoulement, en reconnaissant que certaines formes de déplacement imposent aux États une obligation de ne pas exposer les personnes à des conditions de vie incompatibles avec la dignité humaine.
En Amérique latine, la Déclaration de Cartagène sur les réfugiés adoptée le 22 novembre 1984 élargit la définition du réfugié aux personnes fuyant « des circonstances qui ont gravement perturbé l’ordre public »[65]. Bien que non contraignante, cette formulation a été intégrée dans les législations de plusieurs États (notamment le Brésil[66] et le Mexique[67]), pouvant permettre d’accorder l’asile à des personnes déplacées par des catastrophes environnementales. En pratique, cela revient à reconnaître une forme de protection subsidiaire, fondée sur l’impossibilité de retour dans des conditions compatibles avec les droits fondamentaux, ce qui rejoint l’esprit du non-refoulement tel qu’interprété par les juridictions internationales[68].
Sur le plan interétatique non contraignant, l’Agenda de protection de l’Initiative Nansen de 2015 propose des principes directeurs pour les États confrontés à des flux migratoires liés aux catastrophes[69]. Il recommande notamment : (i) la suspension temporaire des retours vers des zones sinistrées ; (ii) l’octroi de visas humanitaires ou de séjours temporaires ; (iii) la reconnaissance de formes de protection complémentaire en cas de menace grave à la vie ou à la santé[70].
Ces mesures, bien que dépourvues de force obligatoire, traduisent une reconnaissance implicite du non-refoulement environnemental, en ce qu’elles visent à empêcher le retour vers des territoires où la vie ou la dignité humaine seraient gravement menacées.
Plus récemment, le Plan d’action interaméricain sur le changement climatique 2023-2030 adopté au sein de l’Organisation des États américains appelle à intégrer les droits humains dans les politiques climatiques, y compris en matière de mobilité, en insistant sur la nécessité d’anticiper les déplacements et de garantir des voies d’accès sûres et régulières. De même, la déclaration de Liliendaal adoptée par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des Caraïbes soulignent la vulnérabilité particulière des petits États insulaires et appellent à une coopération régionale pour éviter les expulsions vers des territoires invivables[71], ce qui constitue une forme de reconnaissance du non-refoulement dans un contexte climatique.
Enfin, certaines législations nationales s’inspirent directement de ces instruments. Au Mexique, la Loi sur les réfugiés[72] a incorporé, dès 2011, la définition élargie de la Déclaration de Carthagène. Son article 13 II, reconnaît ainsi comme réfugié quiconque a fui en raison de « […] de violations massives des droits humains ou d’autres circonstances ayant gravement perturbé l’ordre public », ce qui, selon la pratique régionale, inclut les catastrophes naturelles et climatiques. Cette disposition permet d’interdire le retour vers des zones où les conditions de vie seraient incompatibles avec les droits fondamentaux, même en l’absence de persécution ciblée.
Ces initiatives demeurent néanmoins fragmentées, souvent limitées aux déplacements internes et dépourvues de mécanismes contraignants. Elles n’imposent pas explicitement aux États une obligation de non-refoulement au sens classique, mais elles en posent les fondements normatifs : reconnaissance de la vulnérabilité environnementale, interdiction implicite du retour vers des zones à risque, obligation de coopération et de solidarité.
En définitive, ces instruments régionaux et sectoriels fonctionnent comme de véritables laboratoires d’innovation juridique. Ils permettent d’élargir les catégories de protection, de tester des mécanismes de coordination interétatique et de renforcer la prise en compte des vulnérabilités environnementales dans les politiques migratoires. Au-delà de leur portée immédiate, ils contribuent à une évolution doctrinale du non-refoulement, qui tend à se détacher de la seule persécution ciblée pour intégrer l’exposition à des atteintes graves et prévisibles aux droits fondamentaux dans un contexte de dégradation environnementale. Par cette dynamique, ils ouvrent la voie à l’émergence d’un non-refoulement environnemental, encore imparfait, mais déjà perceptible dans la pratique et dans certaines législations nationales.
Conclusion
Les déplacés climatiques demeurent enfermés dans une zone grise du droit international : ni pleinement protégés par le régime des réfugiés, ni bénéficiaires d’un statut juridique autonome. Certes, le principe de non-refoulement, interprété à la lumière des droits de l’homme, interdit déjà les expulsions vers des territoires où la vie ou la dignité seraient gravement compromises. Mais cette garantie, fragmentaire et conditionnelle, reste insuffisante face à l’ampleur des vulnérabilités environnementales contemporaines.
Dans ce vide normatif, deux tendances se dessinent. D’un côté, l’extension jurisprudentielle du non-refoulement, fondée sur l’interdépendance des droits fondamentaux, offre une protection minimale dans les cas extrêmes. De l’autre, les initiatives régionales et sectorielles expérimentent des voies d’innovation juridique, posant les jalons d’un élargissement fonctionnel du non-refoulement au-delà du paradigme classique de la persécution.
Il devient désormais impératif de dépasser ces dynamiques fragmentaires pour repenser le socle de la protection internationale. Une première orientation consiste à reconnaître explicitement le droit à un environnement sain comme un droit justiciable, dont la violation peut fonder l’interdiction de retour. Une telle reconnaissance permettrait de consolider juridiquement le lien entre climat et droits humains, en érigeant l’environnement en critère autonome de protection, au même titre que la vie ou la santé.
Une seconde piste réside dans l’élaboration, au niveau international, d’un statut juridique spécifique pour les déplacés climatiques. Inspiré des instruments régionaux comme la Déclaration de Cartagena ou la Convention de Kampala, un tel statut devrait toutefois s’accompagner de mécanismes contraignants et de garanties institutionnelles afin d’éviter que la protection ne reste purement déclaratoire. En dotant les déplacés climatiques d’une identité juridique propre, le droit international comblerait le vide normatif actuel et renforcerait la sécurité juridique des États comme des individus.
Enfin, le principe de non-refoulement doit être réaffirmé comme socle d’une justice climatique émergente. En l’intégrant explicitement dans le corpus des obligations erga omnes, la communauté internationale consacrerait son caractère universel et inconditionnel, garantissant qu’aucun individu ne soit renvoyé vers un territoire rendu invivable par les effets du changement climatique. Loin d’être une simple garantie subsidiaire, le non-refoulement se transformerait ainsi en pilier central d’une protection adaptée aux mobilités induites par la crise climatique.
Notes de bas de page
- [1] GIEC, Climate Change 2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability, février 2022.
- [2] C. Cournil, « Les « déplacés climatiques », les oubliés de la solidarité internationale et européenne. De la gouvernance au contentieux », La Revue des droits de l’homme, 2022-22, mis en ligne le 26 juillet 2022, consulté le 28 mars 2025 (http://journals.openedition.org/revdh/15070).
- [3] M. Morel, N. de Moor, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures & Conflits, 2013/4, n° 88, pp.61-84.
- [4] Sur la définition du refugié, voir l’article Premier, A (2) : « Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
- [5] C. Cournil, « Les « déplacés climatiques », les oubliés de la solidarité internationale et européenne. De la gouvernance au contentieux », op. cit.
- [6] C.-A. Chassin, « Le critère de l’individualisation des duales dans le droit contemporain de l’asile », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 2015-13, mis en ligne le 1er novembre 2016, consulté le 28 mars 2025.
- [7] Cette disposition prévoit qu’aucun Etat « n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
- [8] L’article dispose que « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Le Comité des droits de l’homme a précisé, dans son Observation générale n° 20 sur l’article 7, Interdiction de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 mars 1992, que cette disposition implique également l’interdiction pour un État d’extrader, refouler ou expulser une personne vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à de tels traitements (§ 9).
- [9] « Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ».
- [10] L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Cour européenne des droits de l’homme a déduit de cette disposition l’interdiction du refoulement d’une personne vers un État où elle courrait un risque réel de subir de tels traitements. Voir notamment Soering c. Royaume-Uni (CEDH, 7 juillet 1989, §§ 91-92), Chahal c. Royaume-Uni (CEDH, 15 novembre 1996, §§ 74-80), et Saadi c. Italie (CEDH, 28 février 2008, §§ 125-133), où la Cour a réaffirmé que l’article 3 consacre un principe absolu interdisant toute expulsion ou extradition vers un pays où existe un risque sérieux de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.
- [11] « Nul ne peut être soumis par un Etat membre à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées (…) ».
- [12] Par exemple, une personne menacée de retour vers un territoire rendu invivable par la montée des eaux, la désertification ou l’effondrement des écosystèmes pourrait invoquer une atteinte grave à son droit à la vie ou à la dignité humaine.
- [13] Voir notamment, HCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1er janvier 2011 ; G. S. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refugee in International Law, Oxford, Oxford University Press, 2021.
- [14] O. Delas Olivier, Le principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des droits de l’homme. De la consécration à la contestation, Bruxelles, Bruylant, 2011.
- [15] V. Chetail, « Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit international », in V. Chetail, J.-Fr. Flauss (éds.), La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés - 50 ans après: bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 3-61; V. Chetail, « International Legal Protection of Migrants and Refugees: Ghetto or Incremental Protection? Some Preliminary Comments », in K. Padmaja (éd.), Law of Refugees: Global Perspectives, New Delhi, ICFAI University Press, 2008, pp. 31−46.
- [16] J. C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, pp. 1–9.
- [17] J. McAdam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 8.
- [18] R. Sabel, « The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol: A Commentary », Israel Law Review, 2012, n°45-3, pp. 555-566.
- [19] Comité des droits de l’homme, Observation Générale n°31, The Nature of the General Legal Obligation imposed on States Parties to the Covenant, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 mai 2004.
- [20] CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, n°14038/88, § 88-91.
- [21] J. McAdam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, op. cit., p. 196-199 ; G. S. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refugee in International Law, Oxford, Oxford University Press, 3ème éd., 2007, pp. 345–350.
- [22] Comité des droits de l’homme, Constatations relatives à la communication n°2728/2016, Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande, 24 octobre 2019, § 9.11.
- [23] Ibidem, §§ 9.12-9.13.
- [24] CIJ, avis consultatif du 23 juillet 2025, Obligations des États en matière de changement climatique, § 378.
- [25] Ibidem.
- [26] Ibid.
- [27] Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif du 29 mai 2025, Climate emergency and Human rights, n°OC-32/25.
- [28] Ibidem, § 422.
- [29] Ibid., § 385.
- [30] Ibid, § 423.
- [31] Ibid., § 434.
- [32] Ibid.
- [33] Ibid., §§ 431-434.
- [34] Ibid., § 434.
- [35] Voir notamment, K. Hailbronner, « Non-Refoulement and Humanitarian Refugees: Customary International Law or Wishful Legal Thinking? », in D.A. Martin (éd.), The New Asylum Seekers: Refugee Law in the 1980s. The Ninth Sokol Colloquium on International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1988, p. 144 ; J. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 364.
- [36] Voir notamment, J. McAdam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, op cit., p. 154.; J. Pobjoy, « Treating like alike: The principle of non-discrimination as a tool to mandate the equal treatment of refugees and beneficiaries of complementary protection », Melbourne University Law Review, 2010, vol. 34, p. 181.
- [37] B. Behlert , « A significant opening. On the HRC’s groundbreaking first ruling in the case of a ‘climate refugee’ », Völkerrechtsblog, 30 janvier 2020 (https://voelkerrechtsblog.org/a-significant-opening/). L’auteur souligne que cette décision « opens the door for future claims based on climate-related threats to life », tout en précisant que la reconnaissance reste limitée aux cas extrêmes.
- [38] Voir dans ce sens, C. Cournil. « L’inadaptation du droit international des réfugiés face aux migrations environnementales et climatiques », L'Observateur des Nations Unies, 2017, pp. 97-117.
- [39] P.-M. Dupuy, « Soft Law and the International Law of the Environment », Michigan Journal of International Law, vol. 12, n°2, 1991, pp. 420–435.
- [40] A. Boyle, « Soft Law », in The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, 2021, chap. 25, pp. 420–435; A. Ahmed et Md. Jahid Mustofa, « Role of Soft Law in Environmental Protection: An Overview », Global Journal of Politics and Law Research, 2016, vol. 4, n°2., pp. 1-18.
- [41] CIJ, avis consultatif du 23 juillet 2025, op.cit..
- [42] Ibidem, § 392.
- [43] Ibid, § 393.
- [44] Ibid..
- [45] Ibid., § 298.
- [46] Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, Stockholm, 16 juin 1972.
- [47] Charte mondiale de la nature annexée à la résolution de l’Assemblée générale du 28 octobre 1982, A/RES/37/7.
- [48] Principe 1.
- [49] Principe 3.
- [50] Principe 7.
- [51] Voir sur ce point, G. Ajabu Mastaki, Le droit à un environnement sain en République Démocratique du Congo : Une consécration à effectivité théorique, Mémoire de master, Université du Burundi, 2023, pp. 23-25 (https://repository.ub.edu.bi/server/api/core/bitstreams/f93d4ca7-8439-4ab0-b3af-3bace80a7988/content).
- [52] Conseil des droits de l’homme, résolution adoptée le 8 octobre 2021, A/HRC/RES/48/13.
- [53] Assemblée générale des Nations Unies, résolution du 26 juillet 2022, A/76/L.75 .
- [54] Ibidem, § 1.
- [55] Ibidem, § 4.
- [56] Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable présenté lors de la 43ème session, 24 février-20 mars 2020, A/HRC/43/53.
- [57] Ibidem, § 2.
- [58] D. Shelton, « Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized? », Denver Journal of International Law and Policy, 2007, vol. 35, pp. 129-137 ; Chuan-Feng Wu, « Challenges to Protecting the Right to Health under the Climate Change Regime », Health and Human Rights Journal, 2021, vol. 23-2.
- [59] Cour suprême des Pays-Bas, décision du 20 décembre 2019, Stichting Urgenda c. Pays-Bas, ECLI:NL:HR:2019, §§ 5.6.2-5.7.9.
- [60] CEDH, décision du 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n°53600/20.
- [61] Ibidem, §§ 573-574.
- [62] Ibidem , §§ 549-550.
- [63] Voir sur ce point, L. Dorothée, « Une étude juridique des crises humanitaires résultant de catastrophes climatiques : l’exemple du continent africain », Les Cahiers d’Outre-Mer, Octobre-Décembre 2012, n°260, mis en ligne le 01 octobre 2015, consulté le 27 mai 2025.
- [64] Article 5.
- [65] III.3 : « (…) étant donné l’expérience acquise du fait de l’afflux massif de réfugiés dansla région centraméricaine, il devient nécessaire d’envisager l’extension du concept deréfugié, en tenant compte le cas échéant et en fonction des caractéristiques de la situationdans la région, du précédent de la Convention de l’OUA (art. 1, par. 2) et de la doctrinesuivie dans les rapports de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Decette manière, la définition ou le concept de réfugié dont l’application est à recommanderdans la région pourrait, non seulement englober les éléments de la Convention de 1951 etdu Protocole de 1967, mais aussi s’étendre aux personnes qui ont fui leur pays parce queleur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, uneagression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l’hommeou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public ».
- [66] Voir la Politique nationale sur le changement climatique (Política Nacional sobre Mudança do Clima), Loi n° 12.187 du 29 décembre 2009, qui consacre les obligations de l’État en matière de prévention et d’atténuation des effets du changement climatique (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm).
- [67] Voir la Ley General de Cambio Climático, publiée au Diario Oficial de la Federación le 6 juin 2012 qui établit un cadre juridique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux impacts climatiques (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcc/LGCC_orig_06jun12.pdf).
- [68] Sur l’interdiction de refouler vers des conditions incompatibles avec les droits fondamentaux, voir Comité des droits de l’homme, Constatations relatives à la communication n°2728/2016, Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande, 24 octobre 2019, § 9.11 ; CIJ, avis consultatif du 29 mai 2025, Obligations des États en matière de changement climatique, § 378 (principe de non-refoulement applicable dans le contexte climatique), ainsi que § 393 (droit à un environnement propre, sain et durable comme condition préalable aux droits de l’homme) et § 440 (obligations erga omnes relatives à la protection du système climatique).
- [69] Nansen Initiative, Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change, vol. I et II, décembre 2015. L’Agenda identifie des pratiques efficaces à adopter volontairement par les États face aux déplacements liés aux catastrophes, notamment la suspension temporaire des retours vers des zones sinistrées, l’admission en séjour humanitaire ou temporaire, et la reconnaissance de mesures de protection complémentaires en cas de menace grave à la vie ou à la santé.
- [70] Ibidem, vol. I, §§ 10‑16.
- [71] Liliendaal Declaration on Climate Change and Development, adoptée lors de la 30ᵉ Réunion de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des Caraïbes, Liliendaal (Guyana), 2–5 juillet 2009 (https://caricom.org/liliendaal-declaration-on-climate-change-and-development-issued-by-the-thirtieth-meeting-of-the-conference-of-heads-of-government-of-the-caribbean-community-2-5-july-2009-georgetown-guyana/?utm_source=chatgpt.com). La Déclaration souligne la vulnérabilité particulière des Small Island and Low‑Lying Coastal Developing States (SIDS) face au changement climatique et à la montée des eaux, et appelle à une approche régionale coordonnée pour protéger ces États, notamment à travers des mesures visant à empêcher des déplacements ou expulsions vers des territoires devenus invivables.
- [72] Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, Diario Oficial de la Federación, 27 janvier 2011 (disponible sur : https://www.refworld.org/es/leg/legis/pleg/2022/es/134493).