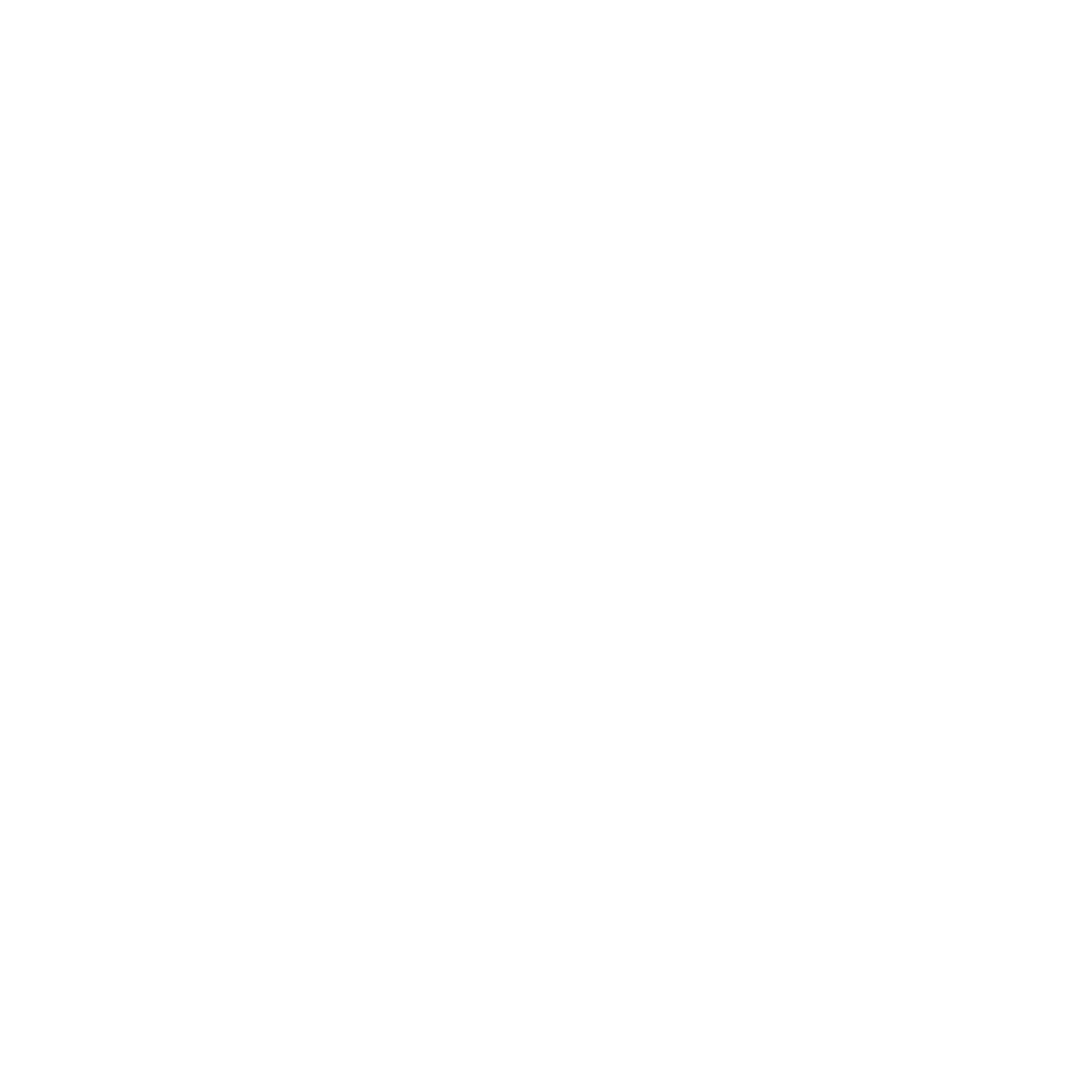Il peut surprendre qu'une étude articule les changements anticonstitutionnels de gouvernements (ci-après « CAG ») et l'asile. Le système africain de l'asile se heurte en effet à une frontière invisible, née de l'articulation difficile entre les impératifs de gouvernance démocratique et de protection humanitaire. Cette tension concerne le sort asilaire des instigateurs de CAG. Initialement, les sanctions régionales ciblaient les États et non leurs auteurs. Avec l'adoption en 2007 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (ci-après « CADEG »), ratifiée par 39 des 55 États africains[1], les instigateurs sont devenus des cibles directes.
Précisons d'emblée que les CAG ne sont pas définis en Afrique. L'article 1 de la CADEG, pourtant consacré aux définitions, les ignore, malgré que leur « rejet » et « condamnation » soit parmi ses objectifs[2]. L'article 23 énumère toutefois cinq situations assimilées à un CAG. Une sixième a été ajoutée par l’annexe du Protocole relatif aux amendements au Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (ci-après le « Protocole de Malabo ») en 2014[3]. Onze ans plus tard, ce protocole n'est toujours pas en vigueur. L'article 25 de la CADEG fixe les sanctions contre les instigateurs de CAG. Son paragraphe 8 interdit aux États de leur accorder asile ou refuge, imposant leur refoulement. Cette « moralisation »[4] de l'asile entre en tension avec l'article 33 de la Convention de Genève de 1951, qui consacre le principe de non-refoulement. Une frontière se dessine ainsi entre la gouvernance démocratique, compétence régionale, et la protection des réfugiés, relevant du droit international (universel). L'article 33 interdit en effet d'expulser ou de refouler un réfugié vers un territoire où sa vie ou sa liberté est menacée, notamment pour ses opinions politiques. Ce principe de non-refoulement est aussi considéré comme indissociable de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains[5]. Or, dans les régimes non démocratiques nombreux en Afrique, le risque de persécution pour un instigateur de CAG est évident. L'affaire dite du « coup d'État manqué » ou de procès « des conspirateurs » organisé au Zaïre (actuelle RDC) du 20 août au 1er septembre 1975 en est une illustration. Sous le régime dictatorial de Mobutu, la justice condamna alors à mort de nombreux officiers supérieurs. L'un d'eux, gracié par la suite, a témoigné avoir croupi pendant quatre ans et demi dans une cellule minuscule (de 1m x 2m), entièrement dépourvue de mobilier[6]. Un peu plus avant, en 1966, un procès expéditif d'à peine une heure et demie avait conduit à la pendaison publique du Premier ministre et de quatre ministres, les « pendus de la Pentecôte », car soupçonnés d’avoir planifié un CAG contre Mobutu[7].
Ces exemples démontrent qu'à l'échec d'un CAG, la fuite est une nécessité vitale face au risque de persécution. Comme l'estime Dave Peterson, le nouveau totalitarisme en Afrique affecte la vie quotidienne de millions de citoyens[8]. Mais même un CAG réussi peut précipiter la fuite de ses auteurs si le pouvoir leur échappe[9]. Ainsi, Gilbert Diendéré, auteur d'un putsch en 2015 au Burkina Faso, condamné en 2019, s'était réfugié dans les premiers temps de sa défection à l'Ambassade du Vatican avant de négocier les conditions de sa reddition[10]. Sans en être la figure exclusive de manifestation, les coups d'État constituent la forme la plus répandue des CAG en Afrique. Le continent a enregistré 133 putschs réussis et 156 tentatives avortées[11] entre 1945 et 2023. Un récent exemple illustre cette dynamique : le 11 octobre 2025, le président malgache a été renversé par des manifestations soutenues par l'armée puis exfiltré vers la France. Par une décision surréaliste du 14 octobre, la Haute Cour Constitutionnelle malgache (ci-après « HCC ») a qualifié la situation de « vacance » présidentielle, invitant de jure un militaire à prendre le pouvoir[12]. Fondamentalement, les CAG étant des actions politiques, leurs instigateurs peuvent les présenter comme une idéologie spécifique et les assimiler à une « opinion politique » au sens de l'article 1er de la Convention de Genève. Combiné à l'article 33(2), ce fondement rendrait ces acteurs éligibles à la protection internationale, d'autant qu'ils ne semblent pas a priori concernés par les exclusions de l'article 1F. Cette assimilation n'est pas théorique. La quasi-totalité des auteurs de CAG, surtout de coups d'État, justifient leurs actions par divers discours, jusqu'à quinze registres différents identifiés[13]. Ces rhétoriques idéologiques, typiques des partis politiques, instrumentalisent la communication[14], pour légitimer un prétendu « combat » pour le bien-être populaire. Si nous admettons avec Charles Manga Fombad que les idéologies des partis politiques sont moins claires en Afrique[15], dans la décision malgache précitée, l’acte de saisine de la HCC utilise un vocabulaire idéologiquement chargé pour justifier le CAG en le qualifiant « d'empêchement définitif du pouvoir ». En outre, il dénonce « les actes de répression », « l'absence de liberté d'expression » et « la non-jouissance des droits fondamentaux » comme tares ayant justifiés le ralliement de l’armée a la masse populaire manifestante. Ce qui illustre cette stratégie de légitimation.
La plupart des États africains sont liés par ces deux cadres juridiques. Quelle que soit leur décision –– refouler ou accorder l'asile à un auteur de CAG –– ils peuvent s'appuyer sur l'un de ces textes, mais chaque option engage leur responsabilité. D'un côté, l'Union africaine (ci-après « UA ») pourrait sanctionner un État accordant l'asile, au titre de l'article 23 de son acte constitutif. De l'autre, le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (ci-après « HCR ») pourrait exercer des pressions sur un État ne respectant pas la Convention (article 35). Ce dilemme place les États dans une impasse. L’application de la CADEG au détriment de la Convention est de nature à minorer le régime international de protection et donc, induire la violation de l’article 33. Faire primer la Convention implique, à l’inverse, que les États doivent violer la CADEG. Cela créerait en plus une hiérarchie normative contestable entre deux ordres juridiques internationaux. Ce conflit normatif, né de la fragmentation du droit international, engendre une instrumentalisation juridique. Car la possibilité de choisir entre les deux régimes ouvre la voie à l'arbitraire, transformant la question des instigateurs de CAG en une frontière tanguant entre l’incertain et le certain, l’invisible et le visible. Comme les États doivent préserver leur légitimité à la fois régionale en matière de gouvernance et internationale en matière humanitaire, savoir comment ils se comportent face à cette frontière est utile. Face à la croissance des CAG, il éclaire le sort juridique de leurs auteurs en matière de protection des réfugiés.
Dans cet article nous répondons à trois questions : Les États africains peuvent-ils naviguer cette frontière incertaine sans compromettre leur légitimité régionale ou internationale ni violer les droits humains reconnus aux demandeurs d’asile ? Quelles attitudes stratégiques, et pour quelle licéité, les États adoptent-ils en pratique face à la frontière heurtant les auteurs des CAG ? Quelles solutions juridiques et politiques peuvent dépasser ou, au mieux, éliminer définitivement cette frontière afin de concilier démocratie et humanité ?
I. Concilier l’asile, la légitimité des décisions et les droits humains des instigateurs des CAG : l’équation impossible ?
L’octroi de l’asile aux entrepreneurs de violences politiques place les États devant un dilemme : concilier le droit international des réfugiés avec le constitutionnalisme régional, sans sacrifier ni les exigences démocratiques ni les garanties fondamentales des droits humains, notamment en matière de l’asile.
A. L’instigation des CAG saisie par la frontière ? les incertitudes dans les systèmes universel et africain de l’asile
La définition du réfugié de l'article 1A (2) de la Convention de Genève de 1951 est reprise mutatis mutandis en Afrique. Dès 1969, l'Organisation de l'Unité Africaine (ci-après « OUA ») a complété ce cadre universel en adoptant sa propre convention, la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (ci-après « Convention de l’OUA ») entrée en vigueur en 1974[16], pour mieux cerner les réalités locales et élargir les critères d'octroi du statut de réfugié sur le continent. La Convention de l'OUA ne contredit donc pas celle de Genève ; elle la complète en élargissant la définition du réfugié pour inclure les réalités africaines. Son article I (2) étend ce statut à toute personne contrainte de fuir en raison « d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public ». Cette complémentarité, marquée par la reprise et l'élargissement de la définition de Genève, dissipe toute contradiction. Dès lors, pour déterminer si les instigateurs de CAG peuvent bénéficier de la protection internationale en tant que réfugié, dont l'article 33(1) de la Convention de Genève est la conséquence ou de son quasi-équivalent (l'article II (3) de la Convention de l'OUA)[17], l'analyse des clauses d'exclusion contenues dans les deux textes nous semble être l'élément décisif. L'article 1F de la Convention de Genève exclut les personnes suspectées de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes graves de droit commun ou d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Quant à La Convention de l'OUA, dans son article I§5, reprend ces exclusions et y ajoute notamment les crimes graves à caractère non politiques et les actes contraires aux objectifs de l'OUA, devenue Union Africaine (ci-après UA) depuis 2002.
Concernant la Convention de Genève, l'article 1F a une double fonction : préserver l'intégrité du statut de réfugié et empêcher que des criminels de guerre et auteurs des crimes graves ne fuient la justice[18]. Or, les CAG ne constituent pas en soi des crimes internationaux graves (art. 1F a), ils pourraient en constituer dans des cas extrêmes s'ils s'accompagnent d'atrocités spécifiques, ce qui exige une analyse au cas par cas selon les diverses formes qu’ils peuvent prendre. En outre, étant de nature politique et collective, ils ne présentent pas non plus les éléments constitutifs d'un crime de droit commun (art. 1F b), comme l'intention criminelle personnelle ou l’atteinte à un bien juridique individuel, etc. C’est pourquoi elles relèvent des qualifications spécifiques du droit international ou constitutionnel, généralement ignorées par les codes pénaux des États. Enfin, un CAG n'est pas intrinsèquement contraire aux buts de l'ONU (art. 1F c) si l'État continue de respecter ses obligations internationales, comme en témoigne la participation aux instances onusiennes de régimes africains issus de tels changements. Ainsi, l'application de ces clauses d'exclusion de la Convention de Genève aux instigateurs de CAG reste discutable.
Quant à la Convention de l'OUA, elle inclut implicitement les CAG, suivant les critères des « événements troublant gravement l'ordre public », constitutionnel en l’espèce[19], dans son champ des causes pouvant entrainer la qualité de réfugiés. Cependant, elle exclut explicitement les personnes ayant porté atteinte aux objectifs et principes de l'organisation régionale. Cette dualité crée une tension juridique certaine concernant le sort des instigateurs de CAG. En effet, les articles 3 et 4 de l'Acte constitutif de l'UA proclament ces principes : la promotion de la démocratie (art. 3g) et la « condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement » (art. 4p). Comme l'a relevé la Commission africaine des droits de l'homme dans l'affaire Sir Dawda K. Jawara c. Gambie[20], les CAG violent le droit de la population à la participation politique. Cette violation pourrait justifier l'exclusion de la protection asilaire des instigateurs, bien que le principe de condamnation des CAG, postérieur à la Convention de l’OUA, peut poser des questions d'applicabilité temporelle.
En supposant donc que l’exclusion affecte les instigateurs des CAG, une telle lecture repose principalement sur une interprétation littérale et évolutive de ladite Convention. Cependant, comme le souligne Geoff Gilbert, l'exclusion du statut de réfugié ayant des conséquences graves, elle doit être appliquée avec une extrême prudence[21]. Dans le cas des instigateurs des CAG, cette prudence invite à nuancer notre interprétation précédente par une approche téléologique et contextuelle. Si l'on examine l'intention des rédacteurs de la Convention de l'OUA en 1969, force est de constater que ni la participation populaire ni la condamnation des CAG ne figuraient dans les objectifs conventionnalisés de l'organisation aux articles II et III de sa Charte du 25 mai 1963. Les premiers textes fondateurs rejetant explicitement les CAG datent de 1999[22], soit trente ans plus tard. Cet écart temporel suggère que les CAG étaient alors tolérés, voire que leurs instigateurs l'étaient également, ce qui expliquerait le recours initial à des instruments non contraignants pour les réguler. L'objet et le but de la Convention de l’OUA militent en faveur de l'inclusion des instigateurs de CAG. Bien que toujours au titre des exclusions, son article 1er §5(b) exclue les auteurs ayant commis de « crimes graves de caractère non politique », un CAG a par essence pour objet la capture du pouvoir politique[23]. Même s'il est considéré comme le crime le plus grave contre la sûreté de l'État en droit africain, son caractère fondamentalement politique le distingue des infractions de droit commun. Ainsi, la Convention de l'OUA, qui n'entend pas viser les crimes politiques, pourrait offrir une protection à leurs auteurs.
De ce qui précède, l'éligibilité des instigateurs de CAG à l'asile relève d'une zone grise juridique, dépendante de l'interprétation qu’on pourrait faire des Conventions de Genève et de l'OUA. En application de la dernière Convention, une frontière nette pourrait émerger en cas d'assassinat politique, qui au moins était interdit absolument par la Charte de l'OUA au titre de ses principes, bien qu’au niveau régional, depuis l’OUA à ce jour, il n’existe aucune définition normative au niveau régional, dudit assassinat[24]. Mais même dans ce cas où la frontière pourrait émerger, tout CAG n'implique pas la mort de l'élimination physique du dirigeant, peu importe qu’il prenne ou non la Forme d’un coup d’État. En Afrique, transforment avec « magnanimité » tactique d’anciens présidents en accessoires vivants de leur propre légitimité. La récente expérience montre qu’elles préfèrent les assigner à résidence pour maquiller symboliquement leur autoritarisme décrié[25], en transition « nécessaire ». Les cas des dirigeants renversés – Ali Bongo en 2023 au Gabon, confiné dans une résidence surveillée pendant deux ans avant sa libération pour son exil en Angola ; Mohamed Bazoum au Niger en 2023, gardé otage dans son palais présidentiel ainsi que Ibrahim Boubacar Keïta en 2020 au Mali, contraint à une démission avant de décéder naturellement[26] – sont éloquents.
B. La frontière née du constitutionnalisme continental : rationalités, porosités et dilemmes à l’asile
Face à l'incertitude concernant la protection des auteurs de CAG par les Conventions de Genève ou de l'OUA, la CADEG établit une exclusion claire du statut de réfugié. Son quatrième objectif interdit et condamne tout CAG comme « menace grave à la stabilité, la paix, la sécurité et le développement », tandis que son dixième principe en prescrit le rejet. Pour le rappeler encore une fois, les articles 23 de la CADEG et 28E du Protocole de Malabo constituent le fondement juridique des situations assimilées aux CAG. La menace des CAG pour la paix et la sécurité est avérée. Coups d'État, mercenaires et groupes rebelles ont souvent dégénéré en conflits civils[27], comme en témoignent les sécessions du Katanga (1960-1963) et du Biafra (1967-1970), le renversement successif des présidents comoriens par des mercenaire[28] , ou plus récemment le putsch de la Séléka en Centrafrique (2013)[29]. Cela étant, on peut considérer que les articles 23 de la CADEG et 28E du Protocole de Malabo traduisent juridiquement ces enseignements historiques pour les conjurer.
Le refus de céder le pouvoir constitue une autre forme de CAG. En 2016, le président gambien sortant Yahya Jammeh a initialement refusé de reconnaître sa défaite électorale face à Adama Barrow. Il n'a accepté de quitter le pouvoir qu'à la suite d'une sortie négociée et sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO[30], qui était prête à intervenir par la force pour rétablir la légitimité démocratique. Cette stratégie de conservation du pouvoir passe aussi par des violences postélectorales, comme au Kenya en 2007, au Zimbabwe en 2008 ou en Côte d'Ivoire en 2010. De même, des élections non crédibles ont engendré des crises violentes au Nigeria (1993), en Côte d'Ivoire (2012), au Kenya (2017) et au Malawi (2019). Enfin, la modification opportuniste des constitutions et des lois électorales pour verrouiller l'accès au pouvoir –– en jouant sur l'âge d'éligibilité ou la limitation des mandats –– mine le principe d'alternance. Ces pratiques, sources de vives tensions politiques et sociales, ont notamment été observées en Ouganda (2005), au Cameroun (2008), au Rwanda (2015), au Tchad (2018), au Burundi (2018), au Comores (2018), en Égypte (2019) et au Togo (2019)[31]. Les contestations de ces amendements virent souvent en répressions meurtrières variables selon les pays[32].
Ainsi, la normativité sanctionnant les auteurs de CAG s'appuie sur trois logiques : démocratique, pacifiste et sécuritaire. L'article 25 de la CADEG énonce les sanctions directes, particulièrement au point 8 qui interdit aux États d'accorder l'asile aux instigateurs. Pour Blaise Tchikaya, par-là l'UA reformule la problématique des sanctions en droit des gens avec un succès mitigé. Cet auteur souligne que l'approche des sanctions non militaires suscite d'inépuisables débats et rappelle la nécessité d'harmoniser normes régionales et internationales[33]. À notre avis, cette harmonie est partiellement rompue. L'obligation instaurée par la CADEG d'éloigner et de refuser l'asile aux auteurs des CAG transforme toute tentative de CAG, réussie ou non, en frontière au système africain de l'asile. En conséquence, elle semble impliquer la contestation de la qualité de réfugié (politique) dont peut revendiquer un instigateur de CAG au sens de l'article 1 de la Convention de Genève. Par-là, il existe une tension assez fondamentale entre l'article 25(8) de la CADEG et la logique juridique de la Convention de Genève.
Pour comprendre cette contradiction, il faut saisir la structure en deux temps du droit des réfugiés. Premièrement, la qualité de réfugié s'acquiert, comme on l'a montré précédemment, sur la base d'un critère simple : une personne, craint avec raison d'être persécutée en raison notamment de ses opinions politiques, et se trouve en dehors de son pays. Un instigateur d'un CAG, menacé de représailles pour son acte politique, surtout après l'échec de son entreprise, peut selon nous parfaitement répondre à cette définition. Ses actes, bien que condamnables, n'effacent pas le risque de persécution qu'il court, risque que la Convention entend précisément couvrir. Même la Convention de l'OUA prolonge la même logique. Deuxièmement, la Convention de Genève prévoit certes des exclusions pour les criminels les plus graves, mais ces exclusions sont tellement exceptionnelles qu'elles doivent être appliquées, comme nous l’avons dit, avec la plus grande prudence. L'exclusion n'intervient que si des raisons sérieuses permettent d'établir que la personne a commis des crimes internationaux ou des crimes graves de droit commun. Or, participer à un CAG n'équivaut automatiquement à aucun de ces crimes. L'approche de la CADEG, qui décrète une exclusion collective et systématique, bouleverse cet équilibre délicat mais nécessaire de la Convention. Elle fait des CAG une nouvelle catégorie d'exclusion, non prévue par le droit international et même africain des réfugiés, et ignore l'obligation fondamentale d'examiner chaque cas individuellement. Cette frontière normative de la CADEG risque de priver les instigateurs des CAG de la protection contre le refoulement, pourtant garantie par la Convention, dès lors qu'ils craignent légitimement d'être persécutés.
L'articulation entre l'article 25(8) de la CADEG et l'article 33 de la Convention de Genève place les États dans une position délicate concernant l'asile aux putschistes. La CADEG, priorisant la paix et la démocratie régionale, légitime un choix étatique qui évite les sanctions de l'UA, susceptible d'interpréter tout asile comme un « soutien » aux CAG[34]. Cependant, ce positionnement crée un écart problématique avec les garanties fondamentales du droit des réfugiés. Il introduit un risque d'arbitraire, où la qualification de réfugié, l'asile et le non-refoulement entrent dans une zone grise d'instrumentalisation juridique[35], au détriment des protections individuelles.
La relégation de la Convention de Genève signifierait que les États font primer les enjeux démocratiques et sécuritaires sur ceux humanitaires. Pourtant, la Convention de Genève vise à garantir à tous les réfugiés « l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». C’est dans cette optique que l’article II de la Convention de l’OUA considère l’asile comme un acte humanitaire qu’aucun État ne peut regarder comme hostile ou inamical. Dans cette perspective, les différentes rationalités gouvernant ce corps de règles deviennent les catalyseurs des décisions des États. L’argument de protection des droits humains, fondé sur la Convention de Genève, offre aux États la possibilité de mobiliser des instruments de protection des réfugiés, et plus largement, des droits de l’homme, comme base justificative de leur choix. Il permettrait également, pour trois raisons, aux instigateurs des CAG eux-mêmes de contester en justice la non-conformité aux normes de protection des droits de l’homme d’une décision de refoulement ou d’expulsion[36] fondée uniquement sur la CADEG.
La première raison se fonderait autour de l’argument d’après lequel, le principe de non-refoulement, reconnu comme norme coutumière par la Commission ADHP[37], s'impose à tous les États[38], qu'ils aient ou non ratifié la Convention de Genève, et doit être respecté sans restriction[39]. Ensuite, malgré l'absence de hiérarchie formelle entre les sources du droit international, rien ne justifie que la CADEG prime sur la Convention de Genève, standard universel de protection des réfugiés. Deuxièmement, l'article 12(3) de la Charte africaine établit un droit de rechercher et recevoir l'asile. Bien que sa portée soit débattue[40], cette disposition crée un véritable droit d'asile en Afrique, de nature conventionnelle, protégeant contre le risque de persécution, et non seulement la persécution subit mais essentiellement celle encourue[41]. Enfin, les instigateurs de CAG peuvent invoquer l'incompatibilité de l'article 25(8) de la CADEG avec les Principes directeurs africains de 2023, de la Commission ADHP, protégeant notamment les réfugiés[42]. Le Principe 22(1) dispose que tout réfugié doit bénéficier de tous ses droits prévus par les cadres africain et international, et que ses circonstances spécifiques doivent être prises en compte pour adapter la protection. Le point 2 rappelle l'interdiction du refoulement lorsqu'il met en danger la vie ou la liberté du réfugié. Le point 3 précise qu'aucun État ne doit soumettre un réfugié à des mesures –– refoulement, refoulement secondaire ou expulsion –– qui l'obligeraient à se trouver dans un territoire où sa vie, son intégrité ou sa liberté seraient menacées, notamment en raison d'une opinion politique ou d'événements troublant gravement l'ordre public. Peu importe que la personne soit à l'origine de ces événements ; seul l'existence d'un risque ou d'une crainte fondée de persécution est un critère déclenchant la protection. Cela reflète la place de philosophie Ubuntu[43] dans l'approche africaine de protection des réfugiés[44], déjà invoquée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans sa première affaire, Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal, jugée le 15 décembre 2009 (bien que la Cour ne se soit prononcée que sur la forme).
L'invocation de ces bases normatives par un instigateur de CAG, articulée à une crainte fondée de persécution, gagnerait en force devant le juge si étayée d'exemples concrets. En octobre 1998, le gouvernement sierra-léonais a ainsi exécuté 24 putschistes pour trahison, dont d'anciens chefs d'état-major et le colonel FY. Koroma, frère du leader putschiste en fuite. Sur 34 officiers condamnés à mort, 24 furent exécutés, seize civils condamnés et des centaines d'autres détenus sans procès[45]. Ainsi, la philosophie humanitaire protégeant les réfugiés peut disqualifier l'argumentaire démocratique et sécuritaire régional qui érige les CAG en frontière absolue à l'asile. Toute tentative de prise de pouvoir par la force crée une prédisposition au statut de réfugié politique. La réussite récompense ses auteurs et annule cette prédisposition ; l'échec légitime la demande d'asile. Priver ces instigateurs du droit d'asile violerait les droits humains et les normes internationales. Les États s'y exposant risquent des pressions du HCR : rapports critiques ou réduction de l'aide humanitaire. Leurs choix deviennent ainsi périlleux, entre maintien et transgression d'une frontière également risquée.
II. Bricolage des pratiques anti-frontières et perspectives conciliant démocratie et humanité
Les motifs poussant à s’exiler sont complexes en Afrique. Comme faits troublant gravement l’ordre public, les CAG, essentiellement les coups d’état et la tentative de bloquer l’alternance au Sénégal, sont pointés du droit par Salma Sassi-Safer, Commissaire et Rapporteure spéciale de la Commission ADHP sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique, comme un des facteurs de fuite[46]. Les synergies et discordances possibles autour des critères de la licéité ou d’illicéité des restrictions susceptibles de heurter les instigateurs des CAG, poussent les États à transformer cette frontière en espace d’expérimentation des pratiques alternatives, reposant sur des asiles informels où la protection est accordée aux instigateurs sans cadre juridique précis. Bien qu’à ce stade, cette tendance demeure faible, son éventuelle généralisation pourrait poser des défis. Ce qui justifie d’inventer ou repenser de nouvelles solutions, à la fois efficaces et respectueuses du droit, pour concilier impératif démocratique et humanitaire.
A. L’incertitude autour de la frontière des CAG : un espace des stratégies (méta)juridiques de contournement
Ne sont considérés comme CAG en Afrique, du moins jusque-là, que les seuls cas repris aux articles 23 de la CADEG et 28E de l’annexe au Protocole de Malabo. La doctrine, dont nous partageons la position, est d’avis que les cas fournis à ces dispositions, sont restrictifs. Ils ne rendent pas compte de la réalité du terrain africain et de sa complexité. Ces deux dispositions non couvrent pas certaines situations devant constituer un CAG. Comme notamment le refus par d’un gouvernement en place d’organiser les élections dans le délai (RDC en 2016) ou des cas des soulèvements populaires empreints des suspicions de manipulations étrangères[47] (Tunisie, Égypte, Burkina Faso), qui aboutissent au renversement des régimes (le cas le plus récent est celui Madagascar). C’est dans cette optique par exemple, que des voix s’élèvent de plus en plus aujourd’hui pour que ces faits soient reconsidérés, et qu’il soit consacrée une définition institutionnelle de « soulèvement populaire ». À ce propos, il ne sera pas donc surprenant que demain ou après, le catalogue sur le profil des instigateurs des CAG change et évolue.
La criminalisation (prospective) des CAG (en attendant que le Protocole de Malabo entre en vigueur) produira des conséquences sur l’établissement des preuves et l’imputation ou l’attribution de la responsabilité. En développant une lecture tissée sur le droit pénal, deux principes sont à retenir : la seule tentative de commettre un CAG, si elle échoue, peut être considéré comme une infraction consommée. Si elle réussit par contre, mais que les auteurs ne soient à même de conserver le pouvoir, le crime est aussi considéré comme consommé. En conséquence, « craignant la persécution », tout instigateur se trouvant dans l’un de ces deux hypothèses, peut chercher à obtenir l’asile. Mais au même moment, ces éléments de lecture peuvent influencer la décision étatique concernant l’asile des instigateurs demandeurs, si un État décide d’appliquer la CADEG.
La question pertinente préalable, au regard de la pluralité de participants qu’implique l’exécution d’un CAG (et donc aussi des fuites massives des instigateurs qu’il peut occasionner) est d’abord de savoir à quelle catégorie des personnes ou individus un tel crime serait imputable pour écarter d’autres, même simplement soupçonnés, du risque d’être refoulés en application (à tort à leur égard) de la CADEG. Selon une décision du Conseil constitutionnel de Burkina Faso, rendu à l’occasion du procès d’un CAG défait, seuls des dirigeants peuvent commettre ce type de crime. Cette vision est partagée par A. Soma qui qualifie les CAG de leaderships crime[48]. Les dirigeants en question peuvent être militaires ou politiques. Pour les militaires, A. Soma estime que les subalternes ou mercenaires ne peuvent être tenus pour responsables. Cette position est discutable car certaines jurisprudences vont à l’encontre de cette limitation. Quant aux dirigeants politiques, le Conseil constitutionnel burkinabé a inclus le Chef de l’État, le membres du gouvernement, du parlement, des partis politiques, et même des responsables associatifs en raison de leur soutien à un CAG visant à se maintenir illégalement au pouvoir. À ce niveau, même les complices à un CAG sont visés. Ce qui signifie qu’il pourrait également être frappés par des décisions étatiques négatives en matière d’asile.
Bref, au regard de tout ce qui précède, l’instigation des CAG comme frontière de l’asile, pourrait affecter la quête de l’exil et exposer massivement ou collectivement les instigateurs, peu importe leur niveau de participation et contribution, au risque de persécution, lorsque l’État leur applique le cadre juridique régional strict. Cependant, à mieux observer il y a lieu de remarquer que la décision d’un État à appliquer ce cadre, masque une sanction institutionnelle contre les instigateurs qui équivaut à une sanction collective. Cette sanction vise ou affecte tout un groupe que l’on peut considérer ––même si ce point est discutable–– comme uni par une « opinion politique » commune, qui se concrétise par leur conduite idéologique visant renverser l’appareil d’État installé. La plupart des CAG instigués mobilisent notamment la rhétorique de salvation de la population contre des régimes autoritaires ou oppressifs et drainent souvent des sympathisants. Or, si l’expulsion représente une mesure exceptionnelle qui ne doit pas se généraliser, l’expulsion collective ou massive fait tout le contraire. C’est pourquoi le système africain de l’asile l’interdit en ciblant des groupes précis.
Afin de ne pas courir le risque de violation des droits de l’homme ni celui résultant de la relégation des impératifs démocratiques consacrés par la CADEG, dans leurs décisions concernant l’obligation de (non) refouler et d’accorder l’asile aux instigateurs de CAG, les États inventent des solutions de protection informelle, qui se situent en dehors des deux cadres juridiques principaux analysés. Ces solutions, tout en ayant un rapport avec ces cadres, les neutralisent. Les traitements de deux anciens présidents instigateurs de CAG manqués peuvent être pris pour exemple.
1. La nationalité comme asile politique informel : le cas Compaoré
Blaise Compaoré est un ancien président du Burkina Faso. Il a fui son pays en octobre 2014 par la Côte d’Ivoire après un soulèvement populaire contre sa tentative –– interdite par la CADEG –– de modifier la Constitution pour prolonger son mandat et bloquer l’alternance politique. Réfugié en Côte d’Ivoire, il obtient la nationalité de ce pays par décret présidentiel n°2014-701, à seulement deux semaines de sa fuite. Ce décret n’a été publié au Journal officiel qu’en 2016[49]. Cette naturalisation de Compaoré peut être considérée comme cas d’asile informel où le droit de la nationalité est instrumentalisé pour contourner la frontière susceptible de bloquer l’entrée et le séjour de Compaoré en tant qu’instigateur d’un CAG avorté. Elle joue une fonction protectrice équivalente voire supérieure à celle de l’asile car en accordant sa nationalité à Compaoré, la Côte d’Ivoire active le principe « d’inextradabilité » des nationaux. Et tant qu’elle ne sera pas déchue, cette nationalité neutralise toute hypothèse de refoulement. Elle confère à Compaoré le droit inaliénable d’entrer, rester, quitter et revenir en Côte d’Ivoire à tout moment.
Cette manœuvre est réellement une protection de facto. Elle esquive les mécanismes formels du droit des réfugiés pour produire les mêmes effets. C’est une décompression des contraintes juridiques relatives au traitement à réserver aux instigateurs des CAG. Comme national, Blaise Compaoré n’a plus besoin de demander l’asile politique en Côte d’Ivoire, pourtant son pays de refuge. Cette stratégie juridique permet aussi à la Côte d’Ivoire d’échapper à toute éventuelle accusation de violation des droits humains protégés par la Convention de Genève, la Convention de l’OUA et la Charte ADHP et lui met à l’abri des sanctions du HCR (comme des rapports critiques ou réduction d’aide) et de l’UA, dans la mesure où les États disposent de la compétence discrétionnaire ou souveraine, absolue, en matière d’attribution de leur nationalité.
2. Griller la frontière au nom de la paix : le cas de Yayah Jammeh
La paix qui, ironiquement, est l’une des rationalités à la base de la limite introduite à l’égard des instigateurs de CAG par la CADEG, sert également de levier pour contourner cette même limite. Ancien président de la Gambie, Yayah Jammeh a refusé de reconnaître sa défaite électorale de décembre 2016 face à Adama Barrow. Ce qui déclencha une crise constitutionnelle grave. Après avoir initialement accepté les résultats, il les a rejetés, invoquant des irrégularités, et a prolongé illégalement son mandat par un vote parlementaire orchestré en état d’urgence, créant une situation de double présidence et une impasse politique en Gambie. La Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (ci-après « CEDEAO ») menaçait une intervention militaire afin de faire respecter la volonté démocratique[50].
Cependant, face à la ténacité de Jammeh de ne pas capituler, un accord politique fut négocié par la CEDEAO par l’entremise des présidents de la Guinée-Conakry et de la Mauritanie mandatés comme médiateurs. Cela a évité un conflit armé ouvert tout en conduisant à un exil arrangé politiquement. Bizarrement, même l’UA a salué cela. Dans un communiqué conjoint avec la CEDEAO et l’ONU, ces organisations ont pris l’engagement de collaborer avec le nouveau gouvernement gambien afin de garantir la dignité, la sécurité, le respect des droits de l’ancien président Jammeh, des membres de sa famille, de son cabinet, de ses anciens partisans (militants, dirigeants de son parti politique et militaires loyalistes) ainsi que des responsables gouvernementaux. L’accord politique signé a prévu aussi que Jammeh restait libre de retourner en Gambie à tout moment, conformément au droit international des droits de l’homme et à ses droits en tant que citoyen et ancien chef d’État[51].
Alors qu’aujourd’hui Yayah Jammeh vit en exil en Guinée Équatoriale, aucune décision formelle de cet État n’a été prise pour cet asile conformément aux règles des droits international et national de l’asile. L’asile accordé relève d’une décision politique à la lisière de la procédure normale de l’asile. C’est donc un asile de facto négocié sous la pression régionale, sans observation de la procédure standardisée. Ainsi, en accordant l’asile sans formalisation, une violation explicite de la CADEG ainsi que la Convention de Genève est évitée. Cette approche politique permet d’équilibrer les impératifs de stabilité régionale et les obligations juridiques applicables aux États.
Ces stratégies de contournement ne sont pas sans danger. Elles pourraient favoriser, au-delà de la problématique relative à l’articulation des textes relatifs au droit africain de l’asile, l’impunité du crime africain des CAG qu’il convient d’anticiper.
B. Éloge des sanctions non asilaires aux CAG : la fin de la frontière
Comme l’articulation entre la Convention de Genève et la CADEG paraît difficile sans que le choix pris ne heurte l’un ou l’autre de ces instruments, deux possibilités, fondées sur l’approche du pluralisme normatif ordonné[52], sont tenables pour configurer la solution applicable aux CAG : réécrire le point 8 de l’article 25 et, encourager les États à ratifier le Protocole de Malabo.
La réécriture de l'article 25 (8) suppose de lui trouver un substitut. L’intérêt du point 8 de l’article 25 est impertinente lorsqu’on le met en relation avec le point 9 du même article. Ce dernier point oblige les États à juger les instigateurs des CAG ou à prendre les mesures qui s’imposent afin de leur extradition. Ces deux obligations alternatives renvoient techniquement à un même verdict : l’État qui observe ces obligations est supposé avoir brisé la difficulté d’articulation entre les textes relatifs à l’asile et accueilli l’instigateur du CAG sur son territoire car il est impossible d’extrader un individu que l’on n’a pas, c’est-à-dire sur qui l’on n’exerce pas l’autorité territoriale, même temporairement. Si néanmoins on peut juger par contumace, cela est impertinent dans cette situation, l’obligation de juger étant réservé au seul État tiers ayant accueilli l’instigateur. En conséquence, ce point 8 doit être supprimé, pour qu’il lui soit substitué des sanctions économiques directement ciblées contre les instigateurs des CAG. Nous proposons le gel des avoirs, l’interdiction de transaction commerciale (entreprise, banque) et embargo personnalisé. Pour ce faire, l’UA doit renforcer la coopération avec les États membres, mettre en place une liste noire publique des instigateurs des CAG et obliger, via le canal des États membres, les secteurs bancaires et financiers à vérifier toute transaction contre cette liste.
Quant à l’encouragement de la ratification du Protocole de Malabo de 2014, son entrée en vigueur offrirait une alternative réelle et concrète à la répression du crime des CAG. Elle aurait deux vertus : contraindre même lorsqu’un État mobilise les stratégies de contournement, qu’il engage des poursuites contre tout putschiste. En outre, avec la compétence pénale régionale, l’argument de crainte de persécution des putschistes deviendrait inopérant face à la forte présomption d’être jugé par une juridiction (régionale) indépendante, sans risque d’être soumis à la torture pendant la détention.
Notes de bas de page
- [1] Seuls ces États ne sont pas encore parties : Botswana, Burundi, Congo, RDC, Égypte, Érythrée, Gabon, Lybie, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Somalie, Eswatini, Tanzanie, Tunisie, Ouganda. Disponible sur https://au.int/sites/default/files/treaties/363846-sl-AFRICAN_CHARTER_ON_DEMOCRACY_ELECTIONS_AND_GOVERNANCE.pdf
- [2] A. Salem Ould Bouboutt, « L’Union africaine et les changements anticonstitutionnels de gouvernement : libres propos sur certains aspects de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 », in A. Sall, I. Madior Fall (dirs.), Mélanges en l’honneur de Babacar Kanté : actualité du droit public et de la science politique en Afrique, Dakar, Harmattan, 2017, p. 686.
- [3] « Tout putsch ou coup d’État ; toute intervention des mercenaires ainsi que toute intervention de groupe dissidents armés ou de mouvements rebelles, dont le but est de renverser un gouvernement ». La qualification juridique du fait en CAG n’est admissible que si l’acte touche un gouvernement démocratiquement élu. Font également partie des CAG, le refus par un gouvernement en fonction de transférer le pouvoir « au parti ou au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières » ; l’amendement ou la révision constitutionnelle ou de tout autre instrument normatif qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique ainsi que « toute modification substantielle des lois électorales durant les six mois précédant les élections sans le consentement de la majorité des acteurs politiques ».
- [4] J. Streiff-Fénart, « Pour en finir avec la moralisation de la question migratoire », in Mouvements, 2018, n°93.
- [5] S. E. Lauterpacht, D. Bethlehem, « Avis sur la portée et le contenu du principe du non-refoulement », in E. Feller, F. Nicholson (dirs.), La protection des réfugiés en droit international, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 124.
- [6] J.-J. Wondo Omanyundu, Les armées au Congo Kinshasa : radioscopie de la force publique aux FARDC, Monde Nouveau/ Afrique nouvelle, 2019, 2ème éd.
- [7] J.-P. Langellier, « Joseph-Désiré Mobutu, le prédateur du Zaïre », in O. Guez (dir.), Le Siècle des dictateurs, Paris, Perrin/Le Point, 2019, p. 281.
- [8] D. Peterson, Africa’s totalitarian temptation: the evolution of autocratic regime, London, Lynne Rienner, 2020, p. 1.
- [9] C. Giusa, « On a fait la révolution pour être libres. Libres de partir : les départs des harragas de la Tunisies en révolution », Mouvements, 2018, n°93, p. 103.
- [10] D. Eizenga, « Military Coups in Burkina Faso », in G. Kaly Kieh, K. Amihe Kalu (éds.), Democratization and military coups in Africa: post-1990 political conflicts, Lanham, Lexington Books, 2021, pp. 69-70.
- [11] Voir I. Ntwali, « The African Union and its regional economic communities confronted with coups d’état: between condemning and condoning », Front. Polit. Sci., 2025, n°7, p. 4.
- [12] Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique.
- [13] S. Wiking, Military Coups in Sub-Saharan Africa: How to justify illegal assumption of power, Uppsala, Scandinavian institute of African Studies, 1983, pp. 72-73.
- [14] M. Charland, « La langage politique », in A.-M., Gingras (dir.), La communication politique : État des savoirs, enjeux et perspectives, Presse de l’Université de Québec, 2003, p. 84.
- [15] C. Manga Fombad, « An Over view of Political Party Constitutionalisation under Contemporary Africa Constitution », C. Manga Fombad, J. Socher (éds.), Constitutionalisation of Political Parties and the State of Democracy in Sub-Saharan Africa, Nomos, 2025, p. 35.
- [16] À ce jour, seuls ces États n’ont pas ratifié cette Convention : Djibouti, Érythrée, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Namibie, République arabe saharaouie démocratique, Somalie, Sao-Tome & Principe. Disponible sur https://au.int/sites/default/files/treaties/36400-sl-OAU%20Convention%20Governing%20the%20Specific%20Aspects%20of%20Refugee%20Problems%20in%20Africa.pdf
- [17] « Nul ne peut être soumis par un État membre à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons énumérées à l'article 1, paragraphe 1 et 2 ».
- [18] G. Gilbert, « Questions d’actualité relatives à l’application des clauses d’exclusion », in E. Feller, F. Nicholson (dirs.), op.cit., p. 483.
- [19] S. Bolle, « Déconstruction et reconstruction de l’ordre constitutionnel au Gabon (2023-2024) », Afrique Contemporaine, 2024, n°2, p. 119.
- [20] Commission ADHP, Communication 147/95-149/96, 2000, § 73.
- [21] G. Gilbert, op.cit., p. 484.
- [22] F. Tabala Kitene, Le statut des sanctions contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement dans les textes et la pratique de l’Union africaine. Contribution à l’étude de la production des normes par les organisations internationales, Thèse de doctorat, Université de Gand, 2013, p. 64.
- [23] É. Ngango Youmbi, B. Cissé, « Chronique de trente-deux ans de coups d’État en Afrique : (1990-2022) », RFD, 2023, n°1, pp. e25-e52.
- [24] S. Jean Baptiste, B. Kahombo, « Taking Stock of African Union’s Sanctions against Unconstitutional Change of Government », In Law in African, 2022, n°25, p. 144.
- [25] G. Bombela Mosua, « Les ordonnances constitutionnelles de l’armée : essai de réflexion théorique sur une catégorie juridique complexe », Afrique contemporaine, 2024, n°2, pp. 147-149.
- [26] Communiqué n°001 du gouvernement de la transition relatif au décès de l’ancien président de la République monsieur Ibrahim Boubacar Keita, Bamako, 16 janvier 2022.
- [27] E. De Bruin, How to prevent coups d’État, Ithaca and Londo, Cornell University Press, 2020, p.121 et ss.
- [28] M.-L. Tougas, Droit international, Sociétés militaires privées et conflit armé : entre incertitudes et responsabilités, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 19.
- [29] R.-B. Parse, Centrafrique, un vrai-faux départ. Cas atypique d’un mal africain, Paris, l’Harmattan, 2017, p. 98.
- [30] S. Nabaneh, « Prospects for Democratic Consolidation in The Gambia. A Cup Half Full, Half Empty, or More? » in T. G. Daly and D. Samararatne (éds.), Democratic Consolidation and Constitutional Endurance in Asia and Africa. Comparing Uneven Pathways, OUP, 2024, pp. 209 et 210.
- [31] Rapport sur la gouvernance en Afrique 2023 : Changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, Forum des chefs d’État et de gouvernement du MAEP, 2023, p. 16.
- [32] T. Muhindo Makunya, « The Nexus between Constitutionalism, Peace and Security in the Law and Practice of African Union », Law in Africa, 2022, n°25, p. 79.
- [33] B. Tchikaya, « La Charte africaine de la démocratie, des élections de la gouvernance », Annuaire français de droit international, 2008, vol. 54, p. 527.
- [34] L’article 25 (6) énonce que la Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout État partie qui fomente ou soutient un CAG dans un autre État, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte constitutif de l’UA.
- [35] UNHCR, « Legal considerations on asylum and non-refoulement in the context of ‘instrumentalization’ », International Journal of Refugee Law, 2025, vol. 37-2, pp. 280-288.
- [36] E. Dunlop, Access to Courts or asylum seekers and refugees: state obligations under the refugees Convention, Oxford university press, 2024, pp. 165-173.
- [37] Résolution sur la migration et les droits de l’homme, CADHP/Res.114, 28 novembre 2007.
- [38] A. L. Purkey, Refugee Dignity in Protracted Exile: Rights, Capabilities and Legal Empowerment, London and New York, Routledge, 2020, p. 72.
- [39] Résolution sur le respect du principe de non-refoulement des demandeurs d’asile et des réfugiés, CADHP/Res.484, 28 juillet 2021.
- [40] C. D’Orsi, « Protection of “Freedom of movement” and of asylum-seekers and refugees: progress made by the African Commission on human and peoples ‘rights via its communication procedures and beyond », in Texas International Law Journal, 2021, vol. 57, p. 198.
- [41] Communication 27/ 89- 46/ 91- 49/ 91- 99/ 93, Organisation Mondiale contre la Torture et al v Rwanda, § 31. Cités par R. Murray, The African Charter on Human and Peoples’ Rights, Oxford University Press, 2019, p. 332.
- [42] Commission ADHP, Principes directeurs africains relatifs aux droits de l’homme de tous les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, avril 2023.
- [43] C’est une philosophie africaine qui s’entend comme sentiment de solidarité ou de fraternité qui nait entre les personnes au sein de groupes marginalisés ou défavorisés.
- [44] S. Morreira, Rights after Wrong: local knowledge and human rights in Zimbabwe, Stanford and California, Stanford university press, 2016, pp. 120-135.
- [45] K. Kittichaisaree, Judicial responsibility and coups d’État. Judging Against Unconstitutional Usurpation of Power, London and New York, Routledge, 2023, p. 168.
- [46] Commission ADHP, Rapport de la Rapporteure spéciale sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique, 79OS, 16 mai 2024.
- [47] S. Jean Baptiste, B. Kahombo, op.cit., p.149.
- [48] A. Soma, Le crime international de changement anticonstitutionnel de gouvernement, Revue Suisse de droit international et européen, 2016, vol. 6-2, p. 434.
- [49] V. Duhem, « Burkina : la nationalité ivoirienne de Blaise Compaoré fait débat », Jeune Afrique, 24 février 2016. Accessible à https://www.jeuneafrique.com/304893/politique/burkina-nationalité-ivoirienne-de-blaise-compaore-debat/
- [50] S. Nabaneh, op.cit., p. 209.
- [51] Gambie : le chef de l’ONU salue le règlement politique africain ayant permis la prévalence de l’État de droit Un News Centre, 22 janvier 2017. Accessible sur https://data.unchr.or/fr/news/15626
- [52] M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II) : le pluralisme ordonné, Paris, Seuil, 2006, pp. 17-31.