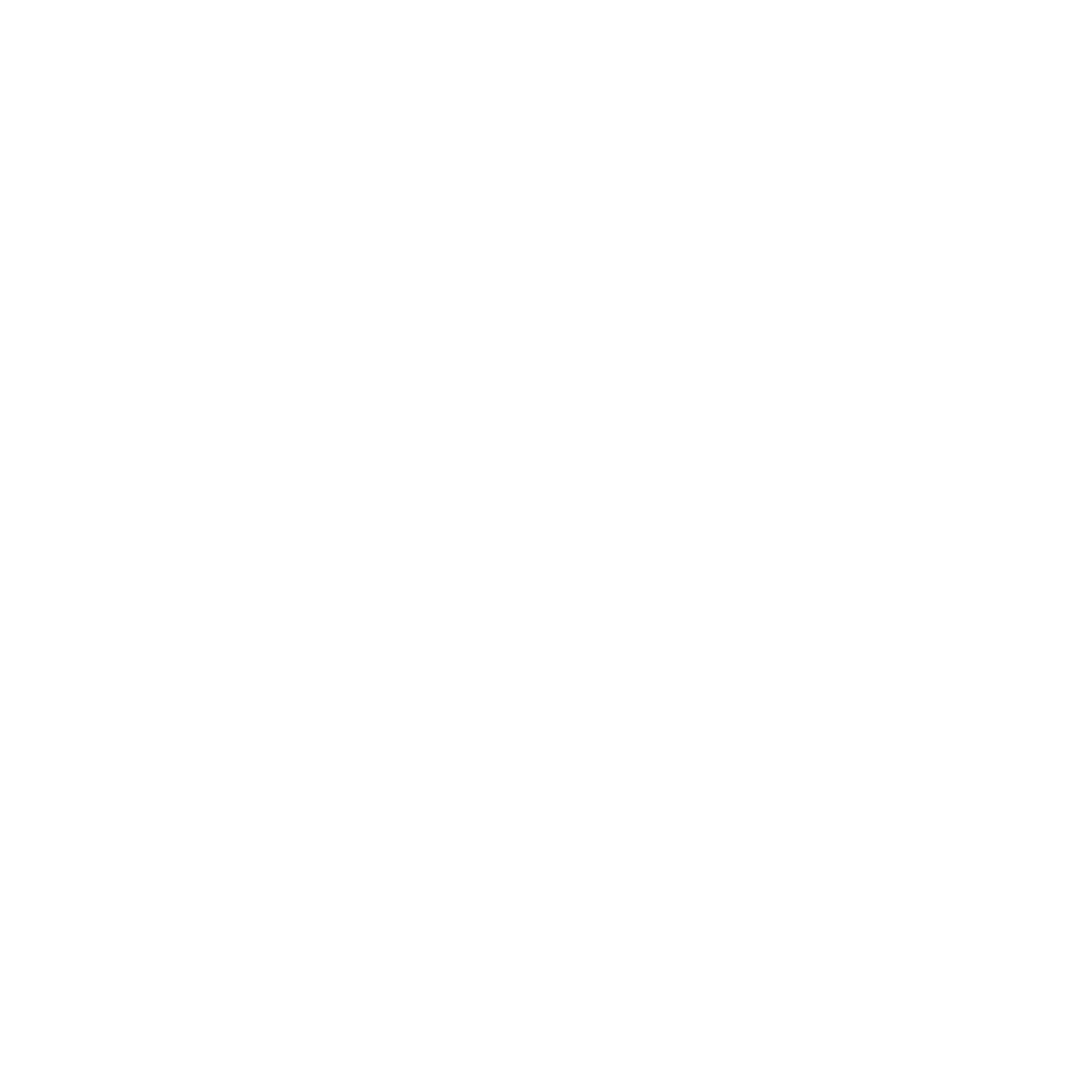La Convention de Genève comme le droit européen conditionnent la demande de protection internationale au fait de se trouver en dehors de son propre pays. Or, les faiseurs de lois et leurs interprètes s’échinent à rendre cet accès particulièrement compliqué : aucun dispositif européen ou français – sans même parler de l’échelon international – ne permet de solliciter une protection depuis l’étranger, si ce n’est grâce à l’obtention, par des voies généralement impénétrables, d’un visa humanitaire, dont on sait que la délivrance n’est une obligation ni sur le fondement du droit de l’Union européenne[1], ni de la Convention européenne des droits de l’homme[2]. L’adoption en 2024 des textes constitutifs du Pacte « asile et migration » de l’UE, dont la plupart entrera en vigueur en juin 2026, n’y changent en rien – tout au contraire : le Règlement « Procédures » (2024/1348), qui remplace la Directive du même nom (2013/32/UE) rend la procédure d’asile à la frontière obligatoire, et contraint les ressortissants d’États tiers à se maintenir à disposition des autorités : c’est l’institutionnalisation des « hotspots », que ne dément pas le nouveau Règlement « Filtrage » (2024/1356) visant à orienter, en un temps très court qui interroge le respect des droits, les étrangers ayant franchi de manière irrégulière les frontières extérieures de l’Union vers les procédures idoines (éloignement ou asile).
Ce mouvement n’est pas qu’européen : aux États-Unis bien sûr, mais ailleurs également, les États compliquent l’accès à leur territoire et renforcent les procédures de contrôle à leurs frontières – et ce alors que les mouvements migratoires mondiaux sont dus, pour certains tout du moins, aux conséquences d’un changement climatique dont les États qui se barricadent sont à l’origine : le cloisonnement se fait souvent au prix de telles injustices. Il reste alors quelques interstices à ne pas négliger : le nouveau Règlement 2024/1350 établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire en est un, certes modeste – il ne garantit aucun droit à l’admission ou à la réinstallation – mais néanmoins remarquable : la frontière – pour une fois – n’y est pas un obstacle pour l’étranger persécuté.